9 avril 2024
Base Documentaire : 05.1. CEDH
► Référence complète : CEDH, Grande chambre, 9 avril 2024, n°53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse
____
________

12 janvier 2024
Organisation de manifestations scientifiques

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 12 janvier 2024
____
____
🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance
____
📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕Compliance et contrat, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.
📘Compliance & Contract, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.
____
► Présentation générale du colloque : La Compliance se développe dans l'ensemble du système juridique, aussi bien via les techniques de Droit public que de Droit privé. Le Droit des contrats publics en porte la trace par deux façons : par son champ d’application, en ce que la Compliance vise les relations économiques nouées par des personnes publiques, et par son objet, internalisant une conciliation entre leurs intérêts économiques et un ensemble d’autres finalités d’intérêt général ou « Buts Monumentaux », conciliation dont les personnes publiques ont traditionnellement la charge. A côté de l’acte unilatéral et pour opérer concrètement cette conciliation, le contrat a toute sa place. Sa flexibilité permet la négociation et l'ajustement dans les charges qu’il convient de faire peser sur les cocontractants.
L’objet de ce colloque est de parvenir à rattacher différentes manifestations de l’obligation de Compliance en contrats publics et ainsi donner une cohérence à des politiques qui sont encore trop souvent envisagées de manière étanche parce qu’elles renvoient à des buts et des domaines très différents.
Au stade de la passation, d’abord, la promotion des achats responsables ou innovants, notamment d’un point de vue environnemental, est l’un des signes de la présence de la Compliance. Dans un registre tout autre, il en est de même de la remise en cause par la CJUE de l’application automatique des interdictions de soumissionner, qui empêchent le pouvoir adjudicateur de statuer sur la fiabilité d’un candidat en prenant en compte les programmes de compliance mis en œuvre par les entreprises depuis leur condamnation.
Au stade contentieux, ensuite, la récente et large reconnaissance par le Conseil d’État de l’illégalité d’un contrat administratif pour violation des obligations déontologiques est venue nuancer la dynamique de sécurisation des contrats, tirant en ce sens les conséquences du grand mouvement de transparence de la vie publique engagé depuis 2013.
La matinée aura pour but d'appréhender les diverses formes de l'obligation de Compliance dans les contrats publics. Ce panorama permettra, dans l'après-midi, de viser à unifier l'obligation de Compliance dans les contrats publics.
____


____
► Interviennent :
🎤Ugo Assouad, Doctorant à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Philippe Augé, Président de l'Université de Montpellier
🎤Clémence Ballay-Petizon, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Yannisse Benrahou, Doctorant à l’Université Paris Nanterre, CRDP
🎤Léon Boijout, Doctorant contractuel chargé d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP
🎤Guylain Clamour, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professeur à l'Université de Montpellier, CERCOP
🎤Pascale Idoux, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Nedjma Kontoukas, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Valentin Lamy, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, IRENEE
🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille, ERDP
🎤Lucien Rapp, Professeur émérite à l’Université Toulouse Capitole
🎤Marion Ubaud-Bergeron, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM
____
🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

12 janvier 2024
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, notes prises pour faire le rapport de synthèse du colloque Compliance et Contrats, 12 janvier 2024
____
🧮lire la présentation de la conférence
____
► Méthode : La conclusion a été conçue comme une synthèse des propos qui se sont succédés dans la journée.
Elle nourrira également la contribution à l'ouvrage Compliance et Contrat : "Le contrat public, modèle du contrat de compliance".
Parce qu'il s'agit d'une synthèse, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels, même si le lien entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance, qu'illustre particulièrement les contrats publics, a fait l'objet de nombreux écrits depuis des années.
____
🔓lire les notes prises au fur et à mesure de l'écoute des différentes interventions des orateurs successifs ⤵️
6 juillet 2023
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : TJ Paris, 5ème chambre, 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2023, n° RG 22/03403, TotalÉnergies
____
____
📝commentaires de la décision :
- Dalloz actualité, 13 juillet 2023, obs. J.-B. Barbièri & A. Touzain
- Rev. sociétés, 2023, p.793, obs. A. Danis-Fatôme & N. Hoffschir
- Gaz. pal., 19 septembre 2023, n° 29, n°GPL453l6, pp. 2-3, note V. Mazeaud
- Bull. Joly, novembre 2023, n° BJS202m8, pp. 17-19, note E. Schlumberger
________
11 janvier 2021
Interviews

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Utilisons la puissance des GAFAMs au service de l'intérêt général!", interview réalisé par Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 11 janvier 2021
Présentation de l'interview par Olivia Dufour:
Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance, a remis au Gouvernement en 2019 un rapport sur la gouvernance d’Internet.
Pour cette spécialiste, confier un pouvoir disciplinaire aux GAFAMs est la seule solution efficace. Et la suppression du compte twitter de Donald Trump n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Les trois questions posées par Olivia Dufour sont :
- La suppression du compte Twitter de Donald Trump suscite une forte émotion sur les réseaux sociaux, et pas seulement chez ses partisans. Qu’en pensez-vous ?
- Il n’empêche que cet incident suscite l’inquiétude. Ne donne-t-on pas trop de pouvoirs à ces entreprises privées ? Cela repose la question en France de la pertinence du dispositif Avia…
- Il faudrait donc se résoudre par défaut à confier nos libertés à des mastodontes privés et opaques ?
Lire les réponses détaillées apportées à ces trois questions
Pour aller plus loin, notamment sur la logique qui guide le dispositif Avia, voir:
- Frison-Roche, M.-A., "Haine sur internet: il faut responsabiliser les opérateurs numériques", 2020
- Frison-Roche, M.-A., L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, rapport remis au Gouvernement, 2019

1 novembre 2020
Publications

Ce document de travail a servi de base à une interview menée par Olivia Dufour et parue dans Actu-juridiques-Lextenso le 11 janvier 2021.
5 décembre 2019
MAFR TV : MAFR TV - cas
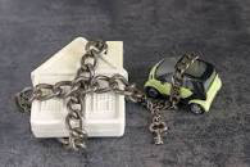
Regarder la video expliquant le contenu, le sens et la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2019.
L'ACPR a prononcé une sanction très élevée, représentant 7% du résultat net annuel de la société La Banque Postale. Le manquement est constitué par le fait de n'avoir pas prévenu l'usage de la technique bancaire du "mandat-cash" qui a été utilisé pour échapper au gel des avoirs.
Le Conseil d'Etat rappelle que par nature s'il y a gel des avoirs, il ne faut pas que quiconque veut disposer de ces avoirs. Or, par l'usage de "mandats cash" des personnes visées par des décisions de gels des avoirs, décidés en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, avaient pu faire circuler de l'argent à partir de comptes gérés par La Banque Postale, dont ils n'étaient pas clients.
Ce cas d'un usage d'un moyen par une personne qui n'est pas client de la banque n'était pas prévu au moment où les faits reprochés se sont déroulés et la Banque poursuivie prétend ne pouvoir être donc punie puisqu'en matière répressive il faut respecter le principe de non-rétroactivité des textes, ultérieurement complété pour viser une telle hypothèse, la non-rétroactivité étant un principe majeur lui-même lié au principe de la légalité des délits et des peines.
Nous sommes donc dans l'hypothèse d'un silence des textes.
La Banque peut-elle être condamnée et si lourdement ou non par l'ACPR ?
La Banque ne le pense pas, puiqu'elle forme un recours.
La Banque agit contre cette décision de sanction en premier lieu parce que ceux qui l'ont ainsi utilisé n'étaient pas ses clients. Elle a de fortes raisons pour se prévaloir de ce fait, puisqu'ultérieurement à celà les textes ont été complétés pour viser non seulement l'usage de cette technique par ceux qui ont un manque dans la banque et ceux qui agissent avec des "mandats-cash hors compte", c'est-à-dire sans titulaire d'un compte. Comme nous sommes en matière pénale, l'interprétation restrictive et la non-rétroactivité des texte devrait conduire à suivre le raisonnement de la Banque. Mais le Conseil en le fait pas car il considère qu'implicitement mais nécessairement même avec la modification ultérieurme du texte, celui-ci visait aussi cet usage-là.
Pour cela, le Conseil développe une conception très large des obligations des banques dans leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et donc très répressive, ce qui imprègne leur "obligation de conformité". Ainsi, lorsque la banque soutient par ailleurs que l'on ne peut la sanctionner puisque cette activité de mandat-cash est pour elle déficitaire et qu'elle n'a pas causé de préjudice à ses clients en assumant mal ses obligations, le Conseil d'Etat souligne qu'il ne s'agit pas de cela puisque l'obligation de conformité relève de "l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation des gels des avoirs".
Lire la décision du Conseil d'Etat.
22 mai 2019
Base Documentaire : 02. Lois
► Référence complète: Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite "loi PACTE".
____
______
22 mai 2018
Base Documentaire : Doctrine
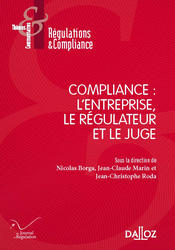
Référence complète : Amico, Th., La convention judiciaire d'intérêt public ou la compliance comme moyen de lutte contre la récidive, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 79-90.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.
Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.
4 avril 2018
Base Documentaire : Doctrine
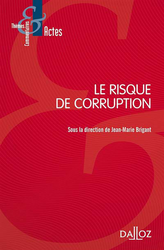
Référence complète : Gallois, A., La convention judiciaire d'intérêt public, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 119-128.
Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"
11 décembre 2017
Publications
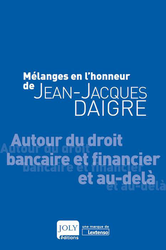
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et confiance, in Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, Joly éditions - Lextenso, déc. 2017, pp.279-290.
____
► Résumé de l'article : Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.
En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).
Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).
____
🚧 Lire le document de travail bilingue servant de base à l'article ici publié.
____
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
____
____
3 juin 2016
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Champaud, C., Propriété, pouvoir et entreprise, in Mélanges en hommage à Laurence Boy, Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2016, pp. 47-66.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR-Régulation"
14 novembre 2014
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation.
En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée, l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de "retenir" des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques.
Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée.
Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.
Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que "la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art". Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété "n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif".
Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure "une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique".
La disposition législative est donc contraire à la Constitution.
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

12 novembre 2012
Conférences
La séance qu'il s'agit de présider fait suite à un ensemble d'interventions ayant traité le sujet branche du droit par branche du droit. Celle-ci est plus thématique est prospective, puisqu'elle envisage par exemple les associations comme "lanceurs d'alerte", les actions de groupe ou les préjudices qui pourraient ainsi être réparés. Ce sont donc avant tout des sujets d'avenir, notamment pour les nouvelles matières comme le droit de l'environnement.
C’est d’une façon plus privilégiée à travers le droit de l’environnement que la problématique sera analysée, mais cela n’est qu’à titre illustratif, les propos étant articulés dans une perspective générale.
Ainsi, les intervenants font prendre appui sur les difficultés nouvelles que l’on observe dans certains situations, par exemple en cas de dommages environnementaux, et du coup les solutions nouvelles que les associations pourraient mettre en oeuvre en tant qu’elles sont des parties au procès qu’on ne peut réduire ni au ministère public ni à l’administration ni à une personne privée.
En outre, si l’action de groupe est analysée à travers l’avantage d’efficacité qu’elle pourrait constituer, les intervenants recherchant comment éviter l’effet pervers que constitue l’appropriation des dommages et intérêts pour les associations
Du point de vue plus systémique, sera posée la question de savoir dans quelle mesure les associations pourraient ou devraient partie à l’élaboration des normes.
22 juillet 1999
Publications : Doctrine
Référence complète : Laffont, Jean-Jacques, Intérêt général et intérêts particuliers, in Rapport public 1999 du Conseil d'État L'intérêt général, p. 421-428.
_____
Les étudiants de Sciences Po peuvent accéder au texte de l'article par le Drive de Sciences Po (dossier MAFR - Régulation).