23 mars 2025
droit illustré

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pour juger un acte, il faut plonger dans les récits contradictoires des uns et des autres. En cela tout procès est "atypique"🎬documentaire Le procès", billet mars 2025.
____
___
Le procès est un documentaire, diffusé sur TF1 le dimanche 23 mars 2025. Il porte sur un procès pour meurtre qui se déroule devant la Cour d'assises du Gard. Celui-ci est présenté comme "atypique", en ce que la victime y semble presque absente, son objet étant davantage la relation entre l'auteur du meurtre et sa mère (I). Il en ressort que juger des actes, celui du fils mais aussi celui de la mère, suppose la reconstitution crédible des faits, ce qui suppose aussi de comprendre les êtres humains impliqués (II). Tout procès est ainsi construit, mais l'on peut affirmer aussi que tout procès est atypique (III). Ce que la passion des algorithmes doit considérer.

I. UN DOCUMENTAIRE SUR UN PROCES D'ASSISES ATYPIQUE : SON OBJET EST LA RELATION ENTRE L'AUTEUR DU MEURTRE ET SA MÈRE
La chaine présente le documentaire : "vous verrez le procès comme si vous y étiez".
Le procès d'assise qui est déroulé à la Cour d'Assises de Nîmes est présenté dans l'ordre chronologique, la voix off rappelant quelques règles élémentaires, par exemple la désignation des jurés.
Il est aussi présenté comme "atypique", car le sujet n'est pas tant le meurtre lui-même mais les rapports entre l'auteur du meurtre et sa propre mère, qui est la compagne de la victime. En effet, le fils soutient qu'il a battu avec une batte de base-ball celui-ci pour le dissuader de continuer à battre sa mère et que, descendant de la chambre après l'avoir battu, il en informe sa mère. Mais sa mère a une version différente des faits, pour justifier notamment le fait qu'elle ne se soit pas déplacée pour aller voir l'état de la victime, affirmant qu'elle n'a pas vu cette batte.
Les psychiatres confirment ce caractère atypique en raison de la relation entre la mère et le fils, celui-ci ne pouvant assumer le rôle de protecteur qu'on exige de lui. Le psychiatre observe que la perte de contrôle que traduit le geste en est la conséquence.
Quant à elle, la mère dit qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Elle est elle-même poursuivie pour délit de non-assistance à personne en danger.
Le documentaire considère que le sujet est donc la relation entre la mère et le fils, Cette relation est décrite comme fusionnelle, le fils étant instituée comme chef de famille tandis que la mère est dans un état de dépression permanente. Les témoins décrivent la mère comme étant "toxique", ne concevant pas que son fils puisse exister en dehors d'elle, le fils se sacrifiant. Des témoins considèrent que la mère serait manipulatrice.
II. JUGER UN ACTE SUPPOSE LA RECONSTITUTION CRÉDIBLE DES FAITS ET DE COMPRENDRE LES ETRES HUMAINS IMPLIQUÉS
Ce cas ainsi exposé montre d'une façon extrême que l'on ne peut juger les actes (le meurtre par le fils, la non-assistance à personne en danger par la mère).
La question de preuve, et les qualifications qui en découlent, est la suivante : celle des intentions. En effet, l'intention de tuer est en cause, l'avocate de l'accusé demandant pendant l'audience la requalification en blessures mortelles ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner. De la même façon, l'intention de la mère de ne pas agir, voire l'intention d'utiliser son fils.
L'écoute des questions, des réponses, montre la difficulté de reconstituer ce qui est exact, ou à tout le moins crédible, dans les faits évoqués par les personnes, et plus largement les récits articulés par les uns et les autres.
Il ressort des uns et des autres que c'est le récit global de la mère qui est le moins crédible.
III. UN PROCÉS ATYPIQUE, DES EXIGENCES ET MÉTHODES PROBATOIRES COMMUNES
Ce que l'on peut retenir dans ce que ce documentaire porte sur la crédibilité des récits.
En effet, comme le rappelle l'Avocat général : "on n'est jamais dans la tête des gens". C'est pourquoi l'Avocat général récuse avec force la demande de requalification et rappelle la définition juridique de l'intention criminelle.
De la même façon, l'avocate de la mère rappelle que celle-ci n'est pas poursuivie pour avoir été une "mauvaise mère". Elle a sans doute une "responsabilité morale", qu'elle a reconnue, mais elle n'a pas de responsabilité juridique, l'avocate soulignant qu'il ne faut pas confondre Droit et Morale.
Ce qui est remarquable est qu'à ce titre ce procès qui est présenté comme "atypique" est comme tous les autres procès, non seulement les procès pénaux mais les procès civils.
Cet entrechoc des récits est ainsi raconté par Eliette Abécassis à travers son roman Divorce à la française.
______
17 février 2021
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2021

Résumé de la leçon : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l' efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne.
Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le Droit européen, tel que celui-ci a été précédemment présenté.
En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du Droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.
Mais et tout d'abord, par souci d' efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.
Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du Droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du Droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du Droit pénal avec le Droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.
Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.
-
Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
-
Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière
Revenir à la présentation générale du cours
Revenir au plan général du cours
Utilisez les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode:
31 octobre 2014
Blog
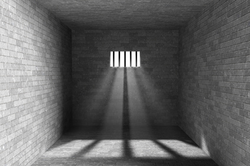
Les systèmes politiques sont désorientés face aux mouvements terroristes nouveaux, notamment celui qui a l'audace de prendre l'appellation d'État islamique.
Les États pensent à des solutions, mais la difficulté vient du fait que les personnes auxquelles ils sont confrontés n'ont pas encore commis d'actes. Leur acte consiste à partir pour rejoindre un mouvement, concrétisation de leur liberté d'aller et venir. Certes, l'État sait que ce déplacement n'a de sens que pour participer à des actions interdites, à savoir tuer en masse. Mais "sur le moment", l'acte en lui-même ne semble pas répréhensible.
Le Royaume-Uni a l'ingéniosité de faire renaître l'interdiction de la "double allégeance" pour affirmer que le seul fait de prétendre agir par obéïssance à un autre que la Couronne suffit à constituer un acte criminel (la "Haute trahison").
Dans sa chronique du 31 octobre 2014, Brice Couturier se demande s'il convient de "juger les jihadistes plutôt que de les refouler".
En effet, et d'une façon logique, il se demande s'il ne convient pas, plutôt que de restreindre leur liberté d'aller et de venir, de les laisser partir, passivement en les empêchant, peut-être activement en les autorisant. Si par la suite, s'il s'avère qu'ils commettent des actes répréhensibles, dans ce second temps, il sera possible, adéquat de les appréhender et de leur reprocher efficacement l'acte criminel enfin perpétré.
Brice Couturier affirme que cela serait plus légitime que de procéder comme le fait le projet de loi de lutte contre le terrorisme, déjà votée par l'Assemblée Nationale le 29 octobre 2014 et soumis désormais au Sénat.
En effet, ce texte réprime un comportement consistant notamment à consulter des sites Internet, à préparer des explosifs, à détenir des armes, à repérer des cibles, etc., sans qu'un acte ait été encore commis. Pour les pénalistes, cela n'est pas conforme à l'exigence du droit pénal classique, lequel exige un acte pour que la personne soit sanctionnée. La seule intention ne peut justifier une condamnation. L'infraction comprend non seulement l'élément légal et l'élément intentionnel, mais encore l'élément matériel. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira.
Mais suivons ce raisonnement. Plutôt que de sanctionner avant l'acte, expulsons les personnes pour mieux qu'elles le commettent et ainsi, dans le respect de Beccaria, les sanctionner par la suite, les trois attributs de l'infraction étant réunis.
Comment attrape-t-on les personnes ayant rejoint le mouvement terroriste, à la fois international et infiltré, une fois que l'État a concrétisé leur liberté d'aller et venir par le biais paradoxal de l'expulsion ?
14 octobre 2014
Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
 La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0.
La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0.
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

5 juillet 1997
Conférences