Matières à Réflexions
4 septembre 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.451-470.
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la "conformité", c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur.
S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier.
Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Barbièri, "Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Désignant à première vue l'intersection de la Compliance et des procédures collective comme le "mariage de la carpe et du lapin", l'auteur montre que la logique en est sur de nombreux points communs, notamment par l'office qu'y exerce le Juge, car il s'agit toujours d'une délégation que l'Etat fait de Buts Monumentaux, les procédures collectives venant concrétiser la volonté de sauver une entreprise, des emplois, une industrie, une région, etc., dans ce qui est toujours un "intérêt public". Dans son office, le Juge des procédures collectives est confronté à des clauses de compliance, portant sur des engagements ou des informations ou organisant des monitorings.
L'auteur examine tout d'abord les cas dans lesquels le Juge des procédures collectives confronte le principe de primauté des procédures collectives sur cette organisation de compliance, soit au titre des contrats en cours, qui peuvent contenir des obligations de compliance notamment parce que les audits et les contrôles auront été renforcés ou qu'une résiliation automatique serait prévue (qui serait alors désactivée ?), soit parce que s'abattent les nullités de la période suspecte, parce que les clauses de compliance sont souvent déséquilibrées.
Puis dans une seconde partie, est examinée l'hypothèse dans laquelle les techniques de compliance vont venir en soutien des procédures collectives elles-mêmes et du But que celles-ci servent. En effet, parce qu'ils sont par nature préventifs, les mécanismes contractuels de compliance peuvent aussi prévenir les défaillances, par des clauses d'audit et de monitoring et la mise en place de reporting, au besoin sous le suivi du Juge associé à des mécanisme de conciliation.
Plus encore, il faut les utiliser pour restructurer les entreprises en difficulté. Le plan, qui peut être imposé aux créanciers, doit ouvrir la palette des instruments, pourrait peut-être viser cette classe de parties qui ne serait constituée que des créanciers bénéficiant de clauses de compliance, si l'on considère qu'ils constituent une "communauté d'intérêt économique suffisante". Ils pourraient alors eux-aussi avoir une délégation de surveillance sur la survie de l'entreprise, but monumental du plan. Dans le cas d'un plan de cession, une offre comprenant des engagements de compliance ne devrait pas être privilégiée puisque la loi expressément ne donne à ce plan pour but que d'assurer le maintien d'activités et d'apurer le passe. Mais l'avenir dira si le juge ne dépassera pas cela.
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne que si le Droit de la Compliance et le Droit de la Concurrence peuvent paraître aujourd'hui éloignés, c'est parce beaucoup ont aujourd'hui une vision restreinte et inexacte du Droit de la concurrence. En effet, si l'on réduit celui-ci à n'être que ce qui permet le plein fonctionnement de la règle de la rencontre entre l'offre et la demande, alors il faut injecter des "obligations de compliance" qui viennent se surajouter à cette sorte de "loi naturelle" du marché adossée au Droit, obligations de compliance donnant de l'humanité à l'ensemble. Mais si l'on redonne au Droit de la concurrence sa juste dimension, que dans sa conception somme toute plus classique, il a, les liaisons entre les obligations nées des 2 branches du Droit trouvent des relations harmonieuses. Elles sont d'autant plus requises que, notamment à travers l'Obligation de Vigilance, le droit civil de la concurrence va interférer du fait de la contractualisation de cette obligation légale et du possible déséquilibre significatif qui pourrait être relevé, l'article soulignant que l'application des impératifs de Compliance sur un partenaire pourrait finir par s'analyser comme un pouvoir, justifiant un contrôle des concentrations ou à tout le moins une position dominante dont l'abus sera sanctionné. C'est pourquoi la Directive de 2024 sur le devoir de vigilance rappelle que la mise en place de celui-ci doit se faire en respectant les règles de concurrence. Mais il est souligné que c'est vers une sorte de "concurrence éthique" que les obligations de compliance mènent, débouchant sur de nouvelles pratiques.
Il en résultent en effet des résultats, décrits dans la seconde partie de l'article, qui accroissent le rayonnement de l'Obligation de Compliance, qui porte et l'ambition d'une "transition juste" et d'une "Europe sociale". Ces ambitions sont récusées par les tenants de la conception dite "néolibérale" de ce que doit être le Droit de la concurrence, mais la conception d'une "concurrence-moyen" était bien celle des concepteurs américains du corpus des règles idoines au XIXème siècle, alors qu'il fallait notamment lutter contre les grands monopoles d'infrastructure et elle était celle des juristes fondateur de l'Union européenne.
Seule la vision minimale de ce qui relève de la concurrence entraîne une opposition à l'égard de l'Obligation de compliance. L'auteur souligne donc qu'"il semble aujourd’hui évident que la compliance doit être la boussole du droit de la concurrence.". C'est dans cet esprit-là que les entreprises doivent rédiger les clauses de compliance qui vont se multiplier pour structurer les chaines de valeur qu'elles ont mises en place, en prévoyant notamment la résolution des tensions, voire conflits, avec les partenaires.
L'auteur conclut que c'est ainsi que les entreprises cruciales montreront leur "responsabilité particulière" à la fois et de la même façon au regard du Droit de la Concurrence et du Droit de la Compliance.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".
Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.
Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.
Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.
Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.
L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Aynès, "Comment l’arbitrage international peut être un renfort de l’Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur part du constat premier comme quoi l'arbitrage international et la compliance sont naturellement ajustés puisqu'ils sont tous deux une manifestation de la mondialisation, expriment un dépassement des frontières, l'arbitrage pouvant reprendre les buts monumentaux de la compliance puisqu'il a engendré un ordre arbitral substantiellement global.
Mais l'obstacle réside dans la source de l'arbitrage demeure le contrat, l'arbitre n'exerçant qu'une juridiction temporaire dont la mission est donnée par ce contrat. Pourtant l'avènement de l'ordre global arbitral permet ce dépassement, l'arbitre puisant dans des normes dont les buts monumentaux de la compliance et les engagements des entreprises peuvent faire partie. Ce faisant l'arbitre devient un organe indirect de ce droit de la compliance dont on voit l'émergence.
Puis la contribution évoque une seconde évolution, qui pourrait faire de l'arbitre un organe direct de concrétisation de la compliance. Pour cela, il faut que l'arbitre non seulement contraigne à l'exécution d'obligation de faire, ce qui est déjà le mouvement au titre des mesures provisoire, mais encore ait une conception plus ample ce qu'est le conflit pour lequel une solution est requise, voire se libère un peu de cette source contractuelle qui le cerne. Cela est possiblement en train de se dessiner, en miroir de la transformation profonde de l'office du juge.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Loiseau, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs numériques. Il souligne le paradoxe d'un Droit qui est parti d'un texte qui a posé le principe de l'irresponsabilité des hébergeurs, en raison de leur neutralité technique, pour aboutir au DSA et leur imposer des diligences, mais il rappelle que cette obligation n'apparaît qu'à partir d'un signalement qui est porté auprès de l'opérateur numérique et une interdiction expresse d'une obligation générale de surveiller les informations. Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale de vigilance à la charge des opérateurs numériques, même si la jurisprudence récente semble durcir le rôle imposé aux hébergeurs.
Le But Monumental ici visé est de lutter contre les contenus illicites, mais la liberté d'expression doit être aussi préservée et les réglementations varient selon le type de contenus, tandis que le DSA a une conception plus générale, vise une logique de responsabilisation et de prévention des risques systémiques. Mais vouloir "responsabiliser" les plateformes en Ex Ante, sans toucher au régime de responsabilité en Ex Post, peut poser difficulté.
L'obligation de vigilance va varier suivant que l'opérateur numérique a un rôle passif ou actif. Cela peut conduire les plateformes à adopter des mesures préalables qui peuvent constituer des obligations structurelles, le tiers de confiance pouvant prendre la forme d'un signaleur de confiance. La plateforme est ainsi rendue responsable de sa propre vigilance, mais malgré des hypothèses d'obligation de vigilance renforcée, cela ne doit pas aller jusqu'à des mesures d'investigation. Il faut néanmoins tenir compte d'obligations de vigilance renforcées spécifiques pour les très grandes plateformes, justifiées par les risques engendrés et les types de contenu (terrorisme, pornographie).
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Françon, "L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs bancaire et d'assurance. Il insiste sur le fait qu'en matière bancaire et d'assurance, la vigilance consiste dans une obligation de traiter des informations, au besoin préalablement collectées, en vue de prévenir la survenance d'un risque systémique.
L'identification et la prévention du risque est une obligation de moyens renforcée qui, dans ce cadre, connaît des variations d'intensité. L'obligation est ancienne, alors que le devoir de vigilance est récent. Ce décalage dans le temps s'explique parce que la vigilance obligée est consubstantielle à l'activité même du banquier et de l'assureur et du fait du caractère systémique du secteur depuis toujours, ce qui produit une imbrication du droits dur et souple.
Les variations de l'intensité de l'obligation de vigilance tiennent quant à elles au fait qu'il y a deux types d'obligations : celles qui sont imposées dans l'intérêt de l'activité et du client et celles qui le sont dans l'intérêt de la stabilité du système. Les secondes sont beaucoup plus fortes que les premières. Elles pèsent aussi bien sur le banquier que sur le client. Ainsi les obligations en matière de blanchiment ont pour seul but l'intérêt général, le client ne pouvant se prévaloir des manquements de la banque (Com. 28 avril 2004). D'ailleurs, en matière de gel des avoirs, l'obligation de vigilance devient de résultat.
Dans l'intérêt général lui-même, l'intensité varie en fonction des buts poursuivis, engendrant des vigilances "standard, simplifiée, renforcée", en fonction du risque sous-jacent. En outre, des droits interférents font varier l'obligation, notamment la protection des droits à la protection des données personnelles, ou le droit à la non-immixtion du banquier. Enfin, interfèrent les obligations de vigilance pesant sur les tiers, y compris situés hors de l'Europe.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ph. Denis et N. Fabbe-Costes, "Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de cet article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une perspective de sciences de gestion, les auteurs replacent les lois successivement adoptées dans l'émergence du "développement durable" en matière environnementale, qui a façonné la façon de gérer les entreprises. Cela est venu d'une prise de conscience mondiale des "buts monumentaux" que constitue la préservation de la planète, reposant principalement sur les entreprises. Le changement n'est néanmoins opéré davantage sous la contrainte que d'une façon volontaire, des lois impératives relayant les pressions des parties prenantes.
Les auteurs montrent que les entreprises y ont réagi en intégrant les buts imposés mais n'ont pas pu suivre jusqu'au bout de telles ambitions, faute notamment de comprendre les réglementations très complexes, relayées par des responsabilités pénales et civiles. Les recherches croisant le Droit et la Gestion ont vocation à faciliter en pratique cette mise en oeuvre.
_________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : V. Magnier, "Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe les tensions provoquées par le Droit de la Compliance et l'Obligation de Vigilance sur la gouvernance des entreprises.
La loi dite "Sapin 2" vise la corruption, la loi dite "Vigilance" a un champ plus vaste quant aux risques et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il est logique que cela crée des tensions sur la gouvernance tant les objectifs sont monumentaux, les entreprises devant s'approprier la délégation qui leur est ainsi faite, ce qui implique de repenser leur gouvernance et la façon d'exercer les mandats sociaux, l'intérêt social, boussole pour le juge, devant se conjuguer avec l'adoption de nouvelles normes de comportement formalisées volontairement par des chartes éthiques conformes aux standards internationaux. Sur cette base volontaire et encadrée, l'entreprise doit adapter sa structure puis contractualiser ces normes.
Cette démarche éthique a un impact sur le rôle des organes sociaux, non seulement la transparence ou la hiérarchisation des risques, mais d'une façon proactive l'adoption d'engagements dont la sincérité sera contrôlée, ce que traduisent par exemple les codes de gouvernances (cf. AFEP-MEDEF), la mise en place de comités ad hoc et la présence des parties prenantes avec une consultation dans l'élaboration du plan de vigilance.
Elle souligne que cela crée des tensions, que le dialogue est difficile, que le secret des affaires doit être préservé, mais qu'il faut faire des parties prenantes des vigies de la Vigilance, rôle qui ne doit pas être laissé aux seules autorités publiques.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégrale pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeur Marie-Anne Frison-Roche
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Dubin, "Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises. D’un processus de vigilance à la consécration d’un standard de responsabilité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure se concentre sur la notion de "diligences raisonnables des entreprises multinationales" telle qu'elle ressort des textes de Droit international public, à savoir les Principes directeurs de l'ONU et de l'OCDE. Elle considère qu'il faut partir de cette notion de "diligence raisonnable" qui impose un comportement non seulement aux Etats mais encore aux entreprises qui "s'auto-responsabilisent", mouvement s'exprimant par une "vigilance raisonnable pour ne pas nuire à autrui". Il existe donc un standard de comportement, celui qui interdit de nuire à autrui, puisqu'il y a un devoir de prendre soin d'autrui, ce qui "se révèle" in concreto dans les différents ordres juridiques. L'auteur pose que c'est le rôle de la responsabilité civile (et donc des juges) que d'opérer cette révélation en y attachant des obligations secondaires
Pour l'auteur, à cette aune la "compliance" n'est qu'une doxa qui accroît la domination des entreprises et il convient d'adopter plutôt la perspective susvisée du Droit international public, qui doit être reprise directement par les lois internes, la directive européenne et les jurisprudences nouvelles élaborées par les juges. L'auteure est d'autant plus hostile à la Compliance et à son lien avec la Vigilance en ce qu'il permet des exonérations d'une responsabilité qui doit être au contraire accrue, puisque la responsabilité (liability), doit s'articuler aux comptes à rendre (accountability) du devoir moral (duty of care) qui est celui des entreprises multinationales.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A.-V. Le Fur, "Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre que le Droit des sociétés et des marchés financiers est en train d'être transformé en profondeur par le Droit de la Compliance. Par une succession de textes un mouvement de fond a transformé ces deux branches du Droit, par ailleurs corrélées.
L'auteure situe la première perception de ce mouvement interne au Droit des sociétés dans la loi NRE, pour décrire ensuite les lois sur l'information des associés, des investisseurs et des parties prenantes. Elle a insiste sur la loi dite "Pacte", qui changea la conception même de ce qu'est une société au regard de ce qu'est une entreprise. Cela est indissociable des lois et des jurisprudences que l'on associe davantage au Droit de la Compliance, notamment la loi dite "Sapin 2" et la loi dite "Vigilance", les textes de directives poursuivant cette transformation si profonde.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. J. Martin, "Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur se consacre à ce qui est souvent désigné comme les "clauses RSE" en ce qu'elles constituent une façon pour les entreprises de mettre en oeuvre leur Obligation de Compliance. Dans une pratique encore "balbutiante", les entreprises contractualisent ainsi leur aspiration éthique et leur obligation légale, définissant au passage plus précisément ce qu'est pour elle l'obligation de compliance et/ou de vigilance, notamment par des référentiels internes ou/et externes, en y associant des mécanismes d'évaluation, d'audit et de sanctions spécifiques, comme la résiliation.
En outre, le contrat organise l'articulation avec des clauses commerciales ayant un autre objet, Cela est d'autant plus requis que l'objet de ces clauses est aussi de "faire ruisseler" l'obligation légale au-delà du premier cercle contractuel. Le risque de déséquilibre devra être évité. Les clauses devront être précises et limitées, notamment au regard de l'espace et du temps.
Dans un second temps, l'auteur examine l'articulation du Droit commun des contrats et du Droit spécial de la Vigilance. En effet, après avoir posé que le contrat soit le moyen, et même le seul moyen, de transformer la soft Law en hard Law dans les relations entre les parties contractantes, l'auteur estime que si une telle clause figure dans un contrat commercial figurant dans une situation visée par la lo de 2017 (chaine de valeur, rapport société-mère et filiale) il y a cumul de qualités. Il en naît donc des conflits de compétence avec le Tribunal judiciaire de Paris et l'on peut regretter l'abandon de la solution retenue par la Cour de cassation ouvrant une option de compétence.
Une autre articulation difficile devra être faite en cas de nullité de la clause RSE, annulation que le juge de droit commun peut prononcer, suivant qu'elle sera estimée par le juge déterminante ou non d'autres clauses, voire du contrat. En cas d'inexécution de la clause, la rupture des relations commerciales peut être prononcée, mais l'on peut penser qu'un préavis doit être respecté.
Enfin si l'objet même du contrat est l'exécution de l'obligation de vigilance, il faut que cela n'équivaille pas à une délégation qui anéantirait le principe légal d'une responsabilité personnelle.
_________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Séjean, "La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : La contribution confronte la définition générale donnée par Marie-Anne Frison-Roche avec la spécificité du monde de la cybersécurité, de ses réglementations et des principes qui le régissent.
Reprenant tous les éléments de cette définition générale, selon laquelle l'Obligation de Compliance consiste pour l'assujetti à "construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", l'auteur montre qu'au-delà des spécificités des règles de la cybersécurité, cela correspond en pratique et dans chacun des éléments de cette définition, confronté aux différents éléments qui constitue ce qui est requis en matière de cybersécurité, à ce qui est techniquement demandé aux entités et personnes concernées en matière de cybersécurité, qui est effectivement pensé en ces termes.
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Mekki, "Peut-on repenser la responsabilité à l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancée de la Compliance ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe les tensions que l'Obligation de Vigilance engendre sur le concept même de responsabilité. Répertoriant toutes les manifestations, très diverses, de la Vigilance, selon les domaines, il observe que se forme une logique téléologique de prévention et de gestion des risques systémiques, ce qu'est la compliance, sans doute remède à un État impuissant, s'appuyant sur une grande pluralité des normes.
La question est de savoir si l'on peut passer de ces droits spéciaux mais d'un esprit commun à un droit commun transformé. Les premières décisions rendues à propos de la loi de 2017 répondent par la négative, mais la question est ouverte.
Il faut alors revenir sur le concept même de responsabilité, qui pourrait accueillir un mécanisme général de Vigilance. Ce concept est très flexible et présente l'adaptabilité requise pour accueillir la logique de compliance. En effet, la responsabilité, classiquement ex post peut passer ex ante, à travers la notion de dette, non plus juridique mais éthique, car les entreprises doivent être "dignes de confiance".
La responsabilité préventive vise alors à restaurer l'équilibre des systèmes dans la poursuite des Buts Monumentaux, pour l'efficacité et l'efficience des systèmes. La responsabilité se mixte de subjectivité et d'objectivité, le risque devenant central (par rapport à la faute), le litige dépassant l'intérêt des parties, la remédiation devenant le sujet central dans un procès en responsabilité à repenser : le dialogue doit y être au centre, entre les juridictions, entre les entreprises et les parties prenantes, dans un office du juge adapté.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Frydman & A. Briegleb, "L'obligation de compliance en droit global", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié.
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les auteurs soulignent que le Droit des obligations, c'est-à-dire le Droit des contrats et de la responsabilité civile est essentiel dans le Droit de la compliance, notamment dans sa perspective de Droit global, puisqu'il dépasse le Droit des États et développe de nouvelles normativités, à l'échelle de chaque entreprise mais permet aussi une nouvelle expression de la puissance publique à travers les buts monumentaux que le Droit de la compliance prétend globalement atteindre. Plus les Etats seront de fait faible et plus la délégation sera forte vers le premier niveau.
Les auteurs examinent concrètement une série de situation dans lesquels divers organismes utilisent les techniques de compliance pour s'approprier un pouvoir global sur des choses ou des personnes, ce qui a pour effet, parfois pour objet, de réduire les libertés des personnes ainsi contrôlées. Ainsi la RSE, au départ non contraignante, est aujourd'hui la source d'obligations contraignantes, l'obligation morale exprimée dans les codes de conduite pouvant même devenir obligation civile (cas Nike de 2002).
Par ailleurs, les clauses "Comply or Explain" sont désormais courantes, permettant à la personne assujettie de ne pas se conformer si elle s'en justifie, ce qui est la base des multiples rapports d'information que doivent désormais émettre les entreprises.
Puis, reprenant la perspective de la responsabilité, notamment dans l'espace numérique, l'article souligne l'importance de "l'immunité conditionnelle de responsabilité", considérant à partir du DSA que l'irresponsabilité de certains opérateurs, comme les hébergeurs, ne leur est donnée que parce qu'ils prennent en charge des obligations, par exemple des fonctions de contrôle.
Enfin, concernant le devoir de vigilance, il tend pour la première fois à calquer l'ampleur de "responsabilité" sur l'ampleur du "pouvoir", la responsabilité morale devenant donc une responsabilité juridique, qui serait comme une nouvelle responsabilité pour autrui.
Il résulte de tout cela dans ces cas considérés une "obligation de réguler autrui".
________

29 août 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août 2025.
____
📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru ultérieurement au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR - Droit de la compliance :
►Voir les présentations des chroniques précédentes :
- "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", 2024.
- "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023
- "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022
- "L'aventure de la Compliance", 2020
- "Compliance et personnalité", 2019
____
► Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).
De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier. Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.
Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).
____
🔓lire les développements ci-dessous⤵️

15 août 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025.
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025.
____
📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra remis et publiés en octobre 2026.
____
► Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.
La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.
Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Mise à jour : 25 juillet 2025 (Rédaction initiale : 6 mars 2024 )
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024.
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024.
____
📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in📕L'Obligation de Compliance,
____
► Résumé du document de travail : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen).
Plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
___
🔓lire les développements ci-dessous⤵️📎
Ce document de travail reproduit en note pop-up les textes législatifs et réglementaires, ce qui n'est pas fait dans le document publié.
2 juillet 2025
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie", intervention conclusive, in Rencontres de la Haute Autorité de l'Audit (H2A), 2025, Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives,H2A, 2 juillet 2025, La Défense, 13h-18h
____
Les rencontres qui se déroulent en présentiel et sont traduites en simultanées débutent par une présentation de Florence Peybernès, présidente du H2A.
Elle est suivie de 3 tables-rondes :
🪑🪑🪑Table ronde 1 : Retours sur les premières nominations
🪑🪑🪑Table ronde 2 : Regards croisés entre préparateurs, vérificateurs et parties prenantes
🪑🪑🪑Table ronde 3 : Perspectives de la CSRD
C'est à la suite de cela que la perspective, plus juridique, plus judiciaire, dans une articulation entre l'Ex Ante et l'Ex Post, va se situer.
____
► Résumé de l'intervention, telle que préparée : Au regard des informations disponibles lors de la préparation pour cette manifestation, de l'intérêt considérable suscité par la CSRD, de sa contestation aussi, qui mena à sa modification, est-ce contre-intuitif par rapport à la technicité des propos, aux flots de critiques et au nombre de pages que l'on lit, à l'impression du poids, des contraintes et de l'inutilité de la chose qui priverait les entreprises de leur liberté, mais ce qui ressort plutôt c'est la Simplicité. Pourquoi : parce que le rapport de durabilité n'est qu'un outil et c'est le but qu'il sert qu'il faut regarder, (c’est comme cela que le Juge le regarder), outil qui sert une stratégie de l’Europe C’est cette stratégie qu'il faut cerner, et l'entreprise y a sa libre part. Ce qu'on demande à l'entreprise dans sa contribution à un but qui est simple, contribution dont elle peut, dans une information il est vrai normée, dessiner les contours
Temps long et stratégie,. Les investisseurs et les parties prenantes n’y sont pas hostiles : l’essentiel est alors la crédibilité des informations rendues disponibles. Car le Temps long met l’avenir au centre, et on ne le connait pas. Cet élément essentiel, que les tribunaux rappelèrent à propos de la vigilance, doit aussi être garder à l'esprit, car il s'agit avant d'informer sur le futur.
Pour exprimer les informations qu'elles veulent donner à ce propos, les entreprises doivent comprendre les buts du plan européen (là où est la simplicité), pour y ajuster leur propre plan (sous le terme qui leur est plus familier de « stratégie ») les conseils doivent les aider à cela ; mêler leurs stratégies à la stratégie européenne, s'appuyer sur les autorités et les auditeurs pour que ce qu'elles disent soit crédible. La crédibilité est le cœur, c’est pourquoi les auditeurs sont au cœur.
Car la seule obligation qu'elles ont, c'est de dire. Pas de faire. Il ne faut pas interpréter la CSRD comme produisant à la charge des entreprises assujetties des obligations de faire (telles que les obligations de vigilance les génèrent), la CSRD n'engendrent à leur endroit qu'une obligation de dire. Certes lourdes, certes normées, certes certifiée, mais pas d’obligation de faire et de dire avant tout ce qui une stratégie qui est propre à l’entreprise, stratégie dont l’entreprise demeure maîtresse. En cela, bien que normée, l'information est libre et c'est la crédibilité de l'information qui est cruciale, mais pas une participation à un plan dont les termes seraient écrits par les Autorités ou les parties prenantes.
C'est pourquoi après avoir appris des uns et des autres, il apparait trois choses assez simples qui soient parfois ensevelies sous la complication des détails accumulés et de la violences des arguments échangés. Trois éléments qui seront développés en conclusion des échanges.
La première est la simplicité du fil d'Ariane de l'information crédible accessible imposée par l'Union européenne pour concrétiser le Pacte vert. Les divers Régulateurs tiennent notamment ce fil d'Ariane.
La deuxième est l'existence d'une seule et simple obligation de l'entreprise : dire ce qu'elle a fait, faite et envisage de faire, sans être obligée de faire dans le Plan d'action européen ( la CRSD n'enrôle pas de force les entreprises dans le plan d'action). Cette limitation à une obligation de dire est essentielle. Son articulation avec des obligations de faire, issues notamment de textes sur la vigilance, voire des identités de termes, ne doit pas conduire à des confusions dans les qualifications.
La troisième est le profit que l'entreprise tient de l'articulation d'une double "stratégie singulière" : celle de l'Union européenne qui veut bâtir son avenir, stratégie de l'Union à laquelle elle est libre de contribuer ou de ne pas contribuer et celle de sa propre stratégie qui s'articule à la première et dans laquelle le vert fait place à bien d'autres couleurs selon la volonté de l'entreprise.
► Résumé de l'intervention, telle que faite au regard des propos tenus lors des 3 tables-rondes : Lors de la manifestation proprement dite, j'ai préféré me situer plutôt dans le prolongement direct de ce qui avait été dit. Cela a justifié dans le quart d'heure attribué de ne pas procéder ainsi mais de mettre en lumière d'une part que plus tard ce qui est ressorti, c'est-à-dire tous les efforts, les incertitudes, les tâtonnements et la bonne volonté qui ont marqué l'élaboration des premiers rapports de durabilité, risquent d'être gommés car rétrospectivement dans 2 ans, ou dans 5 ans, notamment à l'occasion d'un procès, on aura l'impression que tout allait de soi, que l'on savait tout, que tout était clair et décidé. Et c'est à ce futur-là, qui est celui du juge, saisi par une partie prenante, un régulateur, un procureur, qui prend toujours le passé pour certain, qu'il faut penser. C'est alors en terme de preuves qu'il faut penser. En preuves de l'incertitude. Et toujours penser que le rapport de durabilité est lui-aussi une preuve. Qui alimentera des actions en responsabilité, dans des litiges autour de l'information, etc.
Plus encore, parce que le report de durabilité n'est qu'un outil, pour une stratégie, qui est une stratégie d'ensemble, où la CSRD n'est qu'un élément du puzzle, des éléments du rapport de durabilité peuvent être pris pour être utilisés plus tard pour alimenter d'autres documents et rapports, et d'autres litiges. Cela est notamment le cas du plan de vigilance, puisque la cartographie des risques est souvent commune au rapport de durabilité et au plan de vigilance, ce qui est logique puisque la CSRD et la CS3D se font miroir dans le grand plan d'action de l'Union que constitue le Pacte vert. Mais cela est amplifié par les entreprises, qui parfois confondent l'un et l'autre, dans la présentation même au sein du rapport de gestion. Il est pourtant essentielle de distinguer nettement l'obligation de dire (rapport de durabilité) et l'obligation de faire (plan de vigilance). L'ambiguïté des "engagements" accroît cela. Il est essentiel de veiller à un travail ex ante entre expert de la gestion, de la finance, de l'audit et du droit pour éviter que les points de contact ne se transforment en confusions, maintenant et /ou plus tard, confusions qui pourraient être préjudiciables à tous.
________

26 juin 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
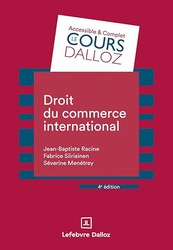
► Référence complète : J.B. Racine, F. Siiriairnen, S. Menétrey, Droit du commerce international, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 4ière éd., 2025, 410 p.
____
► Présentation de ce Cours : Ce Cours expose toutes les règles particulières du commerce international (vente, transport, distribution, etc.). Le droit du commerce international est devenu une discipline mise au cœur du processus de mondialisation de l'économie. Elle est donc en pleine expansion. Ce n'est pas seulement une branche du droit international privé.
Le droit du commerce international présente une autonomie certaine par son esprit, ses méthodes et son objet. Les sources de ce droit sont particulières dans la mesure où il fait la part belle aux usages du commerce international, plus généralement désignés sous l'appellation de lex mercatoria. Les acteurs du commerce international sont variés : il s'agit bien entendu des sociétés mais aussi des États . Le particularisme du droit du commerce international se situe aussi au stade des opérations du commerce international : la vente, le transport, la distribution, etc. obéissent à des règles particulières, le plus souvent des règles matérielles de source internationale. Enfin, l'importance et l'originalité du droit du commerce international se manifestent dans le recours à l'arbitrage. En tant que justice privée, l'arbitrage est aujourd'hui devenu le mode de résolution de droit commun des litiges du commerce international.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants qui découvrent la matière ainsi qu'aux universitaires et praticiens. Il allie connaissances théoriques et orientations pratiques. Il ouvre sur une vision différente du droit, c'est-à-dire un droit partiellement dissocié de l'État. Il met aussi l'accent sur la nécessité de bâtir un droit répondant aux défis de la mondialisation.
____
📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié
____
📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :
🕴️B. Haftel, 📕Droit international privé
🕴️D. Mainguy, 📕Contrats spéciaux
________
25 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Bauch, Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Thèse Université Toulouse Capitole 2025, 492 pages dactyl.
____
soutenue le 25 juin 2025.
🪑🪑🪑Membres du jury :
🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse
🕴🏻Sandrine Tisseyre, professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure
🕴🏻Philippe Weller, professeure à l'Université d'Heidelberg, rapporteur
🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🕴🏻Marie-Anne Frison-Roche
____
► Présentation de la thèse

25 juin 2025
Enseignements : Participation à des jurys de thèses

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Annika Bauch, Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Université de Toulouse, 5 juin 2025, 14h-17h.
____
🪑🪑🪑Autres membres du jury :
🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse
🕴🏻Sandrine Tisseyre, professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure
🕴🏻Marc-Philippe Weller, professeure à l'Université d'Heidelberg
🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
____
► Présentation de la thèse : La thèse s'appuie sur des travaux français, américains et allemande. Elle est construite sur deux perspectives.
La première partie de la thèse décrit la façon dont le droit de l'entreprise nourrit la compliance, puisque c'est au sein du droit des entreprises (et plus particulièrement des sociétés et des organes sociétaires que la compliance, que l'auteur estime être venue des Etats-Unis, a transformé la façon dont les entreprises doivent être gérées, devant prendre en compte la dimension extrafinancière de l'activité, ce qui modifie la notion même d'intérêt social et conduit à intégrer les parties prenantes dans le fonctionnement sociétal.
La seconde partie de la thèse porte sur la façon dont la compliance a ainsi transformé le droit de l'entreprise puisqu'elle lui a apporté des exigences nouvelles, comme la considération des risques, les mécanismes de régulation et les soucis éthiques, l'entreprise devenant alors elle-même un vecteur de compliance. Cela s'opère notamment par des clauses de compliance insérées dans les contrats, qui est un outil adéquat mais néanmoins limité pour ce faire.
____
Au terme de la soutenance, la candidate a été élevée au grade de Docteure en droit et a été informellement félicitée par son jury pour la qualité de son travail.
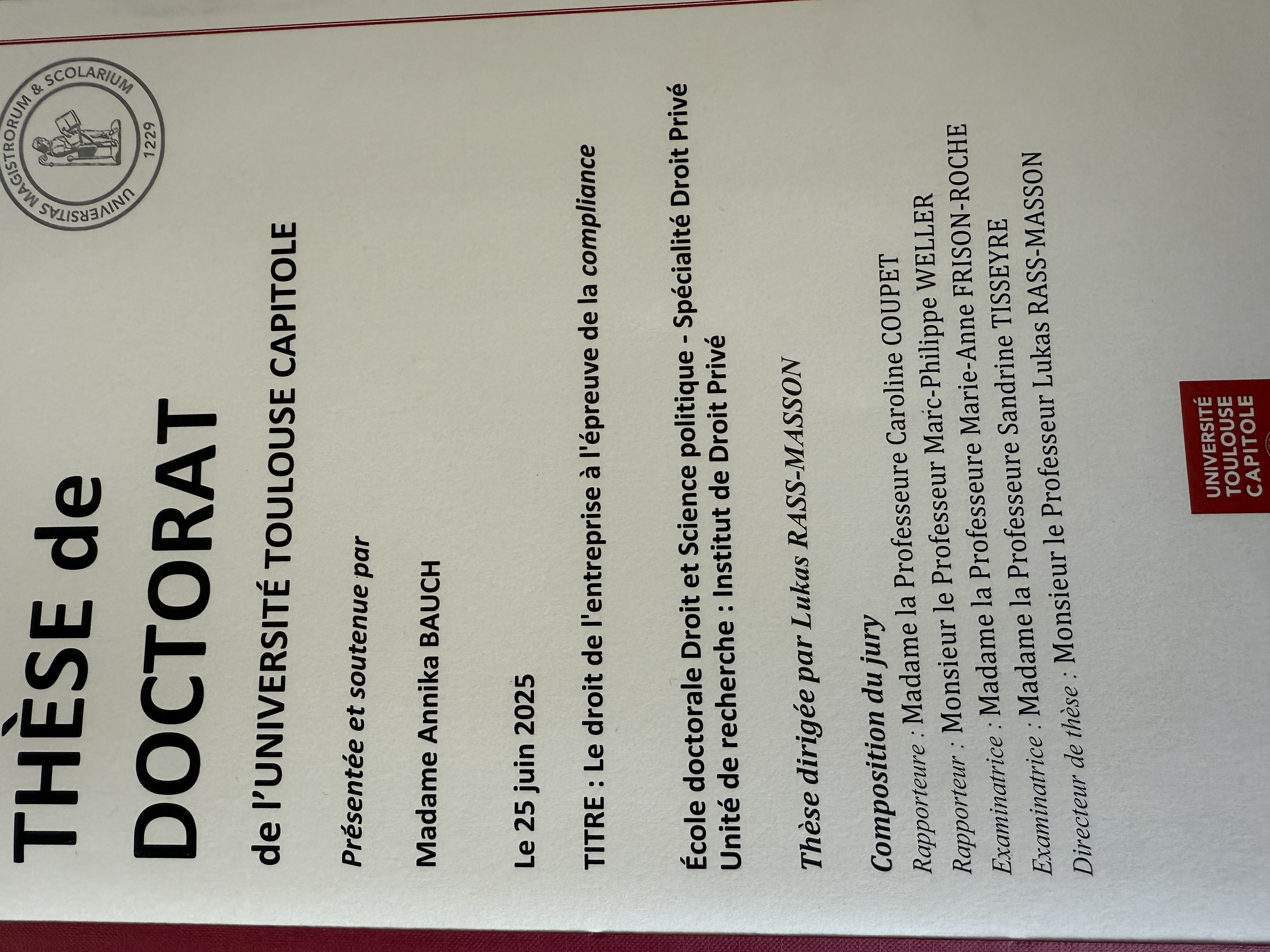
20 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Haut Comité Juridique de la Place de Paris, Les impacts juridiques et réglementaires de l'Intelligence Artificielle en matière bancaire, financière et des assurances, juin 2025.
_____
19 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Y. Broussole, "Professions libérales : vive les sociétés de participations pluri-professionnelles !", ActuJuridique, 19 juin 2025
____
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le décret est pris en application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Il fait suite aux cinq décrets du 14 août 2024 posant les conditions d’exercice en société des professions réglementées (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier de tribunal de commerce et avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation). Ces professions peuvent désormais constituer des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) pour exercer en commun leurs activités ou créer des sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles (SPFP).".
________
19 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. S. Erie, "Compliance in China, in China in compliance, Wiley, 2025.
____
► Résumé de l'article (par l'auteur) : Much of scholarly writing on compliance is derived from the experiences of Western multi- national corporations operating in developed economies. This introduction to the special issue “China in Compliance” departs from such convention by asking how compliance works in China. By broadening the scope of compliance studies to include non- Western contexts, including China and its relationship to the “Global South” and nondemocratic settings, the special issue breaks new ground in the empirical analysis of compliance industries, practices, and professionals. The special issue is comprised of seven articles that illustrate specific compliance problems for compliance in Chinese overseas direct investment. This introduction first provides a detailed overview of the growth of domestic corporate compliance in China over the last several years and then puts this growth in the context of Chinese companies engaging in overseas projects. It subsequently gives a roadmap of the articles and highlights their key themes and findings. The broader goal is to provide a conceptual foundation for the comparative study of compliance.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________