Matières à Réflexions
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Une Banque centrale est pour le Droit un objet assez mystérieux.
Malgré ce qu'ont pu en dire certaines autorités de concurrence, il ne s'agit pas d'une banque ordinaire. Elle est à la source de la création monétaire et a pour mission première de lutter contre l'inflation, concourant plus ou moins directement et d'une façon plus ou moins indépendante suivant les systèmes politiques et juridiques à la politique économique menée par les gouvernements.
Ainsi, si les Banques centrales ont toutes une statut constitutionnel qui leur garantit une autonomie, elles ont une mission plus limitée en Europe qu'aux États-Unis. Cela est encore plus net depuis que, la création monétaire exprimant le régalien, ce pouvoir a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend plus nécessaire encore une interprétation restrictive de ce que peut faire cette Banque centrale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015 à propos des programmes de politique monétaire non-conventionnels de la BCE.
Les Banquiers centraux ont, soit directement par un département, soit indirectement par une Autorité administrative indépendante (AAI) qui leur est adossée et qui, tout en étant indépendante, n'a pourtant pas la personnalité morale à leur égard (système français concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) exerce sur le secteur bancaire et des assurances un pouvoir de régulation et de supervision.
A ce titre, ils sont régulateurs. Lorsque le pouvoir de créer de la monnaie leur a été ôtée, comme cela est le cas dans les États-membres de la zone Euro, c'est ce pouvoir de régulation et de supervision qui leur demeure propre, leur activité en matière de monnaie consistant à participer au mécanisme collectif européen.
Pour exercer sa mission de régulation et de supervision, les Banquiers centraux disposent de pouvoirs considérables, notamment d'agrément, de sanction et depuis 2013 et 2014, de résolution. Mais en cela, il faut considérer que, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les Banquiers centraux sont comme des tribunaux et dans l'exercice de nombreux pouvoirs, les garanties de procédures doivent être conférés aux opérateurs qui font l'objet de ces pouvoirs-là.
Base Documentaire : Doctrine
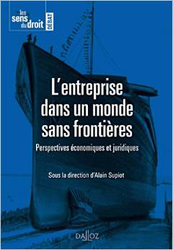
► Référence complète : S. Manacorda, "La dynamique des programmes de conformité des entreprises : déclin ou transfiguration du droit pénal des affaires ?", in A. Supiot (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. "Les sens du droit", Dalloz, 2015, p. 191-208.
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


Sur un marché ordinaire de biens et service, l'accès au marché est ouvert à tous, qu'il s'agisse de celui qui offre le bien ou le service (potentiel offreur) ou de celui qui désire se l'approprier (potentiel demandeur). La liberté de la concurrence suppose que ces nouveaux entrants puissent à leur volonté devenir des agents effectifs sur le marché, le potentiel offreur si son dynamisme entrepreneurial l'y pousse, et le potentiel demandeur s'il en a le désir et les moyens (pécuniaires, d'information et de proximité, notamment). L'absence de barrière à l'entrée est présumée ; une barrière résultant d'un comportement anticoncurrentiel sera sanctionnée ex post par l'autorité de concurrence.
La barrière est donc ce qui contrarie le principe d'accès au marché. C'est pourquoi l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en ce qu'elle lutte contre les barrières pour assurer un libre-échange mondial, peut être considérée comme un précurseur d'une Autorité mondiale de la concurrence.
Mais il peut arriver qu'il soit nécessaire d'organiser par la force du Droit un accès, non seulement parce qu'il y a eu une décision de libéralisation un secteur naguère monopolistique, l'accès ne pouvant pas s'exercer par la seule force de la demande et par la seule puissance des potentiels nouveaux entrants, notamment par la puissance de fait des entreprises présentes anciennement monopolistiques. L'Autorité de régulation va construire les accès à des marchés sectoriels dont le seul principe du fonctionnement concurrentiel a été déclaré par le Droit. Cette nécessité peut aussi résulter de phénomènes entravant définitivement ce fonctionnement concurrentiel idéal, comme des monopoles naturels ou des asymétries d'information : le Droit va concrétiser cet accès en distribuant aux parties intéressées des droits subjectifs d'accès.
Il en est ainsi des droits d'accès des opérateurs aux réseaux d'infrastructure essentielle. Même si cet acte s'opère par contrat, celui-ci ne fait que concrétiser un droit subjectif d'accès conféré par la Loi à l'opérateur pour qu'il puisse pénétrer le marché. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.
D'une façon plus politique et sans rapport direct avec une volonté d'installer la concurrence ou de pallier une défaillance de marché, cette organisation des accès peut encore être requise parce qu'il existe une décision politique d'assurer à chacun un accès à des biens communs. La décision jouxte alors la notion de "droit fondamental", par exemple le droit fondamental d'accès au système de soins ou aux médicaments vitaux, ou le droit fondamental d'accès au système numérique, droit subjectif dont le Régulateur devient le gardien à la fois en Ex Ante et en Ex Post.
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi.
S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible.
Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière.
____
Voir le plan ci-dessous⤵
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie la personne sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
Alors que les droits de la défense sont des droits subjectifs qui sont des avantages données à la personne risquant de voir sa situation affectée par la décision que l'organe qui est formellement ou fonctionnellement qualifiée juridiquement comme étant un "tribunal", peut prendre, le principe du contradictoire est plutôt un principe d'organisation de la procédure, dont la personne peut tirer profit.
Ce principe, comme le terme l'indique, est - comme le sont les droits de la défense - de nature à engendre tous les mécanismes techniques qui le servent, y compris dans le silence des textes, impliquent une interprétation large de ceux-ci.
Le principe du contradictoire implique que le débat entre tous les arguments, notamment toutes les interprétations possibles, soit possible. C'est à titre exceptionnel et justifié, par exemple en raison de l'urgence ou d'une exigence justifiée de secret (secret professionnel, secret de la vie privée, secret industriel, secret défense, etc.) que le mécanisme contradictoire est écartée, parfois pendant un temps seulement (technique du contentieux différé par l'admission de la procédure sur requête).
Cette participation au débat doit être pleinement possible au débatteur, notamment l'accès au dossier, la connaissance de l'existence de l'instance, l'intelligibilité des termes du débat, non seulement les faits, mais encore la langue (traducteur, avocat, intelligibilité du propos), mais encore discussion sur les règles de droit applicables). Ainsi lorsque le tribunal relève d'office des règles de droit, il doit les soumettre au débat contradictoire avant d'en faire éventuellement application.
L'application du principe du contradictoire croise souvent les droits de la défense, mais en ce qu'il est lié à la notion de débat, il se développe d'autant plus que la procédure est de type accusatoire.
Enseignements : Droit commun de la Régulation
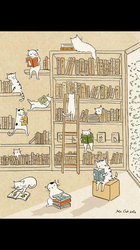
Retourner à la présentation générale du Cours.
Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :
- Doctrine (par ordre alphabétique), la présentation distinguant quelques ouvrages généraux avant de répertorie des études pertinentes pour comprendre le "Droit commun de la Régulation"
- Textes de droit international, textes de systèmes juridiques étrangers,textes de l'Union européennes, textes de droit français
- Littérature grise
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Obligation de Compliance et droits humains", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié.
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur se demande si les droits humains peuvent, au-delà des multiples obligations de compliance, fonder l'Obligation de Compliance. La considération de ceux-ci correspond à la fondamentalisation du Droit, traversant aussi bien le Droit privé que le Droit public et sont considérés par certains comme la matrice de beaucoup de mécanismes juridiques, y compris internationaux. Ils prescrivent des valeurs qui peuvent ainsi se diffuser.
Les droits humains rencontrent directement la compliance dès l'instant que l'on définit celle-ci comme « l’internalisation dans certains opérateurs de l’obligation de se structurer pour concrétiser des buts qui ne leur sont pas naturels, buts qui sont fixés par des autorités publiques qui ont en charge le futur des groupes sociaux, buts que ces entreprises doivent de gré ou de force viser à concrétiser, du seul fait qu’elles sont en position de les atteindre ». Ces "buts monumentaux" convergent vers les êtres humains, et donc la protection de leurs droits grâce aux entreprises.
Dans un contexte mondialisé, l'Etat peut soit agir par une réglementation impérative, soit ne rien faire, soit obliger les entreprises à agir par le Droit de la Compliance. Pour que cela soit effectif, il faut des outils permettant une prise en charge Ex Ante par les opérateurs "cruciaux", ce qu'illustre notamment la loi sur le devoir de vigilance.
Cette obligation se concrétise à la fois comme une obligation légale, ce qui renvoie à un sens un peu imprécis, que l'on retrouve par exemple dans le devoir de vigilance, et dans un sens plus technique à travers un rapport d'obligation que l'entreprise établit, notamment par des contrats.
Les obligations légales se justifient en ce que la protection des droits humains relève en premier lieu des Etats, notamment dans l'espace international. Même s'il ne s'agit que de droit souple, à portée non contraignante, on retrouve cette tendance dans les principes Ruggie qui dépassent l'obligation des Etats de ne pas porter atteinte aux droits humains pour passer à une obligation positive de les protéger effectivement. La question de savoir si cela pourrait s'appliquer non seulement aux Etats mais encore aux entreprises est extrêmement débattue. Si l'on se rapporte à la sentence CIRDI Urbaser c. Argentine de 2016, les arbitres ont admis une obligation pour l'entreprise ne pas porter atteinte aux droits humains mais rejeté une obligation de les protéger effectivement. En Droit européen, les RGPD, DSA et AIA, et en France la loi dite Vigilance utilisent les outils de compliance, souvent de Compliance by design, pour protéger en Ex Ante les droits humains.
Les contrats, notamment par l'insertion de multiples clauses dans des contrats souvent internationaux , expriment la "privatisation" des droits humains. Il conviendrait de veiller à y associer des sanctions adéquates et à ne pas donner prises à des situations de déséquilibre contractuel. Le rapport d'obligation délictuel oblige à articuler la logique Ex Ante et la logique Ex Post et de concevoir ce que le juge peut ordonner.
L'auteur conclut que "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational".
________
Enseignements : Droit de la Compliance

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur la compliance, à travers différentes matières ou différentes branches du droit, en droit français ou en droit étranger et supra national ayant une influence directe, de sorte que l'on puisse comprendre ce qui en résulte en droit français.
Elle est composée de documents de doctrine (ouvrages et articles), des textes législatifs ou réglementaires applicables en France et dans d'autres pays (et, le cas échéant, des projets de lois ou de règlements), ainsi que de documents de littérature grise.
Il peut être pertinent de croiser cette bibliographie avec la Bibliographie plus large relative au Droit commun de la Régulation, ou avec la Bibliographie relative au Droit de la Régulation bancaire et financière.
Consulter la bibliographie ci-dessous.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").
Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.
Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.
Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

En principe, l'exercice constituant le contrôle final de connaissance à la fin du semestre est, au choix de l'étudiant, soit une dissertation, soit une note de synthèse. L'étudiant dispose de trois heures pour faire l'exercice dans une copie, dont le volume ne doit pas dépasser 6 pages.
Jusqu'en 2017 un exercice de mi- semestre se déroulait, de structure identique à celui de fin de semestre, permettant aux étudiants de se préparer à celui-ci. Depuis 2017 la direction de l'Ecole a désiré qu'il n'y ait plus un tel galop d'essai organisé. Dans un même souci de simplification, l'exercice de commentaire de texte en a été éliminé. La possibilité de proposer un choix entre deux dissertations a été exclue.
Les copies sont corrigées par l'ensemble de l'équipe pédagogique, professeur d'amphi et maîtres de conférences. Un contrôle supplémentaire est assuré selon les modalités générales de l'Ecole.
La situation sanitaire qui marqua l'année 2021 avait justifié qu'un autre système de contrôle de connaissance soit adopté. C'est pourquoi l'examen final avait été pour cette année supprimé, remplacé par une dissertation à faire en parallèle du cours et des conférences. L'étudiant avait à choisir entre deux sujets, élaborés en équipe par Marie-Anne Frison-Roche, pour faire une dissertation. Les sujets avaient été proposés à la m-semestre et les copies devaient être restituées à l'administration à la fin du semestre pour être corrigées par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Parce qu'il ne s'agit donc pas d'une épreuve de vitesse, il n'avait pas été proposé d'exercice pratique.
L'année 2022 permettant un retour à davantage de normalité, un retour a été possible vers un examen final en présentiel se déroule à la fin du semestre. Les principes n'en sont pas modifiés : il consiste , au choix de l'étudiant, dans soit une dissertation, soit une note de synthèse. L'étudiant dispose de trois heures pour faire l'exercice dans une copie, dont le volume ne doit pas dépasser 6 pages.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
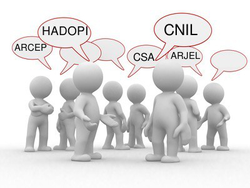
L'Autorité Administrative Indépendante (AAI) est la forme juridique que le Législateur a le plus souvent choisi pour établir des autorités de régulation. L'AAI est seulement sa forme juridique mais le système juridique continental, comme est le Droit français, allemand, italien, etc., y ont attaché une grande importance, suivant en cela la tradition formaliste du droit public. Les Autorités de régulation sont donc avant tout définies comme des autorités administratives indépendantes.
L’élément essentiel est dans le dernier adjectif : le caractère "indépendant" de l’organisme. Cela signifie que cet organe qui n’est pourtant qu’administratif, donc ayant vocation à être placé dans la hiérarchie l’exécutif, n’obéit pas au Gouvernement. En cela, on a très souvent présenté les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu’ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimé du Gouvernement. Cette indépendance pose également la difficulté de leur responsabilité, de la responsabilité de l’État du fait de leurs agissements, et de la reddition de compte (accountability) quant à l’usage qu’ils font de leurs pouvoirs. En outre, l’indépendance des régulateurs est parfois mise en doute si c’est le gouvernement qui conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l‘autorité de régulation. Enfin, l’autonomie budgétaire du régulateur est cruciale pour assurer son indépendance, les autorités ayant le privilège de bénéficier d’un budget -qui n’est pas inséré dans la LOLF- étant cependant très peu nombreuses. On les qualifie alors non plus d' "autorité administrative indépendante" mais d'Autorité Publique Indépendante", le Législateur faisant la distinction entre les deux (loi du 20 janvier 2017).
Le deuxième point concerne le second adjectif : à savoir qu’il s’agit d’un organe "administratif". Cela correspond à l’idée traditionnelle selon laquelle la régulation est le mécanisme par lequel l’État intervient dans l’économie, selon l’image d’une sorte de déconcentration des ministères, dans le modèle scandinave de l’agence. Si l’on se laisse enfermer dans ce vocabulaire, on en conclut que cet organisme administratif rend une décision administrative qui fait l’objet d’un recours devant un juge. Ainsi en premier lieu, il s’agirait d’un recours de premier instance et non pas d’un jugement puisque l’autorité administrative n’est pas un tribunal. En second lieu, le juge naturel du recours devrait être le juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision administrative rendue par une autorité administrative. Mais, l’Ordonnance du 1ier décembre 1986 sur la concurrence et la libéralisation des prix, parce qu’elle entendait précisément briser cette idée d’une économie administrée pour imposer la liberté des prix l’idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d’AAI soient portées devant la Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains grands auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d’appel de Paris était devenue une juridiction administrative. Mais aujourd’hui, le système procédural est devenu d’une extrême complexité car suivant les AAI et suivant les différentes sortes de décisions adoptées, elles relèvent d’un recours soit devant la Cour d’appel de Paris, soit devant le Conseil d'État. Si l’on observe les lois successives qui modifient le système, on constate qu’après cette grande position de principe de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, notamment dans la régulation financière. Doit-on par logique en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police administrative et à une économie administrée par l’État ?
Enfin, le troisième terme est le nom lui-même : « l’autorité ». Il signifie en premier lieu d'une entité dont le pouvoir tient avant dans son "autorité". Mais il marque qu'il n'est pas une juridiction, qu'il prend des décisions unilatérales. C’était sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le juge judiciaire ! En effet, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose que toute personne a droit à un tribunal impartial en matière civile et pénale. Or, la notion de « matière pénale » ne se coïncide pas avec la notion française formelle de droit pénal mais vise la notion factuelle, large et concrète, de répression. Ainsi, par un raisonnement qui va à rebours, un organisme, quelque soit la qualification qu’un État lui aura formellement conférée, qui a une activité de répression, agit "en matière pénale". De ce seul fait, au sens européen, il est un tribunal. Cela déclenche automatiquement une série de garanties fondamentales de procédure, au bénéfice de la personne qui risque d’être l’objet d’une décision de sa part. Une série de jurisprudence, aussi bien de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel a conforté cette juridictionnalisation des AAI.
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Terré, F., Concurrence et proportionnalité, in Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, pp.467-471.
____
Lire une présentation générale des Mélanges dans lesquels l'article a été publié.
____
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. d'Avout, "Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on recent applications in Europe", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur, traduit par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : In the absence of constraints derived from the real international law, vigilance-compliance laws themselves determine their scope of application in space. They do so generously, to the extent that they often converge on the same operators and 'overlap' on the world stage. The result is a hybridation of the law applicable to the definition of Compliance Obligations; a law possibly written "with four hands" or more, which is not always harmonious and which exposes unilateral legislators to occasional retouching their work and their applied regulations.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lalande, P.-A., Le pouvoir d’injonction au service de la réparation du préjudice écologique : une mise en œuvre de l’office du juge administratif en matière climatique, Actu-Juridique, 9 décembre 2021.
____
_____
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. d'Avout, La cohérence mondiale du droit, Cours général de droit international privé, Académie de droit international de La Haye, t.443, 2025, 692 p.
____
Base Documentaire : Doctrine
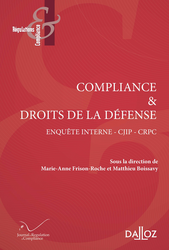
► Référence complète : S-M.. Cabon, "Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale", in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure définit la technique de "négociation" comme celle par laquelle "chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de coopération et de concessions mutuelles", ce qui va donc être utilisé dans la justice pénale française non pas tant par attraction du modèle américain, mais pour tenter de résoudre les difficultés engendrées par le flux des contentieux, le procédé s'étant élargi aux contentieux répressif, notamment devant les autorités administratives de régulation. Le principe en est donc la coopération du délinquant.
L'auteur souligne les satisfactions "pratiques" revendiqués, puisque les cas sont résolus, les sanctions sont acceptées, et les inquiétudes "théoriques", puisque des principes fondamentaux semblent écartés, comme les droits de la défense, l'affirmation étant faite comme quoi les avantages pratiques et le fait que rien n'oblige les entreprises à accepter les CJIP et les CRPC justifient que l'on ne s'arrête pas à ces considérations "théoriques".
L'article est donc construit sur la confrontation de "l'Utile" et du "Juste", parce que c'est ainsi que le système est présenté, l'utilité et le consentement étant notamment mis en valeur dans les lignes directrices des autorités publiques.
Face à cela, l'auteur examine la façon dont les textes continuent, ou pas, de protéger la personne qui risque d'être in fine sanctionnée, notamment dans les enquêtes et investigations, le fait qu'elle consente à renoncer à cette protection, notamment qu'elle apporte elle-même les éléments probatoires de ce qui sera la base de sa déclaration de culpabilité tandis que l'Autorité publique ne renonce pas encore au même moment à la poursuite étant problématique au regard du "Juste".
La seconde partie de l'article est donc consacrée à "l'Utile contraint à être Juste". A ce titre, l'auteur pense que l'indépendance du ministère public devrait être plus forte, à l'image de ce qu'est le Parquet européen, et le contrôle du juge judiciaire plus profond car la procédure actuelle de validation des CJIP semble régie par le principe dispositif, principe qui ne sied pas à la justice pénale.
________
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Grosclaude, "Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme", JCP Entreprise, n°49, déc. 2023, étude 1355.
____
🦉cet article est accessible aux personnes qui suivent les enseignements du professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "compliance" est l'exemple-type d'un problème de traduction.
En effet, le terme anglais "Compliance" est le plus souvent traduit par le terme français de "Conformité". Mais à lire les textes, notamment en Droit financier, la "conformité" vise plutôt les obligations professionnelles, visant principalement la déontologie et la conduite des professionnels de marché, notamment des prestataires de service d'investissement. C'est à la fois une définition plus nette dans ses contours (et en cela plus sûre) et moins ambitieuse que celle exprimée par la "compliance". Il est dès lors et pour l'instant plus prudent de conserver, même en langue française, l'expression de "Compliance".
La définition de la Compliance est à la fois contestée et très variable, puisque selon les auteurs, elle va des seules obligations professionnelles des intervenants des marchés financiers jusqu'à l'obligation à ceux qui y sont soumis de respecter les lois et règlements, c'est-à-dire l'obligation générale que nous avons tous de respecter le Droit. A les lire, la Compliance serait le Droit lui-même.
Vue du point de vue du Droit, la Compliance est un ensemble de principes, de règles, d'institutions et de décisions générales ou individuelles, corpus dont l'effectivité est le souci premier, dans l'espace et dans le temps afin des buts d'intérêt général visés par ces techniques rassemblées soient concrétisés.
La liste de ces buts, qu'ils soient négatifs ("lutter contre" : la corruption, le terrorisme, le détournement de fonds publics, le trafic de drogues, le trafic d'êtres humain, le trafic d'organe, le trafic de biens toxiques et contagieux - médicaments, produits financiers, etc.) ou positifs ("lutter pour" : l'accès de tous aux biens essentiels, la préservation de l'environnement, les droits fondamentaux des êtres humains, l'éducation, la paix, la transmission de la planète aux générations futures) montre qu'il s'agit de buts politiques.
Ces buts correspondent à la définition politique du Droit de la Régulation.
Ces buts politiques exigent des moyens qui excèdent les forces des États, par ailleurs enfermés dans leurs frontières.
Ces buts monumentaux ont donc été internalisés par les Autorités publiques dans des opérateurs globaux. Le Droit de la Compliance correspond à une structuration nouvelles de ces opérateurs globaux. Cela explique notamment que les lois nouvelles mettent en place des répressions non seulement objectives mais structurelles, comme le font en France les lois Sapin 2 (2016) ou établissant une obligation de vigilance (2017).
Cette internationalisation du Droit de la Régulation dans les entreprises implique que les Autorités publiques supervisent désormais celles-ci, même si celles-ci n'appartiennent pas à un secteur supervisé, ni même à un secteur régulé, mais par exemple participent au commerce international.
Le Droit de la Compliance exprime donc une volonté politique globale relayé par un Droit nouveau violent, le plus souvent répressif, sur les entreprises.
Mais il peut aussi exprimer de la part des opérateurs, notamment les "opérateurs cruciaux" une volonté propre d'avoir eux-mêmes souci de ces buts globaux monumentaux, qu'ils soient de nature négative ou positive. Cette dimension éthique, exprimée notamment par la Responsabilité Sociétale, est la continuation de l'esprit du service public et le souci de l'intérêt général, élevés mondialement.
29 mai 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).
But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).
In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).
Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).
________
29 mai 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026.
____
📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, a étépublié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
____
📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
- livres ultérieurs :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Evidential System, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance and Contrat, 2027
- livres précédents :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
____
► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
____
🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
____
► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
____
🏗️general construction of the book
The book opens with a substantial Introduction, putting the different sort of obligations of compliance in legal categories for showing that companies must build structures of compliance (obligation of result) and act to contribute with states and stakeholders to reach Monumental Goals (obligation of means).
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents the articulation of Compliance obligation with the other branchs of Law, because the specific obligation is built by Compliance Law, as new substantial branch of Law but also by many other branchs of Law.
The third part develops the pratical means established to obtained the Compliance Obligation to be effective, efficace and efficient.
The fourth part takes the Obligation of Vigilance as an illustration of all these considerations and the discussion about the future of this sparehead fo the Compliance Obligation .
The fifth part refers to the place and the role of the judges, natural characters for any obligation.
____
TABLE OF CONTENTS
ANCHORING THE SO DIVERSE COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THEIR NATURE, REGIMES AND FORCE TO BRING OUT THE VERY UNITY OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, MAKING IT COMPREHENSIBLE AND PRACTICABLE
🔹 Compliance Obligation: building a compliance structure that produces credible results withe regard to the Monumentals Goals targeted by the Legislator, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 🔹 Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 🔹 Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
Section 5 🔹 The definition of the Compliance Obligation in Cybersecurity, by 🕴️Michel Séjean
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 🔹 Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 🔹 Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH OTHER BRANCHES OF LAW
Section 1 🔹 Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 🔹 General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 🔹 Transformation of Governance and Vigilance Obligation, by 🕴️Véronique Magnier
Section 5 🔹 The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 🔹 Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 🔹 Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 🔹 The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 9 🔹 Environmental an Climatic Dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 10 🔹 Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE: GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: COMPLIANCE OBLIGATION: THE CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 🔹 Compliance Obligation upon Obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Conformity technologies to meet Compliance Law requirements. Some examples in Digital Law, by 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 🔹 Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & 🕴️Nathalie Fabbe-Coste
Section 4 🔹 Opposition and convergence of American and European legal systems in Compliance Rules and Systems, by 🕴️Raphaël Gauvain & 🕴️Blanche Balian
Section 5 🔹 In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their Commitments and Undertakings, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
Section 2 🔹 Arbitration consideration of Compliance Obligation for a Sustainable Arbitration Place, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 4 🔹 The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp
Section 5 🔹 The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Vigilance Obligation, Spearheard and Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 2 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 4 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: GENERAL EVOLUTION OF THE VIGILANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 🔹 Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 🔹 Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 4 🔹 Compliance, Vigilance and Civil Liability: put in order and keep the Reason, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Title V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 🔹 The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
________
CONCLUSION
THE COMPLIANCE OBLIGATION: A BURDEN BORNE BY SYSTEMIC COMPANIES GIVING LIFE TO COMPLIANCE LAW
(conclusion and key points of the books, free access)
29 mai 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their commitments and undertakings", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
____
► Résumé de l'article: The innocents might believe, taking the Law and its words literally, that "commitments" are binding on those who make them. Shouldn't they be afraid of falling into the trap of the 'false friend', which is what the Law wants to protect them from (as stated in the prolegomena)?
Indeed, the innocent persons think that those who make commitments ask what they must do and say what they will do. Yet, strangely enough, the 'commitments' that are so frequent and common in compliance behaviours are often considered by those who adopt them to have no binding value! Doubtless because they come under disciplines other than Law, such as the art of Management or Ethics. It is both very important and sometimes difficult to distinguish between these different Orders - Management, Moral Norms and Law - because they are intertwined, but because their respective standards do not have the same scope, it is important to untangle this tangle. This potentially creates a great deal of insecurity for companies (I).
The legal certainty comes back when commitments take the form of contracts (II), which is becoming more common as companies contractualise their legal Compliance Obligations, thereby changing the nature of the resulting liability, with the contract retaining the imprint of the legal order or not having the same scope if this prerequisite is not present.
But the contours and distinctions are not so uncontested. In fact, the qualification of unilateral undertaking of will is proposed to apprehend the various documents issued by the companies, with the consequences which are attached to that, in particular the transformation of the company into a 'debtor', which would change the position of the stakeholders with regard to it (III).
It remains that the undertakings expressed by companies on so many important subjects cannot be ignored: they are facts (IV). It is as such that they must be legally considered. In this case, Civil Liability will have to deal with them if the company, in implementing what it says, what it writes and in the way it behaves, commits a fault or negligence that causes damage, not only the sole existence of an undertaking.
________
29 mai 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
____
► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.
Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.
To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.
________
14 avril 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article: This article explains what companies' Compliance Obligation" is. Delving into the mass of compliance obligations, it uses the method of classification of those that are subject to an obligation of result and those that are subject to an obligation of means. It justifies the choice of this essential criterion, which changes the objects and the burden of proof of companies that are subject to an obligation of result when it comes to setting up "compliance structures" and are subject to an obligation of means when it comes to the effects produced by these compliance structures.
Indeed, rather than getting bogged down in definitional disputes, given that Compliance Law is itself a nascent branch of Law, the idea of this contribution is to take as a starting point the different legal regimes of so many different compliance obligations to which laws and regulations subject large companies: sometimes they have to apply them to the letter and sometimes they are only sanctioned in the event of fault or negligence. This brings us back to the distinction between obligations of result and obligations of means.
Although it would be risky to transpose the expression and regime of contractual obligations to legal obligations put by legislation, starting from this observation in the evidentiary system of compliance of a plurality of obligations of means and of result, depending on whether it is a question of this or that technical compliance obligation, we must first classify them. It would then appear that this plurality will not constitute a definitive obstacle to the constitution of a single definition of the Compliance Obligation. On the contrary, it makes it possible to clarify the situation, to trace the paths through what is so often described as a legal jumble, an unmanageable "mass of regulations".
Indeed, insofar as the company obliged under Compliance Law participates in the achievement of the Monumental Goals on which this is normatively based, a legal obligation which may be relayed by contract or even by Ethics, it can only be an obligation of means, by virtue of this very teleological nature and the scale of the goals targeted, for example the happy outcome of the climate crisis which is beginning or the desired effective equality between human beings. This established principle leaves room for the fact that the behaviour required is marked out by processes put in place by structured tools, most often legally described, for example the establishment of a vigilance plan or regularly organised training courses (effectiveness), are obligations of result, while the positive effects produced by this plan or these training courses (effaciety) are obligations of means. This is even more the case when the Goal is to transform the system as a whole, i.e. to ensure that the system is solidly based, that there is a culture of equality, and that everyone respects everyone else, all of which come under the heading of efficiency.
The Compliance Obligation thus appears unified because, gradually, and whatever the various compliance obligations in question, their intensity or their sector, its structural process prerequisites are first and foremost structures to be established which the Law, through the Judge in particular, will require to be put in place but will not require anything more, whereas striving towards the achievement of the aforementioned Monumental Goals will be an obligation of means, which may seem lighter, but corresponds to an immeasurable ambition, commensurate with these Goals. In addition, because these structures (alert mechanisms, training, audits, contracts and clauses, etc.) have real meaning if they are to produce effects and behaviours that lead to changes converging towards the Monumental Goals, it is the obligations of means that are most important and not the obligations of result. The judge must also take this into account.
Finally, the Compliance Obligation, which therefore consists of this interweaving of multiple compliance obligations of result and means of using the entreprise's position, ultimately Goals at system efficiency, in Europe at system civilisation, for which companies must show not so much that they have followed the processes correctly (result) but that this has produced effects that converge with the Goals sought by the legislator (effects produced according to a credible trajectory). This is how a crucial company, responsible Ex Ante, should organise itself and behave.
________
12 mars 2026
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de compliance et gouvernance bancaire", in Chaire Éthiques des affaires : Compliance, ESG et Sustainability Reporting & Association Nationale des Juristes de banque (ANJB), Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, Faculté de droit, Université Catholique de Lille, Lille, 12 mars 2026.
____
🧮consulter le programme complet de la manifestation
____
📶consulter les slides
____
► Présentation de cette conférence introductive du colloque : À partir d'une méthode retenir, trois perspectives seront prises.
En méthode, pour éclairer les tables-rondes qui font constituer la journée de rencontreS sans traiter le sujet à leur place ni prétendre répondre par avance aux questions qu'elles vont soulever, ni chercher à conclure par avance et sans avoir rien écouter, ce qui est parfois le vice des introductions qui sont si souvent des sortes de propos de clôture déguisés, avec juste quelques points d'interrogation pour donner le change, j'ai pris la vieille, vieille, méthode de l'introduction en "triple entonnoir".
Cela consiste à partir d'un autre point que celui objet du colloque lui-même, Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, pour venir d'une façon extérieure et d'une première façon au sujet, d'en repartir pour s'accrocher à un deuxième point extérieur, et de le refaire encore une troisième fois, pour après ce triple déploiement, avoir en quelque sorte aéré le sujet afin de permettre aux orateurs suivant de se concentrer sur le sujet qui est très précis.
Cela est d'autant aisé que le thème retenu lui-même porte sur trois points : une ambition - particulière - (la "lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme"), un secteur - particulier (le "secteur bancaire") et une activité portée par des personnes - particulières - (la "participation des acteurs").
____
Mon premier point de départ est de poser ce qu'est le Droit de la Compliance pour rattacher ce qu'est le Droit de la Compliance à l'objet sur lequel il porte : le secteur bancaire. Car s'il s'agissait que de se "conformer la réglementation applicable", l'on ne comprend pas pourquoi le secteur bancaire est si concerné, si contraint, si exposé à la "compliance", qui ne serait que la façon anglaise de dire qu'il faut "se conformer". Il doit bien y avoir plus que de l'obéissance aux normes, plus que de la prévention des manquements, pour que cela soit si structurant et que le secteur bancaire soit en première ligne.
Il apparaît alors que le Droit de la Compliance n'est pas l'obeissance mécanique à des corpus réglementaire, mais la contribution par des opérateurs systémique à la concrétisation d'ambitions politiques essentielles pour le futur (les "Buts Monumentaux", négatifs et positifs). C'est à ce titre que le secteur bancaire, parce qu'il est composé d' "opérateurs cruciaux" est l'objet naturel de la compliance. Sa puissance ne doit pas lui être reprochée ; elle est indispensable. Dans une branche du Droit qui est en émergence, qui est systémique, qui est Ex Ante, qui est avant un Droit d'action dont l'objet est le futur. Se conformer n'en est qu'un outil.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 Les buts monumentaux, coeur battant du Droit de la compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité: les distinguer pour les articuler, 2024
____
Mon deuxième point de départ est de partir des Buts Monumentaux , ancrage normatif du Droit de la compliance, pour le rattacher à cette ambition singulière et ici privilégiée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'on doit s'étonner de certaines choses. En effet, si l'on se refuse au stade de l'introduction à entrer dans la technicité des textes et le contentieux de celui-ci, l'on peut se demander pourquoi ces deux objets sont ainsi associés. L'on mesurer la corrélation entre l'activité bancaire et le blanchiment d'argent. S'y associent d'ailleurs les notaires, ce que l'on appellait les commissaires-priseurs, les ..., brefs tous ceux qui manient l'argent. Même si l'on voit la ratio legis, il reste l'idée que celui qui n'est que le tuyau (pour reprendre la distinction familière dans la régulation des infrastructure essentielles de réseau) pourraît être aussi celui qui organise le contenu : le banquier blanchisseur. Et la diligence Ex Ante de compliance blanchit par avance ce soupçon qui demeure d'une sanction qui plane d'un Ex Post. Nous payons très cher cette représentation qui imprègne le Droit répressif, voire pénal, de la vigilance bancaire, notamment en matière de secret, de transparence, d'information et de prise de risque.
Mais pourquoi l'avoir étendu au financement du terrorisme ? Car le soupçon du banquier terroriste n'existe plus. Le cas redevient pur. Il s'agit d'internaliser dans les banques la charge régalienne d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant les morts tombés. Le financement est le point faible et visible du mal systémique. Cela se conçoit. C'est passé de l'Ex Post (traitement finanier après le crime) à l'Ex Ante (traitement financier avant le crime). C'est d'une autre nature.
Mais c'est d'une autre nature. Il n'y a pas de raison d'arrêter ce mouvement de surveillance, car les mouvements d'argent informent tant sur les projets collectifs et individuels. Par exemple dans l'espace numérique. Il faut faire attention à cela, au regard du principe de liberté, dont le principe de non-immixtion n'est qu'une déclinaison.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le couple Ex Ante - Ex Post, justification d'un droit spécifique et propre de la régulation, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝LCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : comprendre raison garder, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
____
Mon troisième point de départ est la "gouvernance", terme qui est assez mystérieux , car il relève davantage de la gestion de l'art politique de mobiliser les êtres humains que du droit. Pourquoi faut-il que les "acteurs" participent, alors que la norme juridique est obligatoire et que, le plus souvent, elle prend forme pénale ? Le mixage entre les plus violentes des normes, l'application des sanctions pécuniaires, voire privatives de libertés, étant revendiqué comme une victoire de la régulation, alors même que les principes processuels reculent est un noeud d'incompréhsion.
D'ailleurs, dans un ordre juridique, qui serait donc remis en cause par cette "gouvernance", c'est à l'Etat de dicter et aux banques assujetties d'exécuter. Mais si elles se chargent de tout, il devient difficile de maintenir ce dispositif, et sans doute n'est-il plus tenable si le But Monumental se déploie dans des dimensions qui excèdent concrètement celles de l'Etat mais correspondent à celles des banques. Le risque est alors de passer d'un gouvernant à un autre, risque social et politique qui s'accroit.
Concrètement, les opérateurs bancaies peuvent assumer ce renversement de deux façons. En premier lieu, en faisant effectivement "participer" les êtres humains qui les composent, à l'intérieur et à l'extérieur, leurs "partenaires" et les parties prenantes. Cela peut s'appeler une "gouvernance" dans une alliance par des buts, explicites, avec des contributions qui ne sont pas crues sur paroles mais qui sont apportées par des "structures de compliance", des "comportements crédibles" et des "trajectoires plausibles".
En cela, les banques mutualistes sont en meilleure position que les autres. Les mécanismes de formation, au centre du Droit de la Compliance, y jouent un rôle essentiel. En second lieu, les alliances avec les autorités publiques et les ancrages territoriaux, avec les évaluations concrètes sont décisifs. Le contrat devient alors non pas seulement le moyen obligé par lequel la banque assujettie exécute son obligation réglementaire mais l'outil juridique le plus classique par lequel elle exerce sa liberté pour contribuer en ce qui la concerne à la réalisation des buts monumentaux pour l'avenir du groupe social, aujourd'hui menacé.
On est loin et au-delà de la "conformité" : cela s'appelle le Droit de la Compliance.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste,in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la compliance, 2020
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, 2026
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 - 2026.
________
23 février 2026
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'avenir de la compliance", cycle La compliance, Centre Perelman, Bruxelles, 23 février 2026.
____
🧮consulter le programme complet du cycle La compliance
____
► Présentation de cette conférence conclusive du cycle : L'avenir de la Compliance, bien malin qui le connaît. Celui qui pratique et étudie les textes, les contentieux, les structures et les comportements devra bien reconnaître qu'il ne sait pas ce que va devenir ce qui pourtant a émergé comme une nouvelle branche du Droit. On le reconnait assez peu, sans doute pour trois raison. En premier lieu, parce que la naissance d'une branche du Droit est un phénomène peu courant, dont les ondes perturbantes et régénérantes se font sentir et dans toutes les branches du Droit et dans les autres systèmes normatifs, accompagnant et traduisant le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà entrés, que l'on en soit content ou non. En deuxième lieu, parce qu'il est désagréable (surtout si l'on est professeur...) de débuter et de conclure par le fait qu'on ne sait pas. En troisième lieu, parce que c'est très peu vendeur, et que dans le grand "marché de la compliance"qui est aujourd'hui ouvert et qui se développe, il est peu malin si l'on veut vendre des produits de conformité (qu'il s'agisse d'algorithmes, de nouveaux services à rattacher au plus niveau des entreprises, de spécialités dans les cabinets d'avocat, de nouvelles chaires dans les diverses Ecoles) de dire qu'on ne sait pas. Alors les experts disent qu'ils savent. Pour ma part, je rencontre de multiples personnes, qui sont "expertes" et qui sont "sachants". Ce qui est étonnant, c'est la diversité de leurs discours, ce qui fait douter de la solidité de la projection, notamment sur le sens des mots : par exemple non seulement les mots que l'on pourrait dire "nouveaux" (que l'on cherchera alors à ancrer dans des mots anciens) "compliance" et "gouvenance" mais aussi des mots que l'on connait sans doute mieux, comme "engagement" et "responsabilité" ou "sanction", c'est-à-dire les piliers même de la choses.
Pourquoi est-ce que c'est préoccupant, en dehors même qu'il est toujours mieux de savoir de quoi on parler, plutôt que chacun parle dans son coin, pour son corpus de compliance à lui, pour ses amis de pensée, la matière se silotant de plus en plus ? Parce que le Droit de la Compliance a pour l'objet l'Avenir.
Il sera donc posé en préalable que ne pas connaître l'avenir est une difficulté majeure lorsqu'il s'agit du Droit de la Compliance en ce que cette branche du Droit tient son unité en ce qu'elle est Ex Ante et que son objet est l'avenir. La difficulté n'est ni de la même nature ni de la même ampleur lorsqu'il s'agit du législateur, du "réglementeur", de l'entreprise assujettie (calculante ou politique), du juge confronté au Contentieux systémique de la Compliance.
Cela dit, dans une première partie l'on peut imaginer les avenirs ouverts à la Compliance (car cela relève de cela, tant il y a de candidats pour se saisir des instruments de puissance que constituent les "outils de la compliance"). Il n'est pas acquis que cet avenir relève du Droit. Les suites pourraient s'en charger. Ou l'ordre donné par le chef, et cela passerait d'autant mieux qu'il pose que certes il n'a pas souci des êtres humains mais qu'il manie la puissance de la compliance pour restaurer l'équilibre climatique : sauf à dire qu'il n'existe pas de Droit unifié de la compliance. Qu'il y en aurait une pour le climat et une autre pour les droits des êtres humains. Et alors qu'en est-il de la cohérence à venir du Droit européen, qui noue les 2 dans la CSRD et la CS3D ? Notamment dans les chaines de valeur. La question est alors celle-là : quelle sera à l'avenir l'unicité du Droit de la compliance ?
Dans une deuxième partie, puisqu'on ne sait pas comment cela va tourner, d'omnibus en omnibus, de gouvernement hostile au droit en gouvernement en appelant au droit, de jurisprudence en jurisprudence, de droit spécial en droit commun, il faut apprécier les avantages et les inconvénients des perspectives. Il n'y a jamais une perspective où tout serait bien et l'autre où tout serait mal, car dans ce cas, il n'y aurait ni choix ni politique: il suffirait d'avoir des informations, d'être "rationnel" et d'aller vers la bonne solution plutôt que la mauvaise. Au-delà des déclarations générales comme quoi un mixte de conformité et d'éthique est bienvenu, ce dont on ne doute pas dans les déclarations qui sont faites dans ce sens, il convient de regarder les avantages et les inconvéniets de ce vers quoi l'on peut aller. En premier lieu, il peut s'agir de la disparition du Droit de la compliance, avec l'avantage de l'allégement du poids réglementaire sur les assujettis et l'inconvénient de l'abandon des prétentions altruistes et globales (les deux pouvant se recoupe). En deuxième lieu, il peut s'agir d'une constitution d'un empire sur le monde, avec l'avantage d'une simplicité de l'empire américain extraterritorialisé soit par l'Etat soit par les entreprises et leur "gouvernance, soit par leur technologie, avec l'avantage d'un modèle occidental et l'inconvénient de l'écrasement de la mondialisation par la globalisation et la disparition des ambitions portées par les Etats. En troisième lieu, il peut s'agir d'une contribution à une guerre entre puissances, notamment par le DSA et par la guerre des données, avec l'avantage d'une maturité européenne d'un droit de la compliance prolongement du droit de la régulation et l'inconvénient que l'on pourrait passer à une guerre au sens métaphorique (ne jamais utiliser de métaphore en Droit) à une guerre. En quatrième lieu, il peut s'agir d'un nouvel Etat du Droit où les entreprises systémiques participent en alliance à concrétiser des buts monumentaux de nature politique décidés par les Etats et autorits politiques en préservant dans le futur ("durabilité") les systèmes afin que les êtres humains n'en soient pas broyés mais en bénéficient. L'inconvénient est qu'il faut réapprendre le Droit, car si cela n'a rien à voir avec la conformité, qui n'est qu'un instrument, le Droit de la compliance change toutes les branches du droit et oblige à intégrer d'autres techniques, notamment politiques et technologiques.
Dans une troisième partie, en pratique il faut tendre par anticipation à diminuer les inconvénients liés des défauts attachés à des futurs possibles du Droit de la Compliance, comme il faut tendre à accroître par anticipation les avantages liées aux qualités attachées aux futurs possibles du Droit de la Compliance. L'inconvénient réside dans la nature même du Droit de la compliance, à savoir sa grande puissance, car contrairement au Droit de la concurrence il appelle et accroît la puissance. Il faut donc pallier la perspective d'un accaparement des techniques de compliance, notamment celles liées à l'information, par ceux qui ne veulent les manier que pour consolider ou étendre leur puissance, en riant bien de l'éthique et des buts monumentaux. C'est alors les techniques de supervision d'une part et un office du juge renouvelé qui doivent être pensé. La qualité attachée aux futurs possibles tient au fait que l'on pourrait tenir un "droit global" (référence aux travaux notamment de Benoît Frydman) et que face à la possible disparition du Droit international public et la préservation impérieuse des chaines de valeur, notamment dans la contexte de possible guerre, l'alliance entre les entreprises systémiques supervisées et les autorités politiques en charge du futur du groupe social qui les légitime peut apparaître comm un système légitime, effectif, efficace et efficient.
____
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Concevoir le pouvoir, 2021
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
________