Matières à Réflexions
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
Les droits de la défense ont valeur constitutionnelle et constituent des droits de l'homme, bénéficient à toute personne, y compris les personnes morales. Le droit positif a pour mission de les concrétiser en temps utile, c'est-à-dire dès le moment de l'enquête ou de la garde à vue, ce qui se manifeste par exemple par le droit à l'assistance d'un avocat ou au droit de garder le silence ou au droit de mentir. Ainsi les droits de la défense n'ont pas pour but d'aider à la manifestation de la vérité, n'aident pas le juge ou l'efficacité de la répression - ce que fait le principe du contradictoire -, ce sont de purs droits subjectifs au bénéfice des personnes, y compris voire surtout des personnes qui peuvent être parfaitement coupables, et gravement coupables.
Les droits de la défense sont donc un florilège de prérogatives qui sont offertes à la personne mise en cause ou susceptible de l'être ou susceptible d'être affectée. Peu importe que cela nuise éventuellement à l'efficacité. Ce sont des droits de la personne. C'est pourquoi leur titulaire le plus naturel est la personne poursuivie au pénal ou aux prises d'un système de répression. C'est pourquoi le déclenchement de la puissance d'un tribunal ou d'un juge les offre d'une façon consubstantielle à celui qui est de ce seul fait - et légitimement - menacé par cette violence légitime (une des définitions de l’État).
Les droits de la défense débutent donc avant même le procès car le "temps utile" débute dès la phase de l'enquête, dès les perquisitions, voire dès les contrôles, et se poursuit à l'occasion des recours contre la décision faisant grief. L'action en justice étant un moyen d'être partie, c'est-à-dire de faire valoir des arguments en sa faveur, donc de défendre sa cause, montre que le demandeur à l'instance est également titulaire de droits de la défense puisqu'il est non seulement demandeur à l'instance mais il également demandeur et défendeur aux allégations qui s'échangent au cours de la procédure : il allégué à l'allégation de son contradicteur n'est pas correcte.
Ils prennent de très multiples formes et n'ont pas besoin d'être expressément prévus par des textes, puisqu'ils sont de principes et bénéficient constitutionnellement d'une interprétation large (interprétation ad favorem). Il s'agit du droit d'être partie (par exemple droit d'intervention, droit d'action - que certains distinguent des droits de la défense -, droit d'être mis en cause, comme par exemple droit d'être mis en examen -), droit d'être assisté d'un avocat, droit de se taire, droit de ne pas auto-incriminer, droit d'accès au dossier, droit d'intervenir dans le débat (les droits de la défense croisant alors le principe du contradictoire), droit de former un recours, etc.
Il est essentiel de qualifier un organe de tribunal car cela déclenche au bénéfice de la personne en cause les garanties de procédure, dont les droits de la défense, ce que sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme fut fait à propos des Régulateurs pourtant formellement organisés en Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Cela contribua au mouvement général de juridictionnalisation de la Régulation.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

En premier lieu, le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à comprendre notamment parce qu'il souffre d’ambiguïté et de confusion du fait de son vocabulaire d'origine anglophone, dans lequel des mots ou expressions proches ou identiques n'ont pourtant pas la même signification.
A tout seigneur tout honneur, c'est le cas pour le terme de "Régulation".
En langue anglaise, regulation vise le phénomène que la langue française exprime par le terme "Réglementation". Mais elle peut aussi viser l'appareillage complet de ce qui va tenir un secteur atteint une défaillance de marché et dans laquelle la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres. On utilisera alors avec précision l'expression Regulatory System, mais aussi le terme Regulation, l'usage de la majuscule signalant la différence. Il est inévitable que dans une lecture rapide, voire par le jeu du numérique, qui écrase les majuscules, et les traductions automatiques, cette distinction de formulation, tenant à une minuscule/majuscule disparaisse. Et la confusion naît.
Les conséquences sont considérables. C'est notamment en raison de cette homonymie, que fréquemment en langue française l'on mette au même niveau le Droit de la Régulation et la réglementation. L'on s'appuiera sur une telle association, de nature tautologique, pour affirmer que "par nature" le Droit de la Régulation serait de "droit public", puisque la réglementation a pour auteur des personnes publiques, notamment l’État ou les Autorités administratives indépendantes que sont les Régulateurs. Reste lors la difficile justification de la présence considérable des contrats, des arbitres, etc. Sauf à critiquer l'idée même de Droit de la Régulation, parce qu'il serait le signe d'une sorte de victoire des intérêts privés, puisque conçus par des instruments de droit privé.
Apparaissent ainsi deux inconvénients majeurs. En premier lieu, cela maintient dans le Droit de la Régulation la summa divisio du Droit public et du Droit privé, qui ne parvient plus à rendre compte de l'évolution du Droit en la matière et conduit des observateurs, notamment des économistes ou des institutions internationales, à affirmer que le Droit de Common Law serait plus adapté aujourd'hui à l'économie mondiale notamment parce que celui-ci fait certes place au Droit administratif, au Droit constitutionnel, etc., mais ne les conçoit pas dans la distinction Droit public/Droit privé, comme continue de le faire le Droit continental de Civil Law.
En second lieu, sans doute parce que ce Droit nouveau puise dans des théories économiques et financières qui se construisent principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'habitude se prend de ne plus traduire. L'on trouve ainsi dans d'autres langues, dans des textes écrits en français par exemple, des phrases comme "le Régulateur doit être accountable".
Il est inexact que l'idée d'accountability , qui renvoie à une reddition des comptes, soit réductible à l'idée de "responsabilité". Les auteurs ne le traduisent pas, ils ne recopient et l'insèrent dans des textes rédigés en français.
L'on passe de la "traduction-trahison" à l'absence de traduction, c'est-à-dire à la domination du système de pensée dont le mot est originaire.
Un des enjeux actuels majeurs de ce phénomène est dans le terme même de la "Compliance". Le terme francophone de "conformité" ne le traduit pas. Pour respecter ce qu'est la compliance, il convient pour l'instant de le recopier, afin de ne pas le dénaturer. L'enjeu est de trouver un mot francophone qui exprime cette idée nouvelle, notamment au regard des systèmes juridiques qui ne sont pas de Common Law, afin que leur cadre général demeure.
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), Droit et économie, tome 37, ed. Sirey, 1992, 426 p.
Lire les résumés des articles en langue anglais.
Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.
Base Documentaire : Doctrine
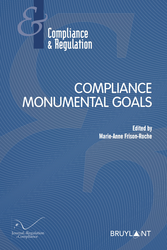
► Référence complète : Marty, F., The Case for Compliance Programs in International Competitiveness: A Competition Law and Economics Perspective, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
____
► Résumé de l'article: The author analyzes economically the question of whether the compliance programs set up to respect competition rules are for the sole purpose of avoiding sanctions or also contribute to the goal of increasing the international economic performance of companies. which submit to them.
The author explains that companies integrate by duplication external standards to minimize the risk of sanctions, developing a "culture of compliance", which produces their competitiveness increase and the effectiveness of the legal and economic system. In addition, it reduces the cost of investment, which increases the attractiveness of the company.
In this, this presentation based on the postulate of the rationality of companies and investors, compliance programs can fall under self-regulation. The duplication of the law that they operate takes place largely according to "procedural" type methods.
____
📝 voir la présentation générale de l'ouvrage 📘Compliance Monumental Goals dans lequel cet article est publié
________
Base Documentaire : Doctrine
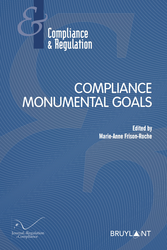
► Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
___
► Article Summary: Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.
This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.
____
📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié
_______
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie la personne sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
Alors que les droits de la défense sont des droits subjectifs qui sont des avantages données à la personne risquant de voir sa situation affectée par la décision que l'organe qui est formellement ou fonctionnellement qualifiée juridiquement comme étant un "tribunal", peut prendre, le principe du contradictoire est plutôt un principe d'organisation de la procédure, dont la personne peut tirer profit.
Ce principe, comme le terme l'indique, est - comme le sont les droits de la défense - de nature à engendre tous les mécanismes techniques qui le servent, y compris dans le silence des textes, impliquent une interprétation large de ceux-ci.
Le principe du contradictoire implique que le débat entre tous les arguments, notamment toutes les interprétations possibles, soit possible. C'est à titre exceptionnel et justifié, par exemple en raison de l'urgence ou d'une exigence justifiée de secret (secret professionnel, secret de la vie privée, secret industriel, secret défense, etc.) que le mécanisme contradictoire est écartée, parfois pendant un temps seulement (technique du contentieux différé par l'admission de la procédure sur requête).
Cette participation au débat doit être pleinement possible au débatteur, notamment l'accès au dossier, la connaissance de l'existence de l'instance, l'intelligibilité des termes du débat, non seulement les faits, mais encore la langue (traducteur, avocat, intelligibilité du propos), mais encore discussion sur les règles de droit applicables). Ainsi lorsque le tribunal relève d'office des règles de droit, il doit les soumettre au débat contradictoire avant d'en faire éventuellement application.
L'application du principe du contradictoire croise souvent les droits de la défense, mais en ce qu'il est lié à la notion de débat, il se développe d'autant plus que la procédure est de type accusatoire.
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Beauvais, P., Méthode transactionnelle et justice pénale, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, Panthéon-Assas, 2016, pp. 79-90.
Voir la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
La régulation est née de la nécessité de prendre en compte la spécificité des secteurs, souvent en accompagnement de la libéralisation de ceux-ci.
Mais, en premier lieu, des biens de différents secteurs peuvent être substituables. Ainsi, l’on peut se chauffer aussi bien au gaz qu’à l’électricité, la concurrence intermodale rendant moins pertinente la segmentation de la régulation du secteur de l’électricité et la régulation du secteur du gaz. Pareillement, un contrat d’assurance-vie est à la fois un instrument de protection pour l’avenir, un produit relevant donc de la régulation assurantielle, mais aussi produit financier placé auprès des consommateurs par des entreprises de banque-assurance, relevant donc de la régulation bancaire et financière. Cette intimité de la régulation par rapport à la technicité interne de l’objet sur lequel elle porte ne peut être effacée.
L'interrégulation qui va se mettre en place est d'abord institutionnelle. C’est pourquoi, une alternative s’ouvre : soit on fusionne les autorités, et ainsi la Grande Bretagne par la Financial Services Authority (FSA) a, dès 2000, fusionné la régulation financière et bancaire, ce que la France n’a pas fait (tandis que la France a fusionné la régulation des assurances et la régulation bancaire à travers l’ACPR). Ainsi, la première branche de l’alternative est la fusion institutionnelle, au risque de constituer des sortes de Titans, voire de reconstituer l’État. Soit on établit des procédures de consultation et de travaux communes, pour faire naître des points de contact, voire une base de doctrine commune contre les régulateur. L’autre branche de l’alternative consiste à respecter ce rapport initial entre régulation et secteur et de prendre acte des liens entre les secteurs à travers la notion proposée de « inter-régulation ». Cela suppose alors de mettre en place des réseaux entre des autorités demeurées autonomes, mais qui s’échangent des informations, se rencontrent, collaborent sur des dossiers communs, etc. Cette interrégulation peut d’abord être horizontale lorsque des autorités de plusieurs secteurs collaborent, par exemple l’autorité de contrôle prudentiel et l’autorité des marchés financiers, ou l’ARCEP et le CSA. Elle peut être aussi de type vertical lorsque les autorités de secteurs nationaux collaborent avec des autorités étrangères ou des autorités européennes ou internationales, comme le prévoit le processus Lamfalussy en matière financière (élargi aux secteurs de la banque et des assurances) ou le processus de Madrid en matière énergétique par lesquels chaque régulateur nationaux se rencontrent et travaillent en commun, avec et autour de la Commission européenne (technique de la comitologie).
L'interrégulation qui est ensuite notionnelle, un "droit commun" de la régulation s'élaborant, commun entre tous les secteurs. Ce "droit commun" (droit horizontal) est venu après la maturation des droits sectoriels de la régulation (droits verticaux). Il s'élabore de fait parce que les objets régulés se situent à la frontière de plusieurs secteurs, voire ignorent celle-ci : par exemple les produits financiers dérivés sur sous-jacent agricole ou énergétique. Plus encore, les "objets collectés" engendrent de l'interrégulation dans l'espace numérique. Ainsi, alors même qu'il est possible qu'Internet, donne lieu à une "interrégulation" avant de donner lieu à une régulation spécifique, celle-ci pouvant justifier que l'on se passe de la première.
Base Documentaire : Doctrine
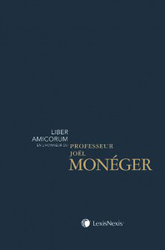
Référence complète Fox, E., The new world order, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.
Enseignements : Droit commun de la Régulation
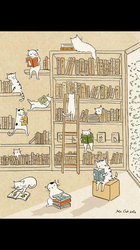
Retourner à la présentation générale du Cours.
Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :
- Doctrine (par ordre alphabétique), la présentation distinguant quelques ouvrages généraux avant de répertorie des études pertinentes pour comprendre le "Droit commun de la Régulation"
- Textes de droit international, textes de systèmes juridiques étrangers,textes de l'Union européennes, textes de droit français
- Littérature grise
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").
Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.
Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.
Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.
Base Documentaire : 07. Cours d'appel
Référence : Grenoble, 5 nov. 2020, I.D. c/ Société Corin France
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lalande, P.-A., Le pouvoir d’injonction au service de la réparation du préjudice écologique : une mise en œuvre de l’office du juge administratif en matière climatique, Actu-Juridique, 9 décembre 2021.
____
_____
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Boy, , "Réflexion sur le "droit de la régulation". A propos du texte de Marie-Anne Frison-Roche", D., chron., 2001, p.3031 et s.
____
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Gibert, M., Faire la morale aux robots. Une introduction à l'éthique des algorithmes, Flammarion, 2021, 168 p.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La Federal Communications Commission (FCC) est l'autorité de régulation indépendante qui aux États-Unis régule au niveau fédéral à la fois le contenant et le contenu des télécommunications.
En cela les États-Unis se distinguent de l'Union européenne, espace juridique dans lequel le plus souvent les institutions de régulation du contenant et du contenu sont distinctes (par exemple en France ARCEP / CSA/CNIL) et dans lequel les régulations des communications demeurent substantiellement au niveau des États membres de l'Union.
Comme les autres régulateurs audiovisuels, elle assure le pluralisme de l'information en limitant la concentration capitalistique - et donc du pouvoir - dans le secteur de la télévision et de la radio. L'on mesure ainsi que le système américain n'est pas dans son principe différent du système européen.
En outre, la FCC se caractérise tout d'abord par une très grande puissance, imposant à la fois des principes substantiels aux opérateurs, comme celui de la "décence", allant au nom de ce principe jusqu'à sanctionner des chaînes de télévision qui avaient laissé montrer une poitrine nue d'une femme. Le contrôle est donc plus substantiel qu'en Europe, ce contrôle venant en balance avec la liberté constitutionnelle d'expression qui est plus puissance aux Etats-Unis qu'en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises maîtresses du numérique ont tendance à formuler pour nous ce qui est beau, bien et décent, à la place des autorités publiques.
La FCC a continué de développer les principes majeurs du système de communication publique, comme en 2015 celui de l'Internet ouvert (Open Internet) ou à formuler le principe de "neutralité du numérique", repris par une loi fédéral, ce principe ayant des implications économiques et politiques considérables.
Mais dans le même temps, marque générale d'un droit américain, le juge tempère ce pouvoir, selon le principe de Check and Balance. C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis par l'arrêt FCC v. Pacifica Foundation en 1978 ce pouvoir de contrôle direct du contenu mais en opère également le contrôle du contrôle.
L'élection en 2016 d'un nouveau président qui est entre autres choses totalement hostile à l'idée même de Régulation est une épreuve au sens probatoire du terme. Il a nommé en janvier 2017 un nouveau président de la FCC, hostile à toute régulation et notamment au principe de neutralité. La question qui se pose est de savoir si techniquement une régulation déjà établie sur ces principes peut résister, comment et combien de temps, à une volonté politique violemment et expressément contraire. Et que feront les juges.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le légicentrisme exprime avant tout une bataille de normes, puisque cette doctrine pose que la loi est la seule et unique expression de la souveraineté de la Nation. En cela, la loi dispose d'une autorité indépassable et c'est elle qui fonde l'État légal.
Ainsi, si l'on devait donner une figure au système juridique, ce serait un cercle avec en son cœur d'une façon unique la loi souveraine, à la fois autosuffisante dans son fondement (souveraineté) et dans sa production (principe de légalité).
Cette conception moniste (unité de la loi) a pour principale source la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, c'est encore sur celui-ci que la France conserve le principe de souveraineté parlementaire (le Gouvernement est responsable devant le Parlement) et de souveraineté de la loi. Mais depuis la Révolution française, les esprits et les faits ont changé.
Ainsi, s'est construite une doctrine inverse : le "pluralisme juridique" qui pose en contradiction que le droit vient de nombreuses sources, comme la coutume, les pratiques, les jugements, etc. Il n'est pas étonnant que les auteurs qui affirment le pluralisme juridique ne viennent pas de la philosophie politique mais davantage de la sociologie comme Gurvitch ou Carbonnier.
En outre, les frontières nationales ont perdu de leur consistance, de fait et de droit. C'est pourquoi un auteur comme Mireille Delmas-Marty s'appuie sur le fait même de la construction de l'Europe des droits de l'homme d'une part et de la globalisation d'autre part pour affirmer que le légicentrisme a fait place à un pluralisme juridique généralisé.
Cependant, en droit positif les textes restent les mêmes. C'est ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, dispose de la loi que "la loi est l'expression de la volonté générale".
De la même façon, l'article 5 du Code civil continue d'interdire au juge de rendre des jugements contraignants pour d'autres cas que celui particulier sur lequel il se prononce.
Cette permanence des textes les plus gradés, à savoir l'article 5 du Code civil et l'article 6 de la déclaration pose de nombreux problèmes aux juges. En effet, depuis l'arrêt du Tribunal des conflits Blanco, le droit administratif n'est plus lié par ce qui est posé par le Code civil et sans doute la puissance normative du Conseil d'Etat s'exprime plus ouvertement que celle de la Cour de cassation, qui feint de ne rendre que des arrêts de principe pour pouvoir affirmer qu'elle ne rend pas d'arrêt de règlement.
D'une façon plus complexe, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que certes il est le gardien de la norme constitutionnelle supérieure à la loi mais quand le même temps, seul le législateur, puisque celui est le souverain, peut exprimer la volonté générale, ce à quoi le Conseil constitutionnel ne peut se substituer.
Mais le Droit de l'Union européenne, qui constitue un Ordre juridique à la fois autonome et dont les normes sont pourtant intégrées dans les ordres juridiques des Etats-membres, rend difficilement soutenable la conception du légicentrisme. Y a succédée une hiérarchie des normes complexes. Mais les fondements politiques de l'idée de légicentrisme alimente en grande partie l'hostilité à l'égard de l'Europe, aussi bien celle de l'Union que celle de la CEDH.
Base Documentaire : Doctrine
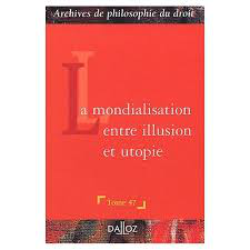
Référence complète : Salah, M., La mondialisation vue de l'Islam, in Archives de Philosophie du Droit, La mondialisation entre illusion et utopie, tome 47, Dalloz, 2003, 27-54.
La mondialisation apparaît comme une occidentalisation des cultures et du droit. L'Islam qui prend forme juridique devrait se l'approprier sans se dénaturer. La réussite d'un tel processus difficile dépendra de la qualité de la régulation qui sera mise en place.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Les étudiants de Sciences po peuvent via le drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".
Base Documentaire : Doctrine
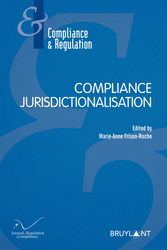
► Référence complète: O. Douvreleur, "Compliance and Judge of the Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published.
____
📘lire une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Compliance maintains with the judge complex relations, and even more with the judge ruling only on points of Law (in France, the Court de Cassation in the judicial order, the one who, in principle, does not know the facts that he leaves to the sovereign appreciation of the judges ruling on the substance of the disputes. At first glance, compliance is a technique internalised in companies and the place occupied by negotiated justice techniques leave little room for intervention by the judge ruling only on points of Law
However, his role is intended to develop, in particular with regard to the duty of vigilance or in the articulation between the different branches of Law when compliance meets Labor Law, or even in the adjustment between American Law and the other legal systems, especially French legal system. The way in which the principle of Proportionality will take place in Compliance Law is also a major issue for the judge ruling only on points of Law.
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance Obligation and Human Rights", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author asks whether human rights can, over and above the many compliance obligations, form the basis of the Compliance Obligation. The consideration of human rights corresponds to the fundamentalisation of Law, crossing both Private and Public Law, and are considered by some as the matrix of many legal mechanisms, including international ones. They prescribe values that can thus be disseminated.
Human rights come into direct contact with Compliance Law as soon as Compliance Law is defined as "the internalisation in certain operators of the obligation to structure themselves in order to achieve goals which are not natural to them, goals which are set by public authorities responsible for the future of social groups, goals which these companies must willingly or by force aim to achieve, simply because they are in a position to achieve them". These "Monumental Goals" converge on human beings, and therefore the protection of their rights by companies.
In a globalised context, the State can either act through mandatory regulations, or do nothing, or force companies to act through Compliance Law. For this to be effective, tools are needed to enable 'crucial' operators to take responsibility ex ante, as illustrated in particular by the French law on the Vigilance Obligation of 2017.
This obligation takes the form of both a "legal obligation", expression which is quite imprecise, found for example in the duty of vigilance of the French 2017 law, and in a more technical sense through an obligation that the company establishes, in particular through contracts.
Legal obligations are justified by the fact that the protection of human rights is primarily the responsibility of States, particularly in the international arena. Even if it is only a question of Soft Law, non-binding Law, this tendency can be found in the Ruggie principles, which go beyond the obligation of States not to violate human rights, to a positive obligation to protect them effectively. The question of whether this could apply not only to States but also to companies is hotly debated. If we look at the ICSID Urbaser v. Argentina award of 2016, the arbitrators accepted that a company had an obligation not to violate human rights, but rejected an obligation to protect them effectively. In European Law, the GDPR, DSA and AIA, and in France the so-called Vigilance law, use Compliance Lools, often Compliance by Design, to protect human rights ex ante.
Contracts, particularly through the inclusion of multiple clauses in often international contracts, express the "privatisation" of human rights. Care should be taken to ensure that appropriate sanctions are associated with them and that they do not give rise to situations of contractual imbalance. The relationship of obligation in tort makes it necessary to articulate the Ex Ante logic and the Ex Post logic and to conceive what the judge can order.
The author concludes that "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational" ("Compliance requires us to reshape the classic categories of Law with a view to bringing them into line with the very objective of Compliance: not just a Law turned towards the past, but a Law anchored in the challenges of the future; not a Law emanating exclusively from public constraint, but a Law based on private normativity; not a strictly territorialised Law, but a law apprehending the transnational space".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le terme "manquement" est nouveau en Droit. Dans l'ordre juridique, le terme de "faute" est celui qui est retenu pour désigner le comportement d'une personne qui s'écarte d'une règle et doit être sanctionné, car par cet acte il a manifesté une intention dolosive qui peut lui est reproché. Mais la notion juridique de faute, qui fût centrale dans le droit classique de la responsabilité civile et était indispensable dans le droit de la responsabilité pénale a l'inconvénient majeure d'appeler une preuve : celle de l'intention de "mal faire". Cela paraît d'autant moins adéquat lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement d'organisations, comme le sont les entreprises, dont le comportement et la puissance doivent être maîtrisées davantage que les comportements fautifs de leurs dirigeants sanctionnées.
C'est pourquoi à la fois pour alléger la charge probatoire concernant les personnes physiques, notamment les personnes ayant le pouvoir et la fonction de décider pour autrui (les managers, les "hauts dirigeants") et pour mieux correspondre à la distribution du pouvoir d'action, dont sont désormais titulaires des organisations, notamment les entreprises, ce sont des "manquements" et non plus des fautes ou des négligences qui constituent les faits générateurs déclenchent l'engagement de leur responsabilité ou justifiant une répression.
Il s'agit plus particulièrement d'une répression administrative, laquelle a pour fin non pas la sanction des fautes mais la protection efficace des secteurs régulés. La sanction des manquements est donc à la fois plus facile, parce qu'il est toujours nécessaire de prouver l'intention, et plus violente, parce que les sanctions attachées peuvent porter sur une part des profits retirés, sur une part du chiffre d'affaires de l'opérateur ou peuvent prendre la forme d'engagements de l'opérateur pour le futur, forme très contraignante et nouvelle de sanction que la technique de compliance a insérée dans le droit.
Ainsi le manquement peut se définir comme un comportement, voire une organisation qui est en écart par rapport au comportement ou à la situation que l'auteur d'un texte a posé comme étant celui qu'il pose comme adéquat. Cette définition à la fois large, abstraite, téléologique et de prescription, qui permet d'appréhender non seulement les comportements mais les structures, fait de la sanction des manquements, un outil quotidien du Droit de la Régulation.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Torre-Schaub, "La compliance environnementale et climatique", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de la contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’auteure part du fait que le droit de la compliance, en ce qu’il ne se limite pas à la conformité, et le droit de l’environnement sont complémentaires, reposant avant tout sur la prévention des risques et des comportements dommageables, les crises environnementales et le droit à un environnement sain impliquant le renforcement de la vigilance environnementale. Il est d’autant plus important de le faire que les définitions demeurent imprécises, ne serait-ce que celles d’environnement et de climat, notions diffuses.
La contribution pose tout d’abord l’objet de la compliance environnementale qui est d’obtenir que les entreprises soient vigilance à l’égard de toutes sortes de risques pour la prévention desquels elles doivent mettre en place et suivre une série de process pour obtenir une « progression » selon un standard de « vigilance raisonnable », ce qui les oblige à aller au-delà de la simple conformité et les incite à développer leurs propres outils de droit souple dans un cadre d’information et de transparence, afin qu’au-delà le système climatique lui-même en bénéficie selon des objectifs qui lui sont propres.
Puis l’auteure insiste sur la nature préventive des dispositifs de vigilance environnementale, consistant au-delà de l’information à gérer des risques en amont, notamment par le plan de vigilance, unifié ou élaboré risque par risque et devant s’adapter à l’entreprise, notamment dans la cartographie élaborée, l’évaluation se faisant au cas par cas.
Enfin et au regard de la jurisprudence récente, l’auteure décrit la mise en œuvre que permet le dispositif qui peut conduire les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris, puis la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris. L’auteure estime que les juges doivent préciser l’obligation de vigilance environnementale afin que les entreprises puissent s’y ajuster, éclaircissements que sont en train d’apporter ces 2 juridictions.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
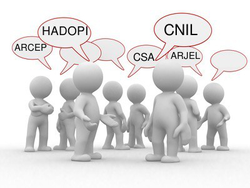
L'Autorité Administrative Indépendante (AAI) est la forme juridique que le Législateur a le plus souvent choisi pour établir des autorités de régulation. L'AAI est seulement sa forme juridique mais le système juridique continental, comme est le Droit français, allemand, italien, etc., y ont attaché une grande importance, suivant en cela la tradition formaliste du droit public. Les Autorités de régulation sont donc avant tout définies comme des autorités administratives indépendantes.
L’élément essentiel est dans le dernier adjectif : le caractère "indépendant" de l’organisme. Cela signifie que cet organe qui n’est pourtant qu’administratif, donc ayant vocation à être placé dans la hiérarchie l’exécutif, n’obéit pas au Gouvernement. En cela, on a très souvent présenté les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu’ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimé du Gouvernement. Cette indépendance pose également la difficulté de leur responsabilité, de la responsabilité de l’État du fait de leurs agissements, et de la reddition de compte (accountability) quant à l’usage qu’ils font de leurs pouvoirs. En outre, l’indépendance des régulateurs est parfois mise en doute si c’est le gouvernement qui conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l‘autorité de régulation. Enfin, l’autonomie budgétaire du régulateur est cruciale pour assurer son indépendance, les autorités ayant le privilège de bénéficier d’un budget -qui n’est pas inséré dans la LOLF- étant cependant très peu nombreuses. On les qualifie alors non plus d' "autorité administrative indépendante" mais d'Autorité Publique Indépendante", le Législateur faisant la distinction entre les deux (loi du 20 janvier 2017).
Le deuxième point concerne le second adjectif : à savoir qu’il s’agit d’un organe "administratif". Cela correspond à l’idée traditionnelle selon laquelle la régulation est le mécanisme par lequel l’État intervient dans l’économie, selon l’image d’une sorte de déconcentration des ministères, dans le modèle scandinave de l’agence. Si l’on se laisse enfermer dans ce vocabulaire, on en conclut que cet organisme administratif rend une décision administrative qui fait l’objet d’un recours devant un juge. Ainsi en premier lieu, il s’agirait d’un recours de premier instance et non pas d’un jugement puisque l’autorité administrative n’est pas un tribunal. En second lieu, le juge naturel du recours devrait être le juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision administrative rendue par une autorité administrative. Mais, l’Ordonnance du 1ier décembre 1986 sur la concurrence et la libéralisation des prix, parce qu’elle entendait précisément briser cette idée d’une économie administrée pour imposer la liberté des prix l’idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d’AAI soient portées devant la Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains grands auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d’appel de Paris était devenue une juridiction administrative. Mais aujourd’hui, le système procédural est devenu d’une extrême complexité car suivant les AAI et suivant les différentes sortes de décisions adoptées, elles relèvent d’un recours soit devant la Cour d’appel de Paris, soit devant le Conseil d'État. Si l’on observe les lois successives qui modifient le système, on constate qu’après cette grande position de principe de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, notamment dans la régulation financière. Doit-on par logique en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police administrative et à une économie administrée par l’État ?
Enfin, le troisième terme est le nom lui-même : « l’autorité ». Il signifie en premier lieu d'une entité dont le pouvoir tient avant dans son "autorité". Mais il marque qu'il n'est pas une juridiction, qu'il prend des décisions unilatérales. C’était sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le juge judiciaire ! En effet, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose que toute personne a droit à un tribunal impartial en matière civile et pénale. Or, la notion de « matière pénale » ne se coïncide pas avec la notion française formelle de droit pénal mais vise la notion factuelle, large et concrète, de répression. Ainsi, par un raisonnement qui va à rebours, un organisme, quelque soit la qualification qu’un État lui aura formellement conférée, qui a une activité de répression, agit "en matière pénale". De ce seul fait, au sens européen, il est un tribunal. Cela déclenche automatiquement une série de garanties fondamentales de procédure, au bénéfice de la personne qui risque d’être l’objet d’une décision de sa part. Une série de jurisprudence, aussi bien de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel a conforté cette juridictionnalisation des AAI.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

D’une façon paradoxale, la notion de conflit d’intérêts semble n'être mise au centre du droit que récemment en Droit économique, aussi bien en Droit des sociétés qu'en Droit public. Cela tient à la philosophie qui anime ces deux branches du Droit, très différentes pour chacune, et qui a changé dans chacune.
En effet et pour commencer par le Droit public, dans la tradition française, du côté de l‘État, celui qui le sert par une sorte d'effet naturel fait passer l’intérêt général incarné par l’État avant son intérêt personnel : il y a certes une opposition d’intérêts, à savoir l’intérêt personnel de l’agent public qui voudrait par exemple travailler moins et gagner plus, et l’intérêt commun de la population, qui voudrait payer moins d’impôts et par exemple bénéficier de trains qui arrivent toujours à l’heure et l'intérêt général qui serait par exemple la construction d'un réseau ferroviaire européen.
Mais ce conflit serait résolu "naturellement" car l’agent public, ayant « le sens de l’intérêt général » et étant animé par le "sens du service public", se sacrifie pour servir l’intérêt général. Il reste tard à son bureau et fait arriver les trains à l’heure. Cette théorie du service public était l’héritage de la Royauté, système dans lequel le Roi est au service du Peuple, comme l’aristocratie, au "service du Roi". Il ne pourrait donc y avoir de conflit d’intérêts, ni dans l’administration ni dans les entreprises publiques, ni à observer, ni à gérer ni à dissoudre. La question ne se pose pas...
Prenons maintenant du côté des entreprises, vues par le Droit des sociétés. Dans la conception classique de celui-ci, les mandataires sociaux sont nécessairement associés de la société et les bénéfices sont obligatoirement répartis entre tous les associés : le contrat de société est un « contrat d’intérêt commun ». Ainsi, le mandataire social travaille en sachant que les fruits de ses efforts lui reviendront à travers les bénéfices qu’il recevra en tant qu’associé. Quel que soit son égoïsme - et il faut même que le mandataire le soit, ce mécanisme produit la satisfaction de tous les autres associés qui mécaniquement recevront aussi en partage les bénéfices. L'égoïsme est bien le moteur du système, comme dans la théorie classique du marché et de la concurrence. Ainsi, dans le mécanisme sociétaire, il n’y a jamais de conflit d’intérêt dès l’instant où le mandataire social est obligatoirement associé : il travaillera toujours dans l’intérêt des associés puisqu’en cela il travaille pour lui-même. Comme le Droit des sociétés pose que la perte de la société sera aussi encourue et subie par tous les associés, il évitera également cette perspective.. Là encore, il n'est besoin d'aucun contrôle. La question d'un conflit d'intérêt entre le mandataire et ceux qui l'ont conféré cette fonction ne se pose structurellement pas.
Ces deux représentations se sont révélées toutes deux inexactes. Elles étaient basées sur des philosophies certes différentes - l'agent public étant censé dépassé son intérêt propre, le mandataire social étant censé servir l'intérêt commun ou l'intérêt social par souci de son intérêt propre - mais c'est un raisonnement unique que ces deux représentations ont été défaites.
Prenons la première portant sur le Droit public : le « sens de l’État » n’est pas à ce point partagé dans l’administration et les entreprises publiques, que les personnes qui y travaillent se sacrifient pour le groupe social. Ce sont des êtres humains comme les autres. Des chercheurs en économie et en finance, par un réflexion élémentaire de soupçon, qui ont fait voler en éclat ces représentations politiques et juridiques. Plus particulièrement, on a constaté que le train de vie institutionnel des entreprises publiques, très proches du gouvernement et de leurs dirigeants, était souvent peu justifié alors qu'il est payé par le contribuable, c'est-à-dire par le groupe social qu’elles prétendaient servir. L’Europe, en affirmant dans le Traité de Rome le principe de "neutralité du capital des entreprises", c’est-a-dire l’indifférence au fait que l’entreprise ait pour actionnaire une personne privée ou une personne publique, a validé cette absence de dépassement de son intérêt particulier par le serviteur de l’État, devenu simple agent économique. Cela a permis de rejoindre le constat fait pour le Droit des sociétés.
La désillusion y fut de même ampleur. Il a été observé que le mandataire social, être humain ordinaire, n'est pas dévoué à l'entreprise et n’a pas pour seul avantage des bénéfices qu’il recevra plus tard comme associé. Il en reçoit parfois très peu alors il peut recevoir de très multiples avantages (financiers, pécuniaire ou en nature, indirects ou indirects). Les autres associés voient leur bénéfice diminuer d’autant. Ils sont ainsi en conflit d’intérêts. Plus encore, le mandataire social a été élu par l’assemblée des actionnaires, c'est-à-dire concrètement, l’actionnaire majoritaire ou l’actionnaire « contrôlaire » (actionnaire de contrôle) et non par tous. Il peut même n'être pas associé ("haut dirigeant").
Le fait même que la situation ne soit plus qualifiée par des juristes, à travers les qualifications du Droit classique des sociétés, empruntant encore au Droit civil des contrats, les qualifications provenant davantage des théories financiers, empruntant à la théorie de l'agence, a changé radicalement la perspective. Les présupposés ont été inversés : par un même "effet de nature", le conflit d’intérêts a été dévoilé comme existant structurellement entre le dirigeant, le "manager" et l’actionnaire minoritaire. L’actionnaire minoritaire n’ayant pas le pouvoir de fait de révoquer le mandataire social puisqu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, la question ne se pose même plus de déterminer si le dirigeant a ou n'a pas un statut sociétaire : l'actionnaire minoritaire ne dispose de que du pouvoir de céder ses titres, si la gestion du manager lui est défavorable (droit de sortie) ou de pouvoir de dire, de protester et de faire savoir. Cela suppose qu'il soit informé, ce qui va mettre au centre d'un nouveau droit des sociétés l'information, voire la transparence.
Ainsi, ce conflit d’intérêts trouve une solution dans la cession effective des titres, au-delà du principe juridique de négociabilité. C’est pourquoi si la société est cotée, le conflit d’intérêts se traduit dialectiquement dans un rapport entre le mandataire social et le marché financier qui, par sa liquidité, permet la sanction du mandataire, et assure par ailleurs l'information, le marché financier et l'actionnaire minoritaire devenant identiques. Le manager pourrait certes avoir le « sens de l’intérêt social », une sorte d’équivalent de sens de l’État, s’il a une déontologie, ce qui alimenterait une autorégulation. Peu de personnes croient à la réalité de cette hypothèse. Par pragmatisme, on admet plus volontiers que le manager préfèrera son intérêt à celui de l’actionnaire minoritaire. En effet, il peut servir son intérêt personnel plutôt que l’intérêt au service duquel un pouvoir lui a été donné grâce à la rente informationnelle dont il est doté, et à l’asymétrie d’information dont il bénéficie. Toute la régulation va intervenir pour réduire cette asymétrie d’information et en doter l’actionnaire minoritaire grâce au régulateur qui défend les intérêts du marché contre les mandataires sociaux, au besoin à travers du droit pénal. Mais la croyance dans la bénévolance des managers a repris vigueur récemment avec la corporate social responsability, cette responsabilité sociale de l'entreprise par laquelle les dirigeants expriment leur souci des autres.
Le repérage des conflits d’intérêts, leur prévention et leur gestion sont en train de transformer le Droit de la Régulation financière, puis le Droit commun de la Régulation, car aujourd’hui on ne croit plus a priori que les personnes dépassent leur intérêt personnel pour servir l’intérêt des autres. C'est peut-être pour retrouver une confiance, voire une sympathie, que les entreprises ont investi dans une responsabilité sociale. Celle-ci s'élabore par un droit qui fût tout d'abord très souple mais qui peut exprimer aussi un souci de l'intérêt général. En cela, elle peut rencontrer le Droit de la Compliance et exprimer de la part des entreprises un souci de l'intérêt général, si les entreprises en apportent la preuve.
Pour prendre un exemple de conflit d'intérêts qui ont débouché sur des changements juridiques consistant, il a été relevé la situation potentielle dangereuse des agences de notations lorsqu'elles sont à la fois payées par les banques, pour les conseiller et concevoir des produits, tout en étant la source des notations, principaux indices à partir desquels les investissements s’opèrent. Or les banques sont les premiers intermédiaires financiers. Ces conflits d'intérêts sont donc systémiquement dangereux. C'est pourquoi en Europe c'est l'ESMA qui exerce un contrôle sur ces agences de notation.
Le repérage des conflits d'intérêts, qui consiste le plus souvent à changer la façon dont on observe une situation - qui paraissait normal jusqu'au moment où l'on change de regard -, la perspective morale et la perspective juridique, la confiance que l'on a dans tel ou tel personnage de la vie modifiant ce regard, est aujourd'hui ce qui fait bouger le plus le Droit de la Régulation;
Cela est vrai du Droit public et du Droit des sociétés, saisis par le Droit de la Régulation, ici transformé par le Droit de la Compliance, notamment par les lanceurs d'alerte. Mais cela est également vrai que toutes les institutions politiques et des élus.
Car une règle se dégage : plus la notion de conflit d'intérêts devient centrale et plus il faut prendre acte que la confiance n'est plus donnée a priori, ni à une personne, ni à une fonction, ni à un mécanisme, ni à un système. La confiance n'est plus donnée qu'a posteriori dans des procédures alourdissant l'action, où l'on doit donner à voir en continu que l'on a mérité cette confiance.