Matières à Réflexions
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de la contribution : Plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissance, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Juridiquement, l’État est un sujet de droit public qui se définit par un territoire, un peuple et des institutions. Il agit dans l'espace international et émet des normes. Politiquement, il a la légitimité requise pour exprimer la volonté du corps social et exercer la violence dont il prive les autres sujets de droit. Il est souvent été reconnaissable par sa puissance : son usage de force publique, sa puissance budgétaire, sa puissance juridictionnelle. Ces trois puissances déclinant ou étant concurrencées par des mécanismes privés, internationaux et donnant davantage satisfaction, l'on a prédit la disparition de l’État, pour la déplorer ou pour danser sur son cadavre.
Avec un tel arrière-plan, dans les théories actuelles de la Régulation , principalement construits par la pensé économique et à première vue l'on pourrait dire que l’État est avant-tout l'ennemi. Et cela pour deux raisons principales. La première est théorique et de nature négative. Les tenants de la théorie de la Régulation dénient à l’État les qualités politiques énoncées ci-dessus. L’État ne serait pas un "être" mais bien plutôt un groupe d'individus, fonctionnaires, élus et autres êtres humains concrets, n'exprimant rien d'autres que leurs intérêts particuliers, venant en conflit avec d'autres intérêts, et utilisant leurs pouvoirs pour servir les premiers plutôt que les seconds comme tout un chacun. La théorie de la Régulation, jouxtant ici la théorie de l'agence, a alors pour fin de contrôler les agents publics et les élus dans lesquels il n'y a pas de raison de faire confiance a priori.
La seconde est pratique et de nature positive. L’État ne serait pas une "personne", mais une organisation. L'on retrouve ici la même perspective que pour la notion d'entreprise, que les juristes conçoivent comme une personne ou un groupe de personnes tandis que les économistes qui conçoivent le monde à travers le marché la représente comme une organisation. L’État comme une organisation devrait être "efficace", voire "optimal". C'est alors la fonction pragmatique du Droit de la Régulation. Or, lorsqu'il est régi par le droit traditionnel, empêtré par les illusions quasiment religieuses de l'intérêt général, voire du contrat social, il est sous-optimal. Il s'agit de le rendre plus efficace.
Pour cela, en tant qu'organisation, l’État est notamment découpé, en agences ou en autorités administratives indépendantes, régulateurs qui gèrent au plus proche les sujets, ce qui pour effet heureux de diminuer l'asymétrie d'information et de faire renaître la confiance dans un lien direct. L’État unitaire, distant et sûr de lui est abandonné pour une conception souple et pragmatique d'un État stratège qui aurait enfin compris qu'il est une organisation comme une autre...
Le Droit de la concurrence adopte cette conception de l’État, dont il a posé dès le départ qu'il était un opérateur économique comme un autre. C'est ainsi qu'est souvent présentée une conception qui serait plus "neutre" du monde.
Les crises successives, qu'elles soient sanitaires ou financières, ont produit un effet de balancier.
L'on crédite de nouveau les notions d'intérêt général ou de biens communs d'un valeur autonome et la nécessité de dépasser les intérêts immédiats et de trouver des personnes pour porter des intérêts supérieurs ou de prendre en charge les intérêts d'autrui, même un autrui non immédiat, s'est fait jour.
Ainsi, l’État ou l'autorité publique, réapparaît dans la mondialisation. Le Droit de la Compliance ou la Responsabilité sociétale des entreprises cruciales sont en train de converger vers une considération de l’État, qui ne peut être réduit à une pure et simple organisation réceptacle des externalités.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "compliance" est l'exemple-type d'un problème de traduction.
En effet, le terme anglais "Compliance" est le plus souvent traduit par le terme français de "Conformité". Mais à lire les textes, notamment en Droit financier, la "conformité" vise plutôt les obligations professionnelles, visant principalement la déontologie et la conduite des professionnels de marché, notamment des prestataires de service d'investissement. C'est à la fois une définition plus nette dans ses contours (et en cela plus sûre) et moins ambitieuse que celle exprimée par la "compliance". Il est dès lors et pour l'instant plus prudent de conserver, même en langue française, l'expression de "Compliance".
La définition de la Compliance est à la fois contestée et très variable, puisque selon les auteurs, elle va des seules obligations professionnelles des intervenants des marchés financiers jusqu'à l'obligation à ceux qui y sont soumis de respecter les lois et règlements, c'est-à-dire l'obligation générale que nous avons tous de respecter le Droit. A les lire, la Compliance serait le Droit lui-même.
Vue du point de vue du Droit, la Compliance est un ensemble de principes, de règles, d'institutions et de décisions générales ou individuelles, corpus dont l'effectivité est le souci premier, dans l'espace et dans le temps afin des buts d'intérêt général visés par ces techniques rassemblées soient concrétisés.
La liste de ces buts, qu'ils soient négatifs ("lutter contre" : la corruption, le terrorisme, le détournement de fonds publics, le trafic de drogues, le trafic d'êtres humain, le trafic d'organe, le trafic de biens toxiques et contagieux - médicaments, produits financiers, etc.) ou positifs ("lutter pour" : l'accès de tous aux biens essentiels, la préservation de l'environnement, les droits fondamentaux des êtres humains, l'éducation, la paix, la transmission de la planète aux générations futures) montre qu'il s'agit de buts politiques.
Ces buts correspondent à la définition politique du Droit de la Régulation.
Ces buts politiques exigent des moyens qui excèdent les forces des États, par ailleurs enfermés dans leurs frontières.
Ces buts monumentaux ont donc été internalisés par les Autorités publiques dans des opérateurs globaux. Le Droit de la Compliance correspond à une structuration nouvelles de ces opérateurs globaux. Cela explique notamment que les lois nouvelles mettent en place des répressions non seulement objectives mais structurelles, comme le font en France les lois Sapin 2 (2016) ou établissant une obligation de vigilance (2017).
Cette internationalisation du Droit de la Régulation dans les entreprises implique que les Autorités publiques supervisent désormais celles-ci, même si celles-ci n'appartiennent pas à un secteur supervisé, ni même à un secteur régulé, mais par exemple participent au commerce international.
Le Droit de la Compliance exprime donc une volonté politique globale relayé par un Droit nouveau violent, le plus souvent répressif, sur les entreprises.
Mais il peut aussi exprimer de la part des opérateurs, notamment les "opérateurs cruciaux" une volonté propre d'avoir eux-mêmes souci de ces buts globaux monumentaux, qu'ils soient de nature négative ou positive. Cette dimension éthique, exprimée notamment par la Responsabilité Sociétale, est la continuation de l'esprit du service public et le souci de l'intérêt général, élevés mondialement.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
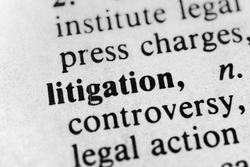
Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement constituées par la trilogie que constituent le droit de saisir le tribunal, c'est-à-dire de former une action en justice, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
L'action en justice fût longtemps considéré comme un "pouvoir", c'est-à-dire un mécanisme inséré dans l'organisation de l'institution juridictionnelle, puisque c'est par l'acte de saisine, empruntant l'accès par laquelle la personne entre dans la machine juridictionnelle, que celle-ci se met en marche.
Mais notamment depuis les travaux de René Cassin et d'Henri Motulsky, l'action en justice est considérée comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative dont toute personne est titulaire pour demander à un juge que celui-ci statue sur la prétention que le demandeur articule dans une allégation, c'est-à-dire une histoire mêlant le fait et le droit dans un édifice et auquel il demande au juge de tirer comme conséquence de lui attribuer un bénéfice, par exemple l'annulation d'un acte qui lui fait grief, ou l'attribution de dommages et intérêts, ou le refus de le condamner (car la défense est également l'exercice du droit d'action).
L'action en justice est reconnue désormais non plus comme un pouvoir mais comme un "droit d'action", dont la nature est autonome de la demande qui est faite au tribunal : un droit subjectif processuel qui double le droit subjectif substantiel (par exemple le droit à réparation) et assure l'effectivité de celui-ci mais qui en est autonome. Cette autonomie et cette unicité par rapport à la variété des contentieux (civils, pénaux ou administratifs) fait du droit d'action un pilier du "Droit processuel" sur lequel se construit le droit européen et le droit constitutionnel. En effet, le Droit constitutionnel de la Régulation est en Europe avant tout constitué de principes processuels (droits de la défense, impartialité, droit d'action), le principe Non bis in idem n'étant qu'une expression du droit d'action, mais c'est une interdiction d'un double jugement pour un même fait ce qui n'interdit pas un double déclenchement de l'action (et pénale, et civile, et administrative). Cette unicité processuelle a contribué à diminuer la séparation jadis radicale entre le Droit pénal, le Droit administratif, voire le Droit civil, jadis nettement éloignés les uns des autres dans la construction traditionnelle des systèmes juridiques et qui convergent aujourd'hui dans le Droit de la Régulation et de la Compliance.
Plus encore, le droit subjectif d'action en justice est un droit humain. Et l'un des plus importants. En effet, il exprime "le droit au juge" parce que, par son exercice, la personne oblige un juge à lui répondre, c'est-à-dire à écouter sa prétention (le contradictoire découlant donc de l'exercice du droit d'action).
Ainsi le droit d'action paraît le propre de la personne, du justiciable, de la "partie". C'est pourquoi l'attribution par la Loi du pouvoir pour les Régulateurs de s'auto-saisir, ce que l'on comprend en raison de l'efficacité du procédé, pose difficulté dès l'instant que cela constitue celui-ci en "juge et partie", puisque le Régulateur est en matière répressive considéré comme un tribunal, et que le cumul de la qualification de tribunal et de la qualité de partie est une atteinte consubstantielle au principe d'impartialité. De la même façon l'obligation que le Droit de la Compliance engendre pour les opérateurs de se juger eux-mêmes les oblige à un dédoublement semblable qui pose maintes difficultés procédurales, notamment dans les enquêtes internes.
Ainsi le Droit classique et les Droits de la Régulation et de la Compliance s'écartent toujours plus l'un de l'autre. D'une façon générale, l'on distingue classiquement l'action publique, qui est exercée par le Ministère public (appelé souvent le parquet) par laquelle celui qui s'exprime (le procureur) demande la protection de l'intérêt général et l'action privée, exercée par une personne privée ou une entreprise, qui vise à satisfaire son intérêt privé légitime. L'existence de cet intérêt légitime suffit à la personne d'exercer son droit processuel d'action.
Mais en premier lieu, elle ne pourrait prétendre l'intérêt général parce qu'elle n'est pas agent de l’État et les organisations, comme les associations ou autres Organisations non-gouvernementales, poursuivent un intérêt collectif, ce qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général l. Ce principe processuel selon lequel "nul ne plaide par procureur" est aujourd'hui dépassé. En effet et par souci d'efficacité, le Droit admet que des personnes agissent pour que la règle de droit s'appliquent à l'encontre de sujets qui, sans cette action-là, ne rendraient pas de compte. Par ce maniement procédural de la théorie des incitations, car celui qui agit est récompensé tandis qu'il sert l'intérêt général, concrétisant la règle de droit objective et contribuant à produire un effet disciplinaire sur un secteur et des opérateurs puissants, le droit procédural classique est transformé par l'analyse économique du droit. Le mécanisme américain de la class action a été importé en France par une loi récente, de 2014, sur "l'action de groupe" (assez restrictive) mais cette "action collective" continue de n'être pas admise dans l'Union européenne, même si la Commission européenne travaille à favoriser les mécanismes de private enforcement, participant de la même idée.
En second lieu, il peut arriver que le Droit exige de la personne titulaire qu'elle ait non seulement un "intérêt légitime à agir" mais encore une "qualité à agir". Cela est vrai notamment les divers mandataires sociaux au sein des opérateurs. Par souci d'efficacité, le système juridique tend à distribuer de nouvelles "qualités à agir" alors même qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, par exemple dans le nouveau système des lanceurs d'alerte, qui peuvent agir alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt apparent.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'impartialité est la qualité, voire la vertu, que l'on exige du juge, non seulement de celui qualifié expressément comme tel mais encore de celui qui qui a pour rôle de juger autrui (sans en avoir le nom).
Elle ne peut pas se définir comme l'aptitude positive absolue, à savoir l'absence totale de préjugé, l'aptitude héroïque pour une personne de faire totalement abstraction de ce qu'elle est, de ses opinions et de son histoire personnelles. Cette vertu héroïque est un non-sens car non seulement elle est inexacte, impossible mais elle n'est pas souhaitable car une personne n'est pas une machine. Elle ne doit pas l'être car une bonne justice est une justice humaine. En cela, l'impartialité renvoie à une conception philosophique de ce qu'est la justice et ce qu'est la Régulation, non pas des machines mais des systèmes qui doivent garder en leur centre la personne humaine (Sunstein).
Ainsi l'impartialité s'articule avec la nature subjective de l'appréciation non seulement inévitable mais encore souhaitable que le juge fait des situations. Parce que le droit est raisonnable ne se définit que négativement : l'absence de partialité.
L'impartialité se définit en premier lieu comme une qualité subjective et individuelle, à savoir l'interdiction pour la personne qui prend une décision ayant un effet sur la situation d'autrui (ce qui est le cas d'un juge) d'avoir un intérêt particulier dans cette situation. L'interdiction constitutionnelle d'être "juge et partie" est ainsi l'expression du principe d'impartialité. Cette définition jouxte l'exigence par ailleurs générale d'absence de conflit d'intérêts.
L'impartialité se se définit en deuxième lieu comme une qualité objective et individuelle, à savoir l'interdiction pour une personne qui a déjà connu du cas d'en connaître de nouveau (parce qu'elle a déjà eu une opinion à son propos, elle s'est constituée un pré-jugé objectif).
L'impartialité se se définit en troisième lieu comme une qualité objective et structurelle, qui oblige l'organe qui prend des jugements à "donner à voir" une structure le rend apte à cette impartialité, impartialité objective que les tiers pourront voir et qui engendre confiance dans sa capacité à juger sans partialité. Cette théorie d'origine anglaise a été reprise par le droit européen dans l'interprétation donnée de la Convention européenne des droits de l'homme. L'expression d' "impartialité apparente" a parfois donné lieu à des contresens. En effet, loin d'être moins exigeante (en ce qu'il ne s'agirait "que" de se contenter d'une apparence d'impartialité et non pas d'une impartialité véritable), il s'agit au contraire d'exiger plus, non seulement d'une impartialité véritable, mais encore d'une impartialité qui se donne à voir à tous. Cela conduit notamment à l'obligation de transparence, ce à quoi les institutions, notamment étatiques, n'étaient pas forcément obligées par le Droit.
Longtemps le Régulateur, en ce qu'il prend la forme d'une Autorité Administrative, n'était pas considéré comme une juridiction, l'on considéra longtemps qu'il n'était pas directement soumis à cette exigence. Par une jurisprudence éclatante, les tribunaux nationaux considèrent désormais que les autorités de régulation sont "au sens européen" des juridictions, ce qui implique le déclenchement au bénéfice des opérateurs mis en cause des garanties fondamentales de procédure.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
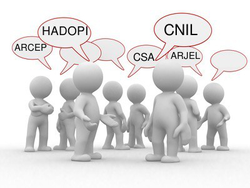
L'Autorité Administrative Indépendante (AAI) est la forme juridique que le Législateur a le plus souvent choisi pour établir des autorités de régulation. L'AAI est seulement sa forme juridique mais le système juridique continental, comme est le Droit français, allemand, italien, etc., y ont attaché une grande importance, suivant en cela la tradition formaliste du droit public. Les Autorités de régulation sont donc avant tout définies comme des autorités administratives indépendantes.
L’élément essentiel est dans le dernier adjectif : le caractère "indépendant" de l’organisme. Cela signifie que cet organe qui n’est pourtant qu’administratif, donc ayant vocation à être placé dans la hiérarchie l’exécutif, n’obéit pas au Gouvernement. En cela, on a très souvent présenté les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu’ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimé du Gouvernement. Cette indépendance pose également la difficulté de leur responsabilité, de la responsabilité de l’État du fait de leurs agissements, et de la reddition de compte (accountability) quant à l’usage qu’ils font de leurs pouvoirs. En outre, l’indépendance des régulateurs est parfois mise en doute si c’est le gouvernement qui conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l‘autorité de régulation. Enfin, l’autonomie budgétaire du régulateur est cruciale pour assurer son indépendance, les autorités ayant le privilège de bénéficier d’un budget -qui n’est pas inséré dans la LOLF- étant cependant très peu nombreuses. On les qualifie alors non plus d' "autorité administrative indépendante" mais d'Autorité Publique Indépendante", le Législateur faisant la distinction entre les deux (loi du 20 janvier 2017).
Le deuxième point concerne le second adjectif : à savoir qu’il s’agit d’un organe "administratif". Cela correspond à l’idée traditionnelle selon laquelle la régulation est le mécanisme par lequel l’État intervient dans l’économie, selon l’image d’une sorte de déconcentration des ministères, dans le modèle scandinave de l’agence. Si l’on se laisse enfermer dans ce vocabulaire, on en conclut que cet organisme administratif rend une décision administrative qui fait l’objet d’un recours devant un juge. Ainsi en premier lieu, il s’agirait d’un recours de premier instance et non pas d’un jugement puisque l’autorité administrative n’est pas un tribunal. En second lieu, le juge naturel du recours devrait être le juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision administrative rendue par une autorité administrative. Mais, l’Ordonnance du 1ier décembre 1986 sur la concurrence et la libéralisation des prix, parce qu’elle entendait précisément briser cette idée d’une économie administrée pour imposer la liberté des prix l’idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d’AAI soient portées devant la Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains grands auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d’appel de Paris était devenue une juridiction administrative. Mais aujourd’hui, le système procédural est devenu d’une extrême complexité car suivant les AAI et suivant les différentes sortes de décisions adoptées, elles relèvent d’un recours soit devant la Cour d’appel de Paris, soit devant le Conseil d'État. Si l’on observe les lois successives qui modifient le système, on constate qu’après cette grande position de principe de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, notamment dans la régulation financière. Doit-on par logique en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police administrative et à une économie administrée par l’État ?
Enfin, le troisième terme est le nom lui-même : « l’autorité ». Il signifie en premier lieu d'une entité dont le pouvoir tient avant dans son "autorité". Mais il marque qu'il n'est pas une juridiction, qu'il prend des décisions unilatérales. C’était sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le juge judiciaire ! En effet, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose que toute personne a droit à un tribunal impartial en matière civile et pénale. Or, la notion de « matière pénale » ne se coïncide pas avec la notion française formelle de droit pénal mais vise la notion factuelle, large et concrète, de répression. Ainsi, par un raisonnement qui va à rebours, un organisme, quelque soit la qualification qu’un État lui aura formellement conférée, qui a une activité de répression, agit "en matière pénale". De ce seul fait, au sens européen, il est un tribunal. Cela déclenche automatiquement une série de garanties fondamentales de procédure, au bénéfice de la personne qui risque d’être l’objet d’une décision de sa part. Une série de jurisprudence, aussi bien de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel a conforté cette juridictionnalisation des AAI.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Deffains, "De la dette à l’obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de cette contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La contribution s’appuie sur la définition de la Compliance en ce qu’elle requiert des grandes entreprises de contribuer à la réalisation des Buts Monumentaux, notamment la préservation des droits humains et des systèmes, par exemple système climatique.
Cette exigence est confrontée à la notion de dette telle qu’elle résulte aujourd’hui des travaux ancien ou nouveaux disponibles dans la science économique. En effet, dans l’économie primitive la dette ne renvoie pas seulement aux échanges mais à un dû de nature éthique et sociale ramenant vers le collectif. L’analyse économique du Droit a mis en valeur cette situation où une partie des entités impliquées dans une situation bénéficie des externalités positives ou endurent seule des externalités négatives, ce qui crée une situation de dette : cela engendre une obligation de corriger la défaillance de marché par une obligation de gestion des risques, telle qu’on la voit exprimée par l’Obligation de Compliance. Cela suppose que l’on peut utiliser le calcul économique pour quantifier cette dette : cela aboutit aux nouvelles propositions faites en matière de comptabilisation de la biodiversité.
L’auteur souligne ensuite la reconnaissance de la dette comme source d’une obligation de compliance. Cela peut être exprimé par la notion classique d’obligation naturelle dont on peut remonter la trace dans le Code civil ou à travers les conceptions plus solidaristes ou politiques du Droit, liées à la responsabilité morales, l’équilibre moral global renvoyant au devoir civique, se superposant à l’équilibre comptable . La dimension politique est alors très présente, comme le montrent par ailleurs Grotius et Kant, puis Bourgeois (solidarisme), Rawls et Sen (justice sociale) qui lient l’engagement profond de chacun avec le groupe . Cela éclaire le rôle essentiel joué par l’Etat et les institutions publics dans la formalisation et l’application de l’obligation de compliance, non seulement pour l’effectivité de celle-ci mais encore pour la prise de conscience par chacun de la part d’équité de celle-ci.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
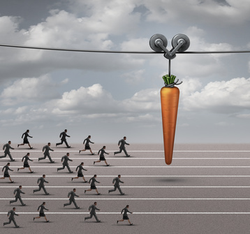
La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.
Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.
Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.
De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les États-Unis ont établi des autorités de régulation dès la fin du XIXème siècle : partant du principe du marché, ils ont tempéré celui-ci par la mise en place de régulateurs, après avoir constaté les défaillances de marché, par exemple en matière de transport, en cas de monopoles économiquement naturels ou de facilités essentielles. La tradition de l’Union européenne est inverse puisque les États, notamment l’État Français, ont estimé que des secteurs d’intérêt général, censés inaptes au schéma concurrentiel car ne correspondant pas au schéma de fonctionnement de la rencontre de l’offre et de la demande, et devant servir les missions de services publics, devaient être tenus par l’État, soit directement par des établissements publics, soit par des entreprises publiques sous tutelle des ministères.
L’évolution en Europe est venue du droit communautaire. En effet, après la seconde guerre mondiale, l’idée a été de construire un marché qui devait être" commun" aux pays européens afin qu’ils ne puissent plus à l’avenir se faire la guerre. Pour atteindre ce but, ont été levées les frontières entre eux grâce aux principes de libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. De la même façon a été interdite la défense par chacun des États de ses propres entreprises nationales par des aides d’État pour que toute entreprise même étrangère puisse pénétrer sur son territoire, afin que s’établisse un marché intérieur commun. Enfin, un droit de la concurrence était nécessaire pour interdire aux entreprises et aux États d’entraver le libre fonctionnement du marché, ce qui aurait ralenti voire stoppé la construction de ce marché intérieur, qui constituait un but essentiellement politique du traité de Rome.
Pour exécuter ce but politique, la Commission européenne et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, précédemment appelée Cour de justice des communautés - CJCE - européennes jusqu’au Traité de Lisbonne) ont interdit tout comportement d’entente ou d’abus de position dominante, même de la part des entreprises publiques, ainsi que tout soutien des États (sauf en cas de crise). De la même façon, dans une parfaite logique politique, mais aussi dans une parfaite contradiction avec les traditions nationales européennes, des textes européens, règlements ou directives, ont libéralisés des secteurs naguère monopolistiques, tout d’abord les télécommunications puis l’énergie. Ce fut le cas pour les télécommunications avec la directive de 1993, de la directive de 1996 pour l’électricité et de la directive de 1998 pour le gaz.
En raison de la hiérarchie des normes, les États, sauf à être poursuivis devant la Cour de justice par la Commission européenne en action pour manquement, ont été obligés de transposer par des lois nationales ces textes européens. Ainsi, de force, le droit communautaire, à la fois par le droit général de la concurrence, mais surtout pour réaliser son but politique de construction d’un marché intérieur unique et initialement pacificateur, a déclenché en Europe un système de régulation économique dans tous les secteurs d’industries de réseaux, système qui était pourtant étranger à la culture des États membres. Ce n’était pas le cas des régulations bancaires et assurantielles, secteurs qui depuis toujours ont été menacés par un risque systémique, et à ce titre régulés et supervisés par les banques centrales nationales depuis très longtemps.
Le Droit communautaire a depuis pendant 30 ans plongé dans les Droits nationaux en les méconnaissant, ce qui a pu être profitable aussi, et sur la base du Droit de la concurrence, la dimension politique du projet européen ayant été oubliée, sans doute au fur et à mesure que la Guerre elle-même s'effaçait des esprits.
Les effets de la globalisation et de la crise financière ont constitué un nouveau tournant dans le Droit communautaire qui, depuis 2010, se construit non plus pour modifier les Droits nationaux - et les détruire en partie - mais pour construire un Droit communautaire nouveau et ne devant ni au Droit de la concurrence ni aux Droits nationaux : un Droit communautaire de la Régulation, qui fait place aux droits des personnes et tente de construire dans le temps un système robuste aux crises. C'est ainsi que par des textes de l'Union européenne de 2014 se construit à la fois une Union bancaire et un droit nouveau des Abus de marché qui vise à établir un droit commun de l'intégrité des marchés financiers.
L'un des enjeux est ce qui pourrait ou devrait être la réconciliation entre les deux Europe, l'Europe économique et toujours peu sociale d'une part et l'Europe des droits de l'Homme, laquelle repose sur la Convention européenne des droits de l'Homme. Cela n'est pas à l'ordre du jour.

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l'initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires
____

____
► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l'ouvrage 📕L'obligation de compliance, le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d'autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026.
____
► Présentation des colloques en construction :
- 29 mai 2026🧮LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL IMPLIQUANT LA COMPLIANCE. ASPECTS JURIDICTIONNELS ET PROCEDURAUX : en lire la présentation
- 12 juin 2026🧮LE "CONTRAT DE COMPLIANCE" : en lire la présentation
- 25 septembre 2026🧮COMPLIANCE ET CONTRAT : CLAUSE APRÈS CLAUSE : en lire la présentation
- octobre 2026🧮COMPLIANCE ET DROIT COMMUN DES CONTRATS : en lire la présentation
- octobre 2026🧮COMPLIANCE, CONTRATS ET CHAINES D'ACTIVITÉS : en lire la présentation
- 2 novembre 2026 🧮LES STRATEGIES D'ENTREPRISES DANS L'ORGANISATION CONTRACTUELLE DES CHAINES DE VALEUR : en lire la présentation
________
Base Documentaire : Doctrine
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le plan est actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.
Il est disponible ci-dessous.
Retourner à la présentation générale du cours, tel qu'il était bâti et proposé en 2018.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Maclouf, "Entités industrielles et Obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article prend le sujet sous l'angle des sciences de gestion et entreprend de résoudre le paradoxe d'organisations industrielles qui expriment l'ambition d'un progrès au bénéfice des personnes, ambition humaniste qui est contredite par les effets produits par cette industrialisation même qui sont dommageable à cette même humanité. L'Obligation de Compliance en ce qu'elle est fondée sur les Buts Monumentaux et s'ancre dans les organisations industrielles tente de résoudre ce paradoxe.
La science des organisations humaines vise à allouer le plus efficacement les ressources rares de la nature en faisant coopérer les individus, cette ingénierie produisant des destructions naturelles, industrielles et sociales plus ou moins anticipées. L'Obligation de Compliance porte l'espoir de mieux les prévenir (But monumental négatif) et les gérer, voire d'améliorer la vie des personnes (But monumental positif) en dépassant les disciplines traditionnelles et en se développant en Ex Ante. Mais les organisations industrielles peuvent aussi récuser le poids des contraintes ainsi engendrées sur elles, et parvenir à l'inverse à une dérégulation. Le débat est actuellement ouvert.
En effet, les entreprises en passant de la logique mécanique de conformité à la logique dynamique de l'Obligation de Compliance se trouvent en incertitude systémique et doivent décider de la stratégie à mettre en oeuvre, entraînant une managérialisation du Droit et autant de nouvelles décisions à prendre. La notion de "projet" revient alors au centre de la régulation des organisations industrielles, plus précisément celle de "projet humaniste" portée par l'Obligation de Compliance, dans de nouvelles configurations où chacun prend sa part dans la chaine de valeur.
L'auteur puise dans les travaux de Raymond Aron et dans le rapport Rueff-Armand pour montrer que le développement de l'organisation industrielle comme mode dominant d’agencement des activités humaines – fondé sur le calcul économique – portait un projet humaniste politiquement élaboré mais que sa réalisation était dès l’origine identifiée comme incertaine par ses auteurs. L’Obligation de Compliance émerge aujourd’hui comme une réponse nécessaire, la régulation des activités industrielles au service d’un progrès humain ne pouvant venir de la seule somme des actions individuelles (salariés, consommateurs, investisseurs), ni des forces stratégiques présentes dans l’environnement stratégique, ni des entités elles-mêmes.
En passant en revue les trente-deux propositions faites par MM. Gauvin et Marleix dans leur rapport d’évaluation, l'auteur montre l’Obligation de Compliance tend à évoluer vers des formes d’ingénieries managériales pour incarner réellement le projet humaniste dans notre contexte industriel. Elle crée des entités capables, au service de l'intérêt général, d’entrer en relation stratégique avec les entités industrielles et de négocier des Obligations qui permettraient d’introduire enfin le projet humaniste dans leur agenda stratégique : la loi dite "Sapin 2" en est un parfait exemple, incitant aux réponses stratégiques adéquates des organisations industrielles, qui ont modifié leurs procédures managériales, pour intégrer de nouveaux projets stratégiques et y impliquer les parties prenantes.
Cependant, parce que l'Obligation de Compliance vise à introduire des buts humanistes dans les projets industriels, elle se retrouve livrée aux forces stratégiques déjà présentes dans leurs activités, confiant aux différents organes des organisations le pouvoir et la mission de définir les stratégies par des délibérations qui seront ensuite, dans l'approche précitée de rationalité économique, déclinées en objectifs et en plans. Or la théorie des organisations montre qu’il n’existe pas un « but » dans une organisation industrielle mais une population de buts dynamiques aux issues incertaines. Contrairement à ce qui est généralement affirmé, la recherche de profit n’est d’ailleurs pas en soi un « but » car il existe une infinité d’agencements et de clés de répartition de la valeur possibles : c'est la condition sine qua non de sa survie, ce qui est différent. Ainsi une organisation rationnelle détermine son projet et doit exclure que, pour l'atteindre, elle ne risque de tomber en faillite. L'Obligation de Compliance vise à propulser des Buts monumentaux au sommet de projets industriels, mais, pour fixer ces projets, l'organisation doit résoudre les oppositions (la conflictualité) par un jeu complexe d'interactions dont les résultats échappent aux participants et leur revient comme des auto transcendances (Jean-Pierre Dupuy).
Pour mieux évaluer et piloter l'Obligation de Compliance, il faut donc observer et comprendre les mécanismes de réponses stratégiques des organisations industrielles. Bien au-delà de la logique de conformité, elles le font notamment en construisant des référentiels ou en contribuant à la construction de ceux-ci et en rattachant elles-mêmes expressément des buts comme la lutte contre la souffrance au travail ou l'égalité entre les femmes et les hommes comme relevant de l'Obligation de Compliance. Le législateur et les agents de régulation doivent donc intégrer, au besoin à l'aide de recherches interdisciplinaires avec les sciences de gestions, les dynamiques de cadrage stratégique des organisations.
Ainsi l'Obligation de Compliance doit être envisagée selon l'auteur comme des "réponses adaptatives face aux crises systémiques et à leurs causes", parant à l'anomie elle-aussi monumentale dont souffre notre société actuelle qui a perdu ses repères et se retrouve dans des incertitudes existentielles. Cette Obligation de Compliance a vocation, au besoin par la contrainte, aux entités industrielles de s'intégrer dans la société en devenant les vecteurs des droits humains et des attentes sociales et environnementales. Le succès de cette Obligation de Compliance suppose une certaine appropriation stratégique par les grandes entreprises des buts, ce qui rend cette Obligation elle-même incertaine.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Rapp, "Compliance, Chaines de valeur et Économie servicielle", ", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée
____
► Résumé de cette contribution (fait par l'auteur) : La contribution étudie, - à partir d’une analyse de chaines de valeur d’entreprises du secteur spatial et de leur évolution récente -, le rôle, la place et les transformations actuelles opérées par les politiques et stratégies de conformité (compliance) dans le contexte d’une mutation industrielle devenue essentielle, le passage d’une économie industrielle à une économie servicielle.
_____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

D’une façon paradoxale, la notion de conflit d’intérêts semble n'être mise au centre du droit que récemment en Droit économique, aussi bien en Droit des sociétés qu'en Droit public. Cela tient à la philosophie qui anime ces deux branches du Droit, très différentes pour chacune, et qui a changé dans chacune.
En effet et pour commencer par le Droit public, dans la tradition française, du côté de l‘État, celui qui le sert par une sorte d'effet naturel fait passer l’intérêt général incarné par l’État avant son intérêt personnel : il y a certes une opposition d’intérêts, à savoir l’intérêt personnel de l’agent public qui voudrait par exemple travailler moins et gagner plus, et l’intérêt commun de la population, qui voudrait payer moins d’impôts et par exemple bénéficier de trains qui arrivent toujours à l’heure et l'intérêt général qui serait par exemple la construction d'un réseau ferroviaire européen.
Mais ce conflit serait résolu "naturellement" car l’agent public, ayant « le sens de l’intérêt général » et étant animé par le "sens du service public", se sacrifie pour servir l’intérêt général. Il reste tard à son bureau et fait arriver les trains à l’heure. Cette théorie du service public était l’héritage de la Royauté, système dans lequel le Roi est au service du Peuple, comme l’aristocratie, au "service du Roi". Il ne pourrait donc y avoir de conflit d’intérêts, ni dans l’administration ni dans les entreprises publiques, ni à observer, ni à gérer ni à dissoudre. La question ne se pose pas...
Prenons maintenant du côté des entreprises, vues par le Droit des sociétés. Dans la conception classique de celui-ci, les mandataires sociaux sont nécessairement associés de la société et les bénéfices sont obligatoirement répartis entre tous les associés : le contrat de société est un « contrat d’intérêt commun ». Ainsi, le mandataire social travaille en sachant que les fruits de ses efforts lui reviendront à travers les bénéfices qu’il recevra en tant qu’associé. Quel que soit son égoïsme - et il faut même que le mandataire le soit, ce mécanisme produit la satisfaction de tous les autres associés qui mécaniquement recevront aussi en partage les bénéfices. L'égoïsme est bien le moteur du système, comme dans la théorie classique du marché et de la concurrence. Ainsi, dans le mécanisme sociétaire, il n’y a jamais de conflit d’intérêt dès l’instant où le mandataire social est obligatoirement associé : il travaillera toujours dans l’intérêt des associés puisqu’en cela il travaille pour lui-même. Comme le Droit des sociétés pose que la perte de la société sera aussi encourue et subie par tous les associés, il évitera également cette perspective.. Là encore, il n'est besoin d'aucun contrôle. La question d'un conflit d'intérêt entre le mandataire et ceux qui l'ont conféré cette fonction ne se pose structurellement pas.
Ces deux représentations se sont révélées toutes deux inexactes. Elles étaient basées sur des philosophies certes différentes - l'agent public étant censé dépassé son intérêt propre, le mandataire social étant censé servir l'intérêt commun ou l'intérêt social par souci de son intérêt propre - mais c'est un raisonnement unique que ces deux représentations ont été défaites.
Prenons la première portant sur le Droit public : le « sens de l’État » n’est pas à ce point partagé dans l’administration et les entreprises publiques, que les personnes qui y travaillent se sacrifient pour le groupe social. Ce sont des êtres humains comme les autres. Des chercheurs en économie et en finance, par un réflexion élémentaire de soupçon, qui ont fait voler en éclat ces représentations politiques et juridiques. Plus particulièrement, on a constaté que le train de vie institutionnel des entreprises publiques, très proches du gouvernement et de leurs dirigeants, était souvent peu justifié alors qu'il est payé par le contribuable, c'est-à-dire par le groupe social qu’elles prétendaient servir. L’Europe, en affirmant dans le Traité de Rome le principe de "neutralité du capital des entreprises", c’est-a-dire l’indifférence au fait que l’entreprise ait pour actionnaire une personne privée ou une personne publique, a validé cette absence de dépassement de son intérêt particulier par le serviteur de l’État, devenu simple agent économique. Cela a permis de rejoindre le constat fait pour le Droit des sociétés.
La désillusion y fut de même ampleur. Il a été observé que le mandataire social, être humain ordinaire, n'est pas dévoué à l'entreprise et n’a pas pour seul avantage des bénéfices qu’il recevra plus tard comme associé. Il en reçoit parfois très peu alors il peut recevoir de très multiples avantages (financiers, pécuniaire ou en nature, indirects ou indirects). Les autres associés voient leur bénéfice diminuer d’autant. Ils sont ainsi en conflit d’intérêts. Plus encore, le mandataire social a été élu par l’assemblée des actionnaires, c'est-à-dire concrètement, l’actionnaire majoritaire ou l’actionnaire « contrôlaire » (actionnaire de contrôle) et non par tous. Il peut même n'être pas associé ("haut dirigeant").
Le fait même que la situation ne soit plus qualifiée par des juristes, à travers les qualifications du Droit classique des sociétés, empruntant encore au Droit civil des contrats, les qualifications provenant davantage des théories financiers, empruntant à la théorie de l'agence, a changé radicalement la perspective. Les présupposés ont été inversés : par un même "effet de nature", le conflit d’intérêts a été dévoilé comme existant structurellement entre le dirigeant, le "manager" et l’actionnaire minoritaire. L’actionnaire minoritaire n’ayant pas le pouvoir de fait de révoquer le mandataire social puisqu’il ne dispose pas de la majorité des droits de vote, la question ne se pose même plus de déterminer si le dirigeant a ou n'a pas un statut sociétaire : l'actionnaire minoritaire ne dispose de que du pouvoir de céder ses titres, si la gestion du manager lui est défavorable (droit de sortie) ou de pouvoir de dire, de protester et de faire savoir. Cela suppose qu'il soit informé, ce qui va mettre au centre d'un nouveau droit des sociétés l'information, voire la transparence.
Ainsi, ce conflit d’intérêts trouve une solution dans la cession effective des titres, au-delà du principe juridique de négociabilité. C’est pourquoi si la société est cotée, le conflit d’intérêts se traduit dialectiquement dans un rapport entre le mandataire social et le marché financier qui, par sa liquidité, permet la sanction du mandataire, et assure par ailleurs l'information, le marché financier et l'actionnaire minoritaire devenant identiques. Le manager pourrait certes avoir le « sens de l’intérêt social », une sorte d’équivalent de sens de l’État, s’il a une déontologie, ce qui alimenterait une autorégulation. Peu de personnes croient à la réalité de cette hypothèse. Par pragmatisme, on admet plus volontiers que le manager préfèrera son intérêt à celui de l’actionnaire minoritaire. En effet, il peut servir son intérêt personnel plutôt que l’intérêt au service duquel un pouvoir lui a été donné grâce à la rente informationnelle dont il est doté, et à l’asymétrie d’information dont il bénéficie. Toute la régulation va intervenir pour réduire cette asymétrie d’information et en doter l’actionnaire minoritaire grâce au régulateur qui défend les intérêts du marché contre les mandataires sociaux, au besoin à travers du droit pénal. Mais la croyance dans la bénévolance des managers a repris vigueur récemment avec la corporate social responsability, cette responsabilité sociale de l'entreprise par laquelle les dirigeants expriment leur souci des autres.
Le repérage des conflits d’intérêts, leur prévention et leur gestion sont en train de transformer le Droit de la Régulation financière, puis le Droit commun de la Régulation, car aujourd’hui on ne croit plus a priori que les personnes dépassent leur intérêt personnel pour servir l’intérêt des autres. C'est peut-être pour retrouver une confiance, voire une sympathie, que les entreprises ont investi dans une responsabilité sociale. Celle-ci s'élabore par un droit qui fût tout d'abord très souple mais qui peut exprimer aussi un souci de l'intérêt général. En cela, elle peut rencontrer le Droit de la Compliance et exprimer de la part des entreprises un souci de l'intérêt général, si les entreprises en apportent la preuve.
Pour prendre un exemple de conflit d'intérêts qui ont débouché sur des changements juridiques consistant, il a été relevé la situation potentielle dangereuse des agences de notations lorsqu'elles sont à la fois payées par les banques, pour les conseiller et concevoir des produits, tout en étant la source des notations, principaux indices à partir desquels les investissements s’opèrent. Or les banques sont les premiers intermédiaires financiers. Ces conflits d'intérêts sont donc systémiquement dangereux. C'est pourquoi en Europe c'est l'ESMA qui exerce un contrôle sur ces agences de notation.
Le repérage des conflits d'intérêts, qui consiste le plus souvent à changer la façon dont on observe une situation - qui paraissait normal jusqu'au moment où l'on change de regard -, la perspective morale et la perspective juridique, la confiance que l'on a dans tel ou tel personnage de la vie modifiant ce regard, est aujourd'hui ce qui fait bouger le plus le Droit de la Régulation;
Cela est vrai du Droit public et du Droit des sociétés, saisis par le Droit de la Régulation, ici transformé par le Droit de la Compliance, notamment par les lanceurs d'alerte. Mais cela est également vrai que toutes les institutions politiques et des élus.
Car une règle se dégage : plus la notion de conflit d'intérêts devient centrale et plus il faut prendre acte que la confiance n'est plus donnée a priori, ni à une personne, ni à une fonction, ni à un mécanisme, ni à un système. La confiance n'est plus donnée qu'a posteriori dans des procédures alourdissant l'action, où l'on doit donner à voir en continu que l'on a mérité cette confiance.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les banques sont régulées car elles n’exercent pas une activité économique ordinaire, en ce que celles-ci engendrent un risque systémique. En effet, dans l’économie réelle, les banques jouent le rôle d’apporter du crédit aux entrepreneurs qui eux opèrent sur les marchés des biens et services, crédits financés surtout grâce aux dépôts faits par des déposants et dans une moindre mesure par les actionnaires, les capitalistes. C’est ainsi que le libéralisme et le capitalisme ont partie liée. Mais les banques ont le pouvoir de créer de la monnaie par le simple jeu d’écritures qu’elles font en écrivant dans leurs livres les prêts qu’elles accordent (monnaie scripturale). Dès lors, les banques partagent avec l’État ce pouvoir extraordinaire de posséder le pouvoir monétaire que certains qualifient de pouvoir souverain. Il est possible que le numérique remette en cause cela, la Régulation hésitant à se saisir des nouveaux instruments dit de "monnaie virtuelle" en tant que "monnaie" ou en tant d'instrument ordinaire de relations coopératives.
Cette nature essentiellement régalienne justifie en premier lieu que l’État choisisse les établissements qui bénéficieront du privilège de créer de la monnaie scripturale, la profession bancaire ayant toujours constitué un monopole. La régulation bancaire est donc d’abord un contrôle ex ante à l’entrée à la profession et à une surveillance de la qualité des personnes et des établissements qui y prétendent.
En outre, les banques et établissements de crédits prêtent par construction plus d’argent qu’ils ne disposent de fonds propres : l’ensemble du système bancaire repose nécessairement sur la confiance de chacun des créanciers de la banque, notamment les dépositaires, qui laissent à sa disposition les fonds dont la banque va ainsi faire l’usage. La régulation bancaire va donc intervenir pour établir des ratios prudentiels, c'est-à-dire ceux qui s’assurent de la solidité de l’établissement, posant ce que les banques peuvent prêter par rapport aux fonds propres et quasi fonds propres dont elles disposent effectivement.
En outre, les banques sont surveillées en permanence par leur régulateur de tutelle, le Banquier central (en France la Banque de France), qui assure la sécurité de tout le système puisque à travers elle, l’État est le prêteur en dernier ressort. Ce qui peut conduire une grande institution financière à prendre des risques excessifs, sachant que l’État la sauvera, ce que la théorie de l’aléa moral (moral hazard) a systématisé. Tous les systèmes monétaires et financiers sont construits sur ces banques centrales, qui sont autonomes des gouvernements, parce que ceux-ci sont trop dépendants des stratégies politiques et ne peuvent engendrer la même confiance que celle qu’apporte une banque centrale. Depuis que les missions des banques centrales se sont accrues et que les notions de Régulation et de Supervision se sont rapprochées, l'on a tendance à considérer qu'elles sont des Régulateurs à part entière.
Par ailleurs, la régulation bancaire est devenue centrale parce que l’activité bancaire n’est plus principalement aujourd’hui le prêt mais l’intermédiation financière.La Régulation bancaire croise alors la Régulation financière. En Europe, la Banque centrale européenne est au centre.
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-M. Ilcheva, "Condamnation de Shell aux Pays-Bas : la responsabilité climatique des entreprises pétrolières se dessine", D. 2021, pp. 1968-1970
____
► Résumé de l'article : Après une brève description de l'affaire en cause au principal, l'auteure explicite dans un premier les fondements du jugement dit "Shell". Elle explique que l'action engagée était fondée sur le droit de la responsabilité civile délictuelle néerlandais, plus précisément le "duty of care" de l'article 6:162 du code civil néerlandais, lequel amène le juge, afin d'établir le fait générateur, à apprécier le comportement de l'entreprise défenderesse au regard du standard de comportement de la personne prudente et raisonnable. Sont également mobilisés par le juge des travaux scientifiques (rapport du GIEC), des normes de droit international (CEDH) et des normes de droit souple (Principes directeurs de l'ONU), afin de caractériser tant le fait générateur que le dommage (notamment futur). Dans un second temps, l'auteure envisage la portée de ce jugement, frappé d'appel au moment de la rédaction de son article. Elle souligne que le juge s'est appuyé sur la notion d'entreprise, permettant ainsi de contourner l'obstacle traditionnel lié à la personnalité morale, et qu'il a retenu ici une responsabilité préventive, tournée vers le futur. Elle termine en mettant en avant les conditions nécessaires pour que ce jugement soit effectif et constate que l'effort demandé à l'entreprise est plus important que celui préconisé par les rapports d'experts.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-S. Borghetti, "The Relation between Tort Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The Author points out that in order to establish civil liability, it is first necessary to find fault, i.e. a deviation from an obligation, which will trigger a secondary obligation, that of reparation. But it can also be argued that it is from liability that this primary obligation arises, civil liability then revealing an obligation which existed only implicitly. That establishes a two-way relationship between liability and obligation. The Compliance Obligation illustrates this, in particular through the Obligation of Vigilance conceived by the French law of 2017.
The author therefore devotes the first part of his contribution to civil liability as a result of an Compliance Obligation, especially the Obligation of Vigilance. issued of the French law of 2017. After discussing whether the constraints generated by compliance should be classified as 'obligations', since there is no creditor, which therefore opens the way to liability in tort, he examines the conditions for incurring such liability, which are difficult, particularly with regard to the burden of proof and the demonstration of the causal link. The requirement concerning the latter may evolve in French law towards the admission of proportional causality, as is now accepted in certain cases in German case law.
In the second part of his contribution, the author deals with the hypothesis of civil liability as an indicator of a Compliance Obligation. He points out that the claims made, particularly in the cases of TotalOuganda (France) and Milieudefensie v. Shell (Netherlands) seek to obtain from the judge a such "revelation".
The author considers that it is not possible to draw from the French 2017 law which refers to article 1240 of the French Civil Code on the liability because this article is referred to only in order to organise the consequences of a breach of article L.225-102-4 of the French Commercial Code organising the Obligation of Vigilance (article 1240 being therefore under the secondary obligation described above) and not to feed what this article L.225-102-4 requires under the primary obligation (defined above).
On the other hand, the Shell judgment derives directly from civil liability an obligation to act. This is understandable if one takes the perspective and the measure of the future challenges posed, in this case in the area of climate change. But the author considers that it is up to the legislator to decide on such a development in Liability Law.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les industries de réseaux sont construites sur les infrastructures de transport, par exemple afférentes à des ondes de télécommunication ou bien le transport de données, ou du gaz ou de l’électricité, qui constituent des facilités essentielles.
Ces infrastructures essentielles sont surveillées par les régulateurs non seulement pour que les opérateurs y aient concrètement un droit d’accès mais encore pour que se construise en Europe un maillage complet de ces infrastructures, pour aboutir par exemple à un système ferroviaire européen.
Ces infrastructures existent également en matière bancaire, financière et assurantielle, qu’il serait vain d’opposer trop facilement aux industries de réseaux, car les places financières reposent sur de gigantesques systèmes informatiques, des chambres de compensation internalisées, qui sont elles-mêmes des infrastructures essentielles, méritant une régulation.
Est alors en articulation la solidité optimale des infrastructures, dont le Régulateur a la charge définitive dans un contrôle permanente sur celui qui les gère, qu'il s'agisse de l’État ou d'un opérateur - que celui-ci soit un opérateur public ou un opérateur privé-, et le dynamisme concurrentiel du secteur que le système peut en outre également confier au même régulateur.
C'est notamment le cas en Régulation financière, qui vise l’optimisation des places, qui sont en concurrence entre elles, et leur sécurité respective, qui constitue elle-même un avantage compétitif, commun à l'ensemble des opérateurs.
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : There is often a dispute over the pertinent definition of Compliance Law, but the scale and force of the resulting obligation for the companies subject to it is clear. It remains difficult to define. First, we must not to be overwhelmed by the many obligations through which the Compliance Obligation takes shape, such as the obligation to map, to investigate, to be vigilant, to sanction, to educate, to collaborate, and so on. Not only this obligations list is very long, it is also open-ended, with companies themselves and judges adding to it as and when companies, sectors and cases require.
Nor should we be led astray by the distance that can be drawn between the contours of this Compliance Obligation, which can be as much a matter of will, a generous feeling for a close or distant other in space or time, or the result of a calculation. This plurality does not pose a problem if we do not concentrate all our efforts on distinguishing these secondary obligations from one another but on measuring what they are the implementation of, this Compliance Obligation which ensures that entities, companies, stakeholders and public authorities, contribute to achieving the Goals targeted by Compliance Law, Monumental Goals which give unity to the Compliance Obligation. Thus unified by the same spirit, the implementation of all these secondary obligations, which seem at once disparate, innumerable and often mechanical, find unity in their regime and the way in which Regulators and Judges must control, sanction and extend them, since the Compliance Obligation breathes a common spirit into them.
In the same way that the multiplicity of compliance techniques must not mask the uniqueness of the Compliance Obligation, the multiplicity of sources must not produce a similar screen. Indeed, the Legislator has often issued a prescription, an order with which companies must comply, Compliance then often being perceived as required obedience. But the company itself expresses a will that is autonomous from that of the Legislator, the vocabulary of self-regulation and/or ethics being used in this perspective, because it affirms that it devotes forces to taking into consideration the situation of others when it would not be compelled to do so, but that it does so nonetheless because it cares about them. However, the management of reputational risks and the value of bonds of trust, or a suspicious reading of managerial choices, lead us to say that all this is merely a calculation.
Thus, the first part of the contribution sets out to identify the Compliance Obligation by recognising the role of all these different sources. The second part emphasises that, in monitoring the proper performance of technical compliance obligations by Managers, Regulators and Judges, insofar as they implement the Compliance Obligation, it is pointless to limit oneself to a single source or to rank them abruptly in order of importance. The Compliance Obligation is part of the very definition of Compliance Law, built on the political ambition to achieve these Monumental Goals of preserving systems - banking, financial, energy, digital, etc. - in the future, so that human beings who cannot but depend on them are not crushed by them, or even benefit from them. This is the teleological yardstick by which the Compliance Obligation is measured, and with it all the secondary obligations that give it concrete form, whatever their source and whatever the reason why the initial standard was adopted.
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Office of Communications (Ofcom) est le régulateur britannique des communications.
Ce régulateur indépendant est compétent à la fois pour les services de télévisions, de radio, de télévision, mais encore de la poste.
A cela, s'ajoutent des missions très diverses, comme non seulement l'attribution des licences mais encore la protection des données ou encore les politiques publiques de diversité et d'égalité.
L'on peut considérer qu'il s'agit des compétences les plus larges que l'on peut conférer à un régulateur au regard des activités de "communication"
Base Documentaire
Référence complète : Grandjean, J.P., rapporteur, Rapport sur l'avocat chargé d'une enquête interne, Conseil de l'Ordre des Avocats, Paris, 8 mars 2016.