Matières à Réflexions
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

En premier lieu, le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à comprendre notamment parce qu'il souffre d’ambiguïté et de confusion du fait de son vocabulaire d'origine anglophone, dans lequel des mots ou expressions proches ou identiques n'ont pourtant pas la même signification.
A tout seigneur tout honneur, c'est le cas pour le terme de "Régulation".
En langue anglaise, regulation vise le phénomène que la langue française exprime par le terme "Réglementation". Mais elle peut aussi viser l'appareillage complet de ce qui va tenir un secteur atteint une défaillance de marché et dans laquelle la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres. On utilisera alors avec précision l'expression Regulatory System, mais aussi le terme Regulation, l'usage de la majuscule signalant la différence. Il est inévitable que dans une lecture rapide, voire par le jeu du numérique, qui écrase les majuscules, et les traductions automatiques, cette distinction de formulation, tenant à une minuscule/majuscule disparaisse. Et la confusion naît.
Les conséquences sont considérables. C'est notamment en raison de cette homonymie, que fréquemment en langue française l'on mette au même niveau le Droit de la Régulation et la réglementation. L'on s'appuiera sur une telle association, de nature tautologique, pour affirmer que "par nature" le Droit de la Régulation serait de "droit public", puisque la réglementation a pour auteur des personnes publiques, notamment l’État ou les Autorités administratives indépendantes que sont les Régulateurs. Reste lors la difficile justification de la présence considérable des contrats, des arbitres, etc. Sauf à critiquer l'idée même de Droit de la Régulation, parce qu'il serait le signe d'une sorte de victoire des intérêts privés, puisque conçus par des instruments de droit privé.
Apparaissent ainsi deux inconvénients majeurs. En premier lieu, cela maintient dans le Droit de la Régulation la summa divisio du Droit public et du Droit privé, qui ne parvient plus à rendre compte de l'évolution du Droit en la matière et conduit des observateurs, notamment des économistes ou des institutions internationales, à affirmer que le Droit de Common Law serait plus adapté aujourd'hui à l'économie mondiale notamment parce que celui-ci fait certes place au Droit administratif, au Droit constitutionnel, etc., mais ne les conçoit pas dans la distinction Droit public/Droit privé, comme continue de le faire le Droit continental de Civil Law.
En second lieu, sans doute parce que ce Droit nouveau puise dans des théories économiques et financières qui se construisent principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'habitude se prend de ne plus traduire. L'on trouve ainsi dans d'autres langues, dans des textes écrits en français par exemple, des phrases comme "le Régulateur doit être accountable".
Il est inexact que l'idée d'accountability , qui renvoie à une reddition des comptes, soit réductible à l'idée de "responsabilité". Les auteurs ne le traduisent pas, ils ne recopient et l'insèrent dans des textes rédigés en français.
L'on passe de la "traduction-trahison" à l'absence de traduction, c'est-à-dire à la domination du système de pensée dont le mot est originaire.
Un des enjeux actuels majeurs de ce phénomène est dans le terme même de la "Compliance". Le terme francophone de "conformité" ne le traduit pas. Pour respecter ce qu'est la compliance, il convient pour l'instant de le recopier, afin de ne pas le dénaturer. L'enjeu est de trouver un mot francophone qui exprime cette idée nouvelle, notamment au regard des systèmes juridiques qui ne sont pas de Common Law, afin que leur cadre général demeure.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les banques sont régulées car elles n’exercent pas une activité économique ordinaire, en ce que celles-ci engendrent un risque systémique. En effet, dans l’économie réelle, les banques jouent le rôle d’apporter du crédit aux entrepreneurs qui eux opèrent sur les marchés des biens et services, crédits financés surtout grâce aux dépôts faits par des déposants et dans une moindre mesure par les actionnaires, les capitalistes. C’est ainsi que le libéralisme et le capitalisme ont partie liée. Mais les banques ont le pouvoir de créer de la monnaie par le simple jeu d’écritures qu’elles font en écrivant dans leurs livres les prêts qu’elles accordent (monnaie scripturale). Dès lors, les banques partagent avec l’État ce pouvoir extraordinaire de posséder le pouvoir monétaire que certains qualifient de pouvoir souverain. Il est possible que le numérique remette en cause cela, la Régulation hésitant à se saisir des nouveaux instruments dit de "monnaie virtuelle" en tant que "monnaie" ou en tant d'instrument ordinaire de relations coopératives.
Cette nature essentiellement régalienne justifie en premier lieu que l’État choisisse les établissements qui bénéficieront du privilège de créer de la monnaie scripturale, la profession bancaire ayant toujours constitué un monopole. La régulation bancaire est donc d’abord un contrôle ex ante à l’entrée à la profession et à une surveillance de la qualité des personnes et des établissements qui y prétendent.
En outre, les banques et établissements de crédits prêtent par construction plus d’argent qu’ils ne disposent de fonds propres : l’ensemble du système bancaire repose nécessairement sur la confiance de chacun des créanciers de la banque, notamment les dépositaires, qui laissent à sa disposition les fonds dont la banque va ainsi faire l’usage. La régulation bancaire va donc intervenir pour établir des ratios prudentiels, c'est-à-dire ceux qui s’assurent de la solidité de l’établissement, posant ce que les banques peuvent prêter par rapport aux fonds propres et quasi fonds propres dont elles disposent effectivement.
En outre, les banques sont surveillées en permanence par leur régulateur de tutelle, le Banquier central (en France la Banque de France), qui assure la sécurité de tout le système puisque à travers elle, l’État est le prêteur en dernier ressort. Ce qui peut conduire une grande institution financière à prendre des risques excessifs, sachant que l’État la sauvera, ce que la théorie de l’aléa moral (moral hazard) a systématisé. Tous les systèmes monétaires et financiers sont construits sur ces banques centrales, qui sont autonomes des gouvernements, parce que ceux-ci sont trop dépendants des stratégies politiques et ne peuvent engendrer la même confiance que celle qu’apporte une banque centrale. Depuis que les missions des banques centrales se sont accrues et que les notions de Régulation et de Supervision se sont rapprochées, l'on a tendance à considérer qu'elles sont des Régulateurs à part entière.
Par ailleurs, la régulation bancaire est devenue centrale parce que l’activité bancaire n’est plus principalement aujourd’hui le prêt mais l’intermédiation financière.La Régulation bancaire croise alors la Régulation financière. En Europe, la Banque centrale européenne est au centre.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


Sur un marché ordinaire de biens et service, l'accès au marché est ouvert à tous, qu'il s'agisse de celui qui offre le bien ou le service (potentiel offreur) ou de celui qui désire se l'approprier (potentiel demandeur). La liberté de la concurrence suppose que ces nouveaux entrants puissent à leur volonté devenir des agents effectifs sur le marché, le potentiel offreur si son dynamisme entrepreneurial l'y pousse, et le potentiel demandeur s'il en a le désir et les moyens (pécuniaires, d'information et de proximité, notamment). L'absence de barrière à l'entrée est présumée ; une barrière résultant d'un comportement anticoncurrentiel sera sanctionnée ex post par l'autorité de concurrence.
La barrière est donc ce qui contrarie le principe d'accès au marché. C'est pourquoi l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en ce qu'elle lutte contre les barrières pour assurer un libre-échange mondial, peut être considérée comme un précurseur d'une Autorité mondiale de la concurrence.
Mais il peut arriver qu'il soit nécessaire d'organiser par la force du Droit un accès, non seulement parce qu'il y a eu une décision de libéralisation un secteur naguère monopolistique, l'accès ne pouvant pas s'exercer par la seule force de la demande et par la seule puissance des potentiels nouveaux entrants, notamment par la puissance de fait des entreprises présentes anciennement monopolistiques. L'Autorité de régulation va construire les accès à des marchés sectoriels dont le seul principe du fonctionnement concurrentiel a été déclaré par le Droit. Cette nécessité peut aussi résulter de phénomènes entravant définitivement ce fonctionnement concurrentiel idéal, comme des monopoles naturels ou des asymétries d'information : le Droit va concrétiser cet accès en distribuant aux parties intéressées des droits subjectifs d'accès.
Il en est ainsi des droits d'accès des opérateurs aux réseaux d'infrastructure essentielle. Même si cet acte s'opère par contrat, celui-ci ne fait que concrétiser un droit subjectif d'accès conféré par la Loi à l'opérateur pour qu'il puisse pénétrer le marché. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.
D'une façon plus politique et sans rapport direct avec une volonté d'installer la concurrence ou de pallier une défaillance de marché, cette organisation des accès peut encore être requise parce qu'il existe une décision politique d'assurer à chacun un accès à des biens communs. La décision jouxte alors la notion de "droit fondamental", par exemple le droit fondamental d'accès au système de soins ou aux médicaments vitaux, ou le droit fondamental d'accès au système numérique, droit subjectif dont le Régulateur devient le gardien à la fois en Ex Ante et en Ex Post.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La notion de "biens communs" renvoie à une conception politique en ce qu'ils visent des biens objectivement marchands comme les biens culturels ou les prestations médicales mais dont la collectivité va poser que chacun doit y avoir accès alors même que l'individu n’a pas les moyens d’en payer le prix exact. C’est alors le contribuable - présent ou futur - ou les partenaires sociaux qui en supporteront le coût, voire certaines entreprises par le mécanisme de "responsabilité sociétale".
Cette protection des biens communs peut être faite par l’État, au nom de l'intérêt du groupe social dont il a la charge et dont il exprime la volonté, à travers notamment la notion d'intérêt général. Dans ce cadre aujourd'hui restreint que représente l’État, une telle référence se heurte au principe de concurrence. Cela est particulièrement net en Europe, qui repose sur une Union construite sur un ordre juridique autonome et intégré dans les États-membres dans lequel la concurrence continue d'avoir valeur de principe et bénéficie du mécanisme de la hiérarchie des normes. L'évolution du droit européen a mis en équilibre le principe de concurrence avec d'autres principes, comme celui de la gestion des risques systémiques, par exemple sanitaires, financiers ou environnementaux et la création de l'Union bancaire montre que le principe de concurrence n'est plus faîtier dans le système européen.
Mais l'on en reste encore à une conception économique et financière de l'Europe que la définition du Droit de la Régulation, lorsqu'on le restreint à la gestion des défaillances de marché alimente. Il est concevable que l'Europe évolue un jour vers une conception plus humaniste de la Régulation, celle-là même que les États européens pratiquent et défendent, notamment à travers la notion de service public. Les services publics concrétisent l'accès de chacun à des biens communs, comme l'éducation, la santé ou la culture.
Paradoxalement, alors même que le Droit ne se met guère en place à l'échelle mondiale, c'est à ce niveau-là que la notion juridique de "biens communs" s'est développée.
Lorsqu'on se réfère à des biens que l'on dit "biens globaux", on vise alors des biens qui sont communs à l'humanité, comme les océans ou les civilisations. C'est tout à la fois le cœur de la nature et le coeur de l'être humain, ce qui plonge le plus dans le passé et le futur. Paradoxalement, la notion de "biens globaux" est plus encore politique en substance mais faute de gouvernement politique mondial, leur protection effective est difficile, leur consécration politique ne pouvant être effective que nationalement ou que simplement déclaratoire internationalement. C’est pourquoi, cet équilibre à leur bénéfice ne s’opère pour l’instant qu’à l’échelle nationale, ce qui renvoie à la difficulté de la régulation de la mondialisation.
Ainsi, les "biens communs" existent juridiquement davantage sous leur face noire : les "maux globaux", contre lesquels un "Droit global" se met effectivement en place. La notion des "maux globaux" constitue une sorte de miroir des biens communs. On observe alors que les pays qui développent des discours juridiques de régulation des maux globaux et des biens globaux déploient de ce fait un droit national unilatéral mondial. C'est le cas des États-Unis, notamment en régulation financière ou plus largement à travers le Droit de la Compliance en train de naître. Les entreprises y ont leur rôle à jouer, notamment à travers les Codes de conduite et la Responsabilité sociétale.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "libéralisation" désigne le processus de fin légal d’une organisation monopolistique d’une économie, d’un secteur ou d’un marché, pour l’ouvrir à la concurrence.
Comme il est rare qu’une économie soit entièrement monopolistique (ce qui suppose qu’il y ait une concentration extrême du pouvoir politique), le phénomène concerne plus particulièrement des secteurs. La libéralisation si elle ne se traduit en droit que par une déclaration d’ouverture à la concurrence, ne se concrétise en fait que par une implantation beaucoup plus lente de celle-ci, car les opérateurs en place ont la puissance d’enrayer l’entrée de potentiels nouveaux entrants. C’est pourquoi le processus de libéralisation n’est effectif que si l’on met en place des autorités de régulation qui de force ouvrent le marché, en affaiblissant au besoin les opérateurs historiques et en offrant des avantages aux nouveaux entrants par une régulation asymétrique.
Cette régulation qui a pour fin de construire une concurrence, désormais permise par la loi.
C'est pourquoi dans un processus de libéralisation la régulation a pour but de concrétiser la concurrence en la construisant. Cette régulation transitoire a vocation à se retirer et les institutions mises en place à disparaître en devenant par exemple de simples chambres spécialisées de l’Autorité générale de concurrence, la régulation étant temporaire lorsqu’elle est liée à la libéralisation.
Elle est distincte de la Régulation des infrastructures essentielles qui, en tant que monopoles naturels, doivent être définitivement régulés. Assez souvent, dans des économies libérales, l’État a demandé à des entreprises publiques de gérer de tels monopoles, notamment dans les industries de réseaux, entreprises auxquelles il a confié également l'activité économique du secteur tout entier. Par le phénomène de libéralisation, la plupart des États ont choisi de conserver à cet opérateur, désormais opérateur historique en concurrence sur les activités en concurrence proposés aux consommateurs, la gestion de l'infrastructure. A ce titre, le Régulateur le contraint à deux titres : d'une façon transitoire pour que s'instaure la concurrence au bénéfice des nouveaux entrants, d'une façon définitive en tant qu'il a été choisi par l’État pour gérer le monopole économiquement naturel que constitue l'infrastructure.
Même dans les seuls rapports entre compétiteurs, la Régulation a du mal à reculer, et ce souvent du fait du Régulateur. Les lois sociologiques dégagées par Max Weber concernant l’administration montrent que les autorités de régulation, même au regard de la finalité de l'épanouissement concurrentiel, par exemple en matière de télécommunications, cherchent à demeurer, alors même que la concurrence a été effectivement construite, soit en se trouvant de nouvelles finalités (dans le secteur précité, le régulateur pourrait être le gardien de la neutralité du net), soit en affirmant pratiquer d'une façon permanente une "régulation symétrique".
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2021
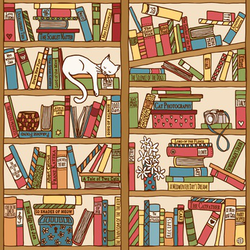
Cette bibliographie indicative vise des :
- ouvrages généraux
- ouvrages abordant la Régulation et la Compliance bancaire et financière à l'occasion d'un autre sujet principalement traité
- sites pertinents pour l'étude du Droit de la Régulation bancaire et financière
- ouvrages et articles portant spécifiquement sur la Régulation et la Compliance bancaire et financière
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), Droit et économie, tome 37, ed. Sirey, 1992, 426 p.
Lire les résumés des articles en langue anglais.
Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Beauvais, P., Méthode transactionnelle et justice pénale, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, Panthéon-Assas, 2016, pp. 79-90.
Voir la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Base Documentaire : Doctrine
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. Esty et M. Hautereau-Boutonnet, "Derrière les procès climatiques français et américains : des systèmes politique, juridique et judiciaire en opposition", D.2022, p.1606 et s.
____
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "compliance" est l'exemple-type d'un problème de traduction.
En effet, le terme anglais "Compliance" est le plus souvent traduit par le terme français de "Conformité". Mais à lire les textes, notamment en Droit financier, la "conformité" vise plutôt les obligations professionnelles, visant principalement la déontologie et la conduite des professionnels de marché, notamment des prestataires de service d'investissement. C'est à la fois une définition plus nette dans ses contours (et en cela plus sûre) et moins ambitieuse que celle exprimée par la "compliance". Il est dès lors et pour l'instant plus prudent de conserver, même en langue française, l'expression de "Compliance".
La définition de la Compliance est à la fois contestée et très variable, puisque selon les auteurs, elle va des seules obligations professionnelles des intervenants des marchés financiers jusqu'à l'obligation à ceux qui y sont soumis de respecter les lois et règlements, c'est-à-dire l'obligation générale que nous avons tous de respecter le Droit. A les lire, la Compliance serait le Droit lui-même.
Vue du point de vue du Droit, la Compliance est un ensemble de principes, de règles, d'institutions et de décisions générales ou individuelles, corpus dont l'effectivité est le souci premier, dans l'espace et dans le temps afin des buts d'intérêt général visés par ces techniques rassemblées soient concrétisés.
La liste de ces buts, qu'ils soient négatifs ("lutter contre" : la corruption, le terrorisme, le détournement de fonds publics, le trafic de drogues, le trafic d'êtres humain, le trafic d'organe, le trafic de biens toxiques et contagieux - médicaments, produits financiers, etc.) ou positifs ("lutter pour" : l'accès de tous aux biens essentiels, la préservation de l'environnement, les droits fondamentaux des êtres humains, l'éducation, la paix, la transmission de la planète aux générations futures) montre qu'il s'agit de buts politiques.
Ces buts correspondent à la définition politique du Droit de la Régulation.
Ces buts politiques exigent des moyens qui excèdent les forces des États, par ailleurs enfermés dans leurs frontières.
Ces buts monumentaux ont donc été internalisés par les Autorités publiques dans des opérateurs globaux. Le Droit de la Compliance correspond à une structuration nouvelles de ces opérateurs globaux. Cela explique notamment que les lois nouvelles mettent en place des répressions non seulement objectives mais structurelles, comme le font en France les lois Sapin 2 (2016) ou établissant une obligation de vigilance (2017).
Cette internationalisation du Droit de la Régulation dans les entreprises implique que les Autorités publiques supervisent désormais celles-ci, même si celles-ci n'appartiennent pas à un secteur supervisé, ni même à un secteur régulé, mais par exemple participent au commerce international.
Le Droit de la Compliance exprime donc une volonté politique globale relayé par un Droit nouveau violent, le plus souvent répressif, sur les entreprises.
Mais il peut aussi exprimer de la part des opérateurs, notamment les "opérateurs cruciaux" une volonté propre d'avoir eux-mêmes souci de ces buts globaux monumentaux, qu'ils soient de nature négative ou positive. Cette dimension éthique, exprimée notamment par la Responsabilité Sociétale, est la continuation de l'esprit du service public et le souci de l'intérêt général, élevés mondialement.
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Le plan est actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.
Il est disponible ci-dessous.
Retourner à la présentation générale du cours.
(Avant le début des enseignements de Droit de la Régulation bancaire et financière, un aperçu du plan général du Cours avait été mis à disposition.)
Base Documentaire : Doctrine
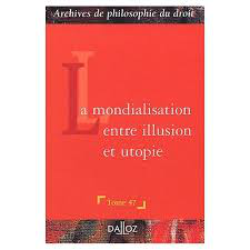
Référence complète : Salah, M., La mondialisation vue de l'Islam, in Archives de Philosophie du Droit, La mondialisation entre illusion et utopie, tome 47, Dalloz, 2003, 27-54.
La mondialisation apparaît comme une occidentalisation des cultures et du droit. L'Islam qui prend forme juridique devrait se l'approprier sans se dénaturer. La réussite d'un tel processus difficile dépendra de la qualité de la régulation qui sera mise en place.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Les étudiants de Sciences po peuvent via le drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le secteur des télécommunications fut le premier secteur à être libéralisé en Europe, non pas tant par volonté politique, mais parce que le progrès technologique avait de fait fait déjà entré la concurrence dans le secteur et qu’il convenait mieux de l’organiser plutôt que de laisser la concurrence s’installer en désordre.
Le secteur de la téléphonie fut libéralisé par directive communautaire, la loi de transposition de 1996 ayant installé l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART, aujourd’hui l’ARCEP, qui a eu pour tâche de favoriser les nouveaux entrants et de construire le marché des mobiles, en attribuant des fréquences. L’enjeu aujourd’hui n’est plus la libéralisation mais l’accompagnement de l’innovation technologique et de l’incitation des opérateurs à y procéder, par exemple dans les lignes ADSL, afin que des phénomènes comme l’échec du « plan câble » ne se renouvellent pas, que le "plan fibre" se déroule mieux, etc..
La maturité concurrentielle fait que l’Autorité de concurrence intervient fréquemment en matière de télécommunications, notamment lorsque des autorisations de concentrations doivent être données par cette Autorité, le Régulateur ne formulant qu'un avis.
Par ailleurs, l'enjeu majeur actuel qui a remis à l'ordre du jour les discussions autour de la dialectique entre contenant et contenu est de déterminer la place que les télécommunications ont et auront dans le numérique et qui pourrait être une régulation spécifique d'Internet, et par là même le Régulateur des télécommunications.
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Gibert, M., Faire la morale aux robots. Une introduction à l'éthique des algorithmes, Flammarion, 2021, 168 p.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
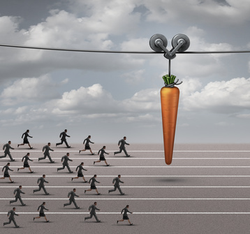
La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.
Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.
Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.
De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.
Base Documentaire : Doctrine
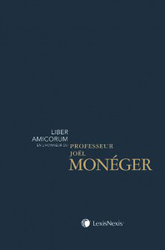
Référence complète Fox, E., The new world order, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Deffains, "De la dette à l’obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de cette contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La contribution s’appuie sur la définition de la Compliance en ce qu’elle requiert des grandes entreprises de contribuer à la réalisation des Buts Monumentaux, notamment la préservation des droits humains et des systèmes, par exemple système climatique.
Cette exigence est confrontée à la notion de dette telle qu’elle résulte aujourd’hui des travaux ancien ou nouveaux disponibles dans la science économique. En effet, dans l’économie primitive la dette ne renvoie pas seulement aux échanges mais à un dû de nature éthique et sociale ramenant vers le collectif. L’analyse économique du Droit a mis en valeur cette situation où une partie des entités impliquées dans une situation bénéficie des externalités positives ou endurent seule des externalités négatives, ce qui crée une situation de dette : cela engendre une obligation de corriger la défaillance de marché par une obligation de gestion des risques, telle qu’on la voit exprimée par l’Obligation de Compliance. Cela suppose que l’on peut utiliser le calcul économique pour quantifier cette dette : cela aboutit aux nouvelles propositions faites en matière de comptabilisation de la biodiversité.
L’auteur souligne ensuite la reconnaissance de la dette comme source d’une obligation de compliance. Cela peut être exprimé par la notion classique d’obligation naturelle dont on peut remonter la trace dans le Code civil ou à travers les conceptions plus solidaristes ou politiques du Droit, liées à la responsabilité morales, l’équilibre moral global renvoyant au devoir civique, se superposant à l’équilibre comptable . La dimension politique est alors très présente, comme le montrent par ailleurs Grotius et Kant, puis Bourgeois (solidarisme), Rawls et Sen (justice sociale) qui lient l’engagement profond de chacun avec le groupe . Cela éclaire le rôle essentiel joué par l’Etat et les institutions publics dans la formalisation et l’application de l’obligation de compliance, non seulement pour l’effectivité de celle-ci mais encore pour la prise de conscience par chacun de la part d’équité de celle-ci.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le légicentrisme exprime avant tout une bataille de normes, puisque cette doctrine pose que la loi est la seule et unique expression de la souveraineté de la Nation. En cela, la loi dispose d'une autorité indépassable et c'est elle qui fonde l'État légal.
Ainsi, si l'on devait donner une figure au système juridique, ce serait un cercle avec en son cœur d'une façon unique la loi souveraine, à la fois autosuffisante dans son fondement (souveraineté) et dans sa production (principe de légalité).
Cette conception moniste (unité de la loi) a pour principale source la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, c'est encore sur celui-ci que la France conserve le principe de souveraineté parlementaire (le Gouvernement est responsable devant le Parlement) et de souveraineté de la loi. Mais depuis la Révolution française, les esprits et les faits ont changé.
Ainsi, s'est construite une doctrine inverse : le "pluralisme juridique" qui pose en contradiction que le droit vient de nombreuses sources, comme la coutume, les pratiques, les jugements, etc. Il n'est pas étonnant que les auteurs qui affirment le pluralisme juridique ne viennent pas de la philosophie politique mais davantage de la sociologie comme Gurvitch ou Carbonnier.
En outre, les frontières nationales ont perdu de leur consistance, de fait et de droit. C'est pourquoi un auteur comme Mireille Delmas-Marty s'appuie sur le fait même de la construction de l'Europe des droits de l'homme d'une part et de la globalisation d'autre part pour affirmer que le légicentrisme a fait place à un pluralisme juridique généralisé.
Cependant, en droit positif les textes restent les mêmes. C'est ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, dispose de la loi que "la loi est l'expression de la volonté générale".
De la même façon, l'article 5 du Code civil continue d'interdire au juge de rendre des jugements contraignants pour d'autres cas que celui particulier sur lequel il se prononce.
Cette permanence des textes les plus gradés, à savoir l'article 5 du Code civil et l'article 6 de la déclaration pose de nombreux problèmes aux juges. En effet, depuis l'arrêt du Tribunal des conflits Blanco, le droit administratif n'est plus lié par ce qui est posé par le Code civil et sans doute la puissance normative du Conseil d'Etat s'exprime plus ouvertement que celle de la Cour de cassation, qui feint de ne rendre que des arrêts de principe pour pouvoir affirmer qu'elle ne rend pas d'arrêt de règlement.
D'une façon plus complexe, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que certes il est le gardien de la norme constitutionnelle supérieure à la loi mais quand le même temps, seul le législateur, puisque celui est le souverain, peut exprimer la volonté générale, ce à quoi le Conseil constitutionnel ne peut se substituer.
Mais le Droit de l'Union européenne, qui constitue un Ordre juridique à la fois autonome et dont les normes sont pourtant intégrées dans les ordres juridiques des Etats-membres, rend difficilement soutenable la conception du légicentrisme. Y a succédée une hiérarchie des normes complexes. Mais les fondements politiques de l'idée de légicentrisme alimente en grande partie l'hostilité à l'égard de l'Europe, aussi bien celle de l'Union que celle de la CEDH.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Netter, "Les technologies de conformité pour satisfaire les exigences du droit de la compliance. Exemple du numérique", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de cette contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’auteur distingue la Compliance qui renvoie aux buts monumentaux et la conformité, qui sont les moyens concrets que l’entreprise utilise pour tendre vers eux, par des procédés, des checks-liksts dans le suivi desquels l’opérateur rend des comptes (art. 5.2. RGPD). La technologie permet à l’opérateur de satisfaire à cette exigence, le caractère changeant des technologies s’ajustant bien au caractère très général des buts visés, qui laissent un large place aux entreprises et aux autorités publiques qui produisent du droit souple.
L’étude s’attache tout d’abord aux technologies existantes. A ce titre, le Droit peut par la Compliance interdire une technologie ou en restreindre l’usage, parce qu’elle contrarie les buts visés, par exemple la technologie de la décision entièrement automatisée produisant des effets juridiques sur des personnes. Parce que l’exercice est périlleux de dicter par la loi ce qui est bon et ce qui est mauvais en la matière, la méthode est plutôt celle de l’explicabilité, c’est-à-dire de la maîtrise par la connaissance par les autres.
Les Régulateurs développent pourtant de nombreuses exigences issues des Buts Monumentaux de la Compliance. Les opérateurs doivent mettre à jour leur technologie ou abandonnent la technologie obsolescente au regard des nouveaux risques ou pour permettre une concurrence effective ne n’enfermant pas les utilisateurs dans un système clos. Mais la puissance technologique ne doit pas se retourner et devienne trop intrusive, la vie privée et la liberté des personnes concernées devant être respectées, ce qui conduit aux principes de nécessité et de proportionnalité.
L’auteur souligne que les opérateurs doivent se conformer à la réglementation en recourant à certaines technologies, si elles sont disponibles, voire de contrecarrer celles-ci si elles sont contraires aux buts de la réglementation mais uniquement toujours si elles sont disponibles, la notion de « technologie disponible » devenant donc le critère de l’obligation ce qui en fait varier le contenu au fil des circonstances et du temps, notamment en matière de cybersécurité.
Dans une seconde partie, l’auteur examine les technologies qui ne sont que potentielles, celles que le Droit, notamment le Juge, pourrait requérir de l’entreprise qu’elle les invente pour remplir son obligation de compliance. Cela se comprend bien lorsqu’il s’agit de technologies en germe, dont la réalisation va se réaliser, par exemple en matière de transfert de données personnelles pour satisfaire le droit à la portabilité (RGPD) car il faut inciter les entreprises à développer des technologies qui leur sont d’un profit moins immédiate ou en matière de paiement sécurisé pour assurer une authentification forte (DSP 2).
Cela est plus difficile pour des technologies dont la faisabilité n’est pas même certaine, comme la vérification de l’âge en ligne ou l’interopérabilité des messageries sécurisés, deux exigences qui paraissent technologiquement contradictoires dans leurs termes , ce qui relève donc encore de la « technologie imaginaire ». Mais par la Compliance la pression exercée sur les entreprises, notamment les entreprises technologiques du numérique est telle que les investissements sont considérables pour y arriver.
L'auteur conclut que c'est pourtant l'ambition même de la Compliance et que l'avenir verra quel en sera le succès.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégrale pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeur Marie-Anne Frison-Roche
________
Enseignements : Droit de la Compliance

Sont ici répertoriés les sujets proposés chaque année,
- soit au titre du travail à faire en parallèle du cours, à remettre à la fin du semestre (le jour de l'examen étant la date limite de remise),
- soit les sujets à traiter sur table, sans documentation extérieure et sous surveillance le jour de l'examen final.
Retourner sur la description générale du Cours de Droit de la Compliance, comprenant notamment des fiches méthodologiques.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
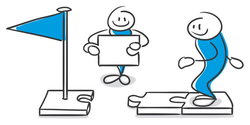
En Europe, le droit communautaire interdit aux États d'apporter aux entreprises des aides, celles-ci étant analysés comme des moyens au bénéfice du pays dont l’État se soucie (et parfois a tort de n'avoir que souci), ayant pour effet et peut-être pour objet de maintenir ou de construire des frontières entres les peuples, contrariant en cela le projet politique européen premier d'un espace commun de paix et d'échanges entre les peuples de l'Europe. C'est pourquoi cette prohibition n'existe pas aux États-Unis, puisque le Droit Antitrust n'a pas pour but de construire un tel espace, lequel est déjà disponible pour les entreprises et pour la population.
Cette différence essentielle entre les deux zones modifie les politiques industrielles car le gouvernement fédéral américain peut aider des secteurs là où les États-membres ne le peuvent pas. La prohibition européenne des aides d’État ne peut pourtant être remise en cause car elle est associée au projet politique de l'Europe. Cela semble une aporie puisque l'Europe en est handicapée face aux États-Unis.
L'aide est prohibée en ce que, quelques formes qu'elle prenne, elle fausse l'égalité des chances entre les opérateurs en concurrence sur les marchés, et constitue un obstacle fondamental à la construction d’un marché intérieur européen unifié. A partir de ce principe simple, s'est développée une branche du droit technique et spécifique car les États continuent d'apporter leur soutien et de très multiples règles et cas viennent découper en autant d'exceptions et de nuances cette règle, tandis que s'est construit au fil des ans un système probatoire y afférant. Ainsi la notion d'entreprise publique a pu demeurer malgré ce principe d'interdiction.
Mais s'il y a une crise d'une telle nature ou ampleur que le marché ne parvient pas par ses seuls forces à surmonter ou/et que l'Union européenne poursuit elle-même des objectifs a-concurrentiels, il faut qu’une régulation exogène intervienne, laquelle peut alors prendre la forme d’une aide d’État légitime. Il advient ainsi une sorte de synonymie entre aide d’État et Régulation.
C’est pourquoi les institutions européennes ont posé que des aides d’État deviennent licites lorsqu’elles interviennent soit dans des secteurs stratégiques, comme dans la production énergétique dans lequel l’État doit conserver son pouvoir sur les actifs, par exemple lorsqu'il s'agit du secteur de la défense. Loin de s'amenuiser cette hypothèse s'accroît. Le Droit de l'Union européenne admet également que l’État intervienne en prêtant aux opérateurs financiers menacés de défaillance ou déjà défaillants, l’État ayant pour fonction de lutter contre le risque systémique, directement ou à travers sa Banque centrale. L'aide peut venir de la Banque centrale européenne elle-même aidant les États dans leur émission de dettes souveraines, la Cour de justice ayant admis en 2015 la conformité aux traités des programmes de politique monétaire non-conventionnels. En 2010, le commissaire européen à la concurrence a ainsi souligné que les aides publiques sont des outils indispensables aux États pour faire face aux crises, avant que des règlements ne viennent en 2014 prendre le relais pour jeter les bases de l'Union bancaire européenne.
Base Documentaire : Doctrine