Matières à Réflexions
10 mars 2016
Blog

C'est au Royaume-Uni, pays de la "GPA éthique" et aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, État où la "GPA commerciale" permet l'ajustement naturel des volontés de chacun, que les procès se multiplient dans les mécanismes de GPA.
On y observe l'usage dans les stratégies des uns et des autres, la menace de procès est utilisée pour arriver à ses fins. Avec succès. L'enfant ? Les adultes n'en pensent pas. Qu'en peuvent les juges ? Rien.
Le cas qui, en Californie, met en cause Susan Ring est particulièrement intéressant. Les faits remontent à 2001. Les enfants en cause sont aujourd'hui grands.
Le cas est intéressant tout d'abord parce qu'il montre que, l'enfant n'étant fabriqué que parce qu'il est "désiré", l'enfant étant l'objet d'un "projet", n'étant corrélativement pas le "projet d'enfant" de la part de la mère qui l'engendre, s'il s'avère qu'il n'a plus le bénéfice d'un tel "projet" lorsqu'il nait, par exemple parce que ses "parents d'intention" ne s'aiment plus, plus personne n'est là pour le recevoir ...
Il y aura procès. Question juridique, certes. Mais que l'on songe aussi à cet enfant "fabriqué sur mesure" et que personne ne veut ...
Le cas est intéressant ensuite parce que, les États-Unis étant le pays des médias, les protagonistes se sont exprimés dans les médias, chacun parlant dans le Huffington Post Video, en 2013, pour expliquer la légitimité de sa position.
Chacun s'efforce de garder un immense sourire, car tout va toujours bien dans la GPA heureuse californienne, même si l'opinion publique commence à s'inquiéter, comme le montre les commentaires postés sous la video. La mère-porteuse en est à son huitième enfant, explique le contentement qu'elle retire de cette activité, mais une difficulté apparaît lorsque les "parents d'intention" demandent une réduction embryonnaire à laquelle elle ne veut pas procédé en raison de ses convictions personnelles"
Mais les choses ne s'arrangeront pas.
En mars 2016, les deux enfants sont nés. Les "parents d'intention", parce qu'ils ont divorcé et puisque les enfants qui devaient être le prolongement de leur amour n'ont donc plus leur "fonction d'utilité" n'ont plus de raison d'être, que vont-ils devenir ?
L'agence dit simplement à la mère-porteuse qu'ils seront placés dans un service social.
C'est là qu'entrent en jeu les transactions financières comme la mère-porteuse l'explique en détail au journal en mars 2016 :
Sur le litige auquel peut donner lieu cette exigence formulée par les "parents d'intention", qui peuvent certes se prévaloir de ce droit que leur confère une stipulation contractuelle, voire d'une disposition légale, mais qui se heurte à la puissance de fait de la mère sur son corps pendant la grossesse, laquelle peut songer à en appeler à la Constitution, v.GPA : les procès se multiplient : la mère-porteuse après avoir refusé de procéder à une IVG est débouté après la naissance de sa demande de tout droit sur les enfants venus au mondes.
9 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Schmid, J., Après la dénazification, la "renazification ? La réintégration des magistrats en Allemagne d'après la guerre (1945-1968), Droit et société, vol. 92, n°1, 2016, p.159-1979.
____
► Résumé de l'article (par l'auteur) : L’article propose une synthèse critique de travaux publiés sur l’épuration et la réintégration des magistrats allemands ayant exercé leurs fonctions sous le régime nazi. Il traite de la période entre le début de la dénazification en 1945 jusqu’en 1968, date à laquelle la plupart des magistrats actifs sous le nazisme prennent leur retraite. À travers les différentes étapes d’une dénazification administrative et juridique, l’article cherche à saisir la nature d’une « renazification » dénoncée par les institutions judiciaires ouest-allemandes. Contrairement à l’Allemagne de l’Est où la magistrature est purgée minutieusement sans réintégration de ceux qui en ont été écartés, l’Allemagne occidentale connaît un retour massif des magistrats compromis. Si ces derniers ne s’opposent pas au développement d’un système judiciaire démocratique, on constate un manque de prise de conscience de leur responsabilité sous le régime nazi.
5 mars 2016
Blog

Certains affirment que si le Droit français acceptait d'abandonner le principe d'interdiction de la GPA, principe posé par l'article 16-7 du Code civil, les procès s'arrêteraient. Quand on suit l'activité, on observe au contraire que les procès se multiplient, et qu'ils sont particulièrement sordides.
Les premières années, on a surtout pu voir des procès dans lesquels des personnes ayant contracté des conventions de mères-porteuses dans des pays dans lesquelles celles-ci sont licites ou tolérés ont attaqué l’État dans lequel elles vivent pour que celui-ci soit condamné à transcrire la filiation entre elles et l'enfant ainsi obtenu sur l'état civil national. Les pro-GPA ont expliqué que si les États cédaient et "passaient le pas" pour admettre le principe de ce type de convention par lesquelles les adultes se mettent d'accord pour qu'une femme en échange d'une contrepartie financière ou avec une compensation financière engendre un enfant à la seul fin de le remettre à la naissance aux personnes qui ont souhaité sa venue au monde, tout rentrerait dans l'ordre.
Mais le temps des procès arrive entre les protagonistes eux-mêmes. Aujourd'hui une dispute entre les commanditaires de l'enfant.
La presse s'en fait l'écho d'un procès qui se déroule en Pennsylvanie le 21 avril 2015 puis devant la Cour supérieure de Pennsyvanie le 2 mars 2016. Le cas est assez banal. Il a vocation à se reproduire. Un couple commande un bébé. Mais quand celui-ci est livré par la mère, le couple a divorcé et l'épouse exclut toute prise en charge puisqu'il n'est rien pour elle en l'absence de lien génétique ni biologique. veut pas prendre "livraison" de l'enfant.
Que faire de l'enfant qui fût si désiré et qui est aujourd'hui si encombrant ? Et surtout qui paie car en matière de GPA, on en revient toujours à cette question, aujourd'hui posée au juge.
C'est au juge de trancher ...
4 mars 2016
Blog

La pratique de la maternité de substitution (GPA) donne lieu à des contentieux, qui vont se multiplier.
Les premiers ont concerné la reconnaissance de la pratique par les systèmes juridiques, opposant donc les personnes qui y ont recours et les États qui prohibent cette pratique, les premiers assignant les États pour que ceux-ci confèrent une efficacité juridique à cette pratique à travers un lien de filiation entre l'enfant et ceux qui ont demandé sa venue au monde, même si l'Etat prohibe la convention de gestation pour autrui en tant qu'elle constitue une atteinte à la dignité de la personne de la femme et de l'enfant.
Tandis que ce contentieux continue entre les Etats et ceux qui veulent la légalisation de cette pratique au nom du droit à la vie privée, on observe une série de procès entre les parties à l'arrangement.
Il peut s'agir du couple qui se dispute après la venue au monde de l'enfant car ils ont divorcé pendant le temps que la grossesse se déroule : par exemple l'ex-épouse ne veut plus entendre parler de cet enfant qui n'a aucun lien avec elle et surtout ne veut rien payer pour lui, leur seul lien étant la commande qu'elle en a faite à la mère-porteuse.
Il peut s'agir aussi de l'application de la clause-type d'un contrat de mère-porteuse, selon laquelle c'est le parent d'intention qui décide d'une éventuelle IVG. Quid si la mère-porteuse refuse ? Perd-elle tous des droits, notamment pécuniaires, comme le stipule le contrat ?
En Californie une mère-porteuse saisit le juge et invoque la Constitution pour échapper aux stipulations contractuelles :

27 février 2016
Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans les Cahiers de la justice (Dalloz), dans un numéro consacré à la GPA.
La maternité de substitution (GPA) est une pratique. On peut, voire on doit, avoir une opinion à son propos. Pour ma part, j'y suis radicalement et définitivement hostile. Mais ce n'est pas l'objet de cette contribution que de défendre cette position. Puisqu'il s'agit d'un article d'introduction dans une publication plus particulièrement destinée à des magistrats, la perspective ici prise est celle du Juge, et la question posée est celle de savoir, si face à cette pratique, il peut techniquement faire quelque chose et s'il doit faire quelque chose au regard de son "office". Le thème de la GPA constitue un cas particulièrement net d'une question plus générale, de savoir s'il est même possible pour le Droit de faire encore "quelque chose" face à des phénomènes qui, technologiquement, économiquement, sociologiquement, semblent aujourd'hui "dépasser" le Droit. Le Droit serait-il donc désormais l'inférieur du Fait ? Peut-être. Autant le savoir. En tout cas, il faut y réfléchir. La GPA en est une bonne "épreuve", au sens probatoire du terme.
Les juges sont pris à partie, mais on ne peut reprocher au juge français de rendre des décisions en matière de GPA, puisque des justiciables portent des causes à trancher, que c'est leur office de le faire et qu'ils doivent le faire en application des règles de droit applicables, y compris les règles européennes, telles interprétées par la CEDH (I).
Dans son office, le juge a pour fonction de reprendre les solutions techniques, cela et pas plus, mais il peut aussi exprimer à travers la technique de motivation exprimer ce qui est la fonction même du Droit, à savoir la protection de la dignité des personnes, ici le cœur même de la question, comme l'exprima le 14 septembre 2015 le Tribunal Fédéral Suisse (II).
19 février 2016
Blog

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux.
Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant - comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les "conditions générales" dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de "donner compétence territoriale" aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui.
Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute "non-écrites" ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses "amis" ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui.
Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là !
Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté ... En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du "gratuit", exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit "d'adhésion". Il en résulte la qualification de "contrat de consommation", ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige.
Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de "sidération du droit" et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.
17 février 2016
Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Rapport d'information, présidée par Yves Détraigne et Catherine Tasca, Commission des lois du Sénat, L'assistance médicale à la maternité et la gestation pour autrui, 11 février 2016, votée en Commission des Loi le 17 février 2016.
Lire la synthèse et les conclusions du Rapport.
16 février 2016
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Canivet, "Autorités de régulation. Encadrement constitutionnel : le point de vue du juge", in M. Bazex, G. Eckert, R. Lanneau, Ch. Le Berre, B. du, Marais et A. Sée (dir.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, p. 125-137.
____
► Résumé de l'article (fait par MAFR) : L'auteur relate la façon dont le Conseil constitutionnel français contrôle en premier lieu la façon dont est admissible la réunion dans un même organe, l'Autorité de Régulation, tant de pouvoirs multiples, puis la façon dont est également constitutionnellement admissible la manière dont ces pouvoirs sont exercés.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
3 février 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

29 décembre 2015
Publications
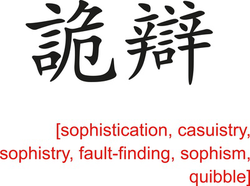
Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.
Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.
Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.
Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :
23 décembre 2015
Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les différentes natures de l'ordre public économique, in Archives de philosophie du droit, L'ordre public, t.58, Dalloz, 2015, p.105-128.
Cet article vient à la suite d'une conférence et s'appuie sur un working paper dans lequel ont été insérées les références et les liens hypertextes.
Renvoyant au rapport de force entre le Droit et l'Économie, l'ordre public économique a plusieurs natures. En premier lieu, l'on doit distinguer l'ordre public "gardiens des marchés", de l'ordre public "promoteur des marchés", de l'ordre public "architecte des marchés". En second lieu, l'on doit distinguer l'ordre public de "constitution des marchés" de l'ordre public posant des "octrois aux marchés". Celui-ci est premier, puisqu'il empêche que des objets de désir, objets naturels d'échange, deviennent objets de marché. Cet ordre public économique qui brise les élans de désir est hautement politique. Si l'on ne l'admet pas, alors le Droit n'est plus que l'agent d'effectivité du système économique, lequel engendre une société d'ajustement des désirs individuels.
4 décembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
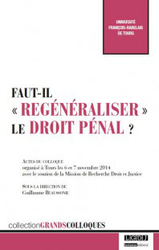
Référence complète : Catalan, N., Existe-t-il une personnalité juridique propre au droit pénal?, in Faut-il regénéraliser le droit pénal?, coll " Grands colloques", LGDJ-éditions Lextenso, 2015, p.7-31.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».
26 novembre 2015
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Boucherie du 13 novembre 2015 / Droit, 26 novembre 2015, Sciences po, campus franco-allemand, Nancy.
Consulter les slides ayant servi de support à la conférence.
Regarder et écouter la conférence.
Lire un article qui fait suite : Le faisable et l'inconcevable.
Le 13 novembre 2015 des faits se sont déroulés qui ont pris le Droit à partie. Le Droit est un système construit dans des procédures lentes et fixées par avance. Il ne bouge que de cette façon, sauf à se dénaturer. Il est mécanique. Mais il n'est pas qu'une machine, machine à faire de l'ordre ou de l'argent ou de la performance. Le Droit est aussi un art pratique dont la fonction est de protéger les êtres humains. Les êtres humains puissants et forts ont la puissances et la force et les autres ont le Droit. Les puissants et les forts ont aussi le Droit mais les autres n'ont que le Droit. C'est en cela que tous sont égaux, égaux en Droit. Pour parvenir à cet exploit, le Droit a inventé, par artefact, la "Personne" : tout être humain est une Personne. C'est ainsi, le Droit l'a dit. Le Droit est Verbe.
Ce qui est arrivé de terrible le 13 novembre, c'est que des êtres humains en ont exterminé d'autres, le plus possible, sans aucun souci d'eux, sans les considérer en rien comme des êtres humains, comme de la vermine. C'était une "boucherie. Les victimes ont été déniées dans leur humanité. Le Droit se saisit des assassinats, même de masse, même terribles, même génocidaires, mais lorsque les assassins n'ont pas même le sentiment de tuer des êtres humains, et se considérent eux-mêmes comme au-dessus des êtres humains, le Droit, qui est invention humaine faite de mots, est saisi dans son existence même.
Ainsi sommé, comment répondre ?
29 octobre 2015
Blog

Le "lancer de nain", c'est une "séquence figée" que les étudiants apprennent par cœur, l'exemple-type du sujet d'examen, l'occasion d'en fêter l'anniversaire...
C'est une antienne dans les enseignements de droit. C'est un morceau de choix au cinéma.
Les étudiants, par docilité, adhésion aux grands principes qui défendent la personne, ont tendance dans leur copie, à conclure dans le II.B.2 : "comme c'est beau, comme c'est grand", estimant ainsi atteindre au moins 13/20.
Mais le journal Libération a eu l'idée de demander son avis à l'intéressé. Celui-ci n'est pas content. Pas content du tout. Son réquisitoire est terrible.
«Les putes gagnent bien leur vie avec leur cul. Pourquoi je ne pourrais pas être lancé en France ? Elle est où la liberté d’expression ?» «Le Conseil d’État décide du bonheur des gens contre leur gré». Il estime qu'on lui a ôté sa liberté de travailler et regarde les pays où les nains disposent de la liberté d'être lancés. Lui, il reste en France, où il touche le RSA. Il pense que le Conseil d'État a brisé sa vie.
Il continue et il a raison de l'affirmer : Le Conseil d’État, parce qu'il veut faire le bonheur des gens malgré eux, a fait son malheur.
Il envisage d'en demander compensation financière à l’État.
Rétrospectivement, est-ce donc une mauvaise décision ? Puisqu'on songe à une compensation financière, y aura-t-il eu une faute à décider ainsi ?
Cela dépend de l'office de la jurisprudence.
Reprenons la situation. Si on l'analyse comme un "cas", réduit aux seules personnes particulières, sans doute a-t-il raison. Mais les juges ne portent pas que cela, ne sont pas que des personnes qui arrangent au mieux les difficultés particulières des cas concrets. Dans certains cas, il y a des principes qui sont impliqués, sans doute contre le gré des personnes particulières en cause, et là c'est la jurisprudence qui apparaît. Sinon, cela n'est pas la peine de constituer des tribunaux, de prévoir des procédures, et de mettre l'ensemble au cœur des systèmes démocratiques.
Reprenons la situation :

Mise à jour : 25 octobre 2015 (Rédaction initiale : 30 août 2015 )
Publications

Ce Working Paper sert de base à une contribution parue en décembre 2015 aux Archives de Philosophie du Droit.
La notion d'ordre public économique renvoie au rapport de force entre le Droit et l’Économie. L'ordre public économique a lui-même plusieurs natures suivant les rapports que le droit peut entretenir avec l'économie. Il est important de les distinguer nettement et de ne pas les confondre. En premier lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public gardien des marchés", de "l'ordre public promoteur des marchés", de "l'ordre public architecte des marchés". En passant de l'un à l'autre, la dimension politique, voire souveraine, de l'ordre public économique apparaît du fait du changement de nature. En second lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public de constitution des marchés de "l'ordre public d'octroi des marchés". En effet, c'est par des règles d'ordre public que le Droit à l'intérieur des marchés les garde, les bâtit ou les conçoive. Mais ce n'est qu'un versant de l'ordre public économique. Par un ordre public économique premier, des règles construisent des "octrois des marchés", pour empêcher que les objets de désir, objets naturels d'échanges, deviennent de ce fait objets de marché. Il s'agit d'un ordre public économique hautement politique, qui s'exprime par un rejet des élans de désir.
Cela serait une grave faute de ne pas percevoir les trois natures de l'ordre public économique (ordre public gardien de l'économie, ordre public promoteur de l'économie, ordre public d'octroi des marchés) les deux natures de l'ordre public économique.
Comme pour toute chose, la plus grande puissance de l'ordre public est dans sa version négative, ce par quoi des règles ferment l'accès du marché à des objets, des choses ou des prestations qui pourtant sont désirés, qui pourtant sont offertes. Ainsi, les personnes ne sont pas sur le marché, non pas parce qu'il n'y aurait pas de désir qu'elles y soient ni de consentement de leur part, mais parce que des règles d'ordre public économique le disent. Si on ne l'admet pas, alors parce que cette nature-là est la première forme de la prétention que constitue l'ordre public économique, alors celui-ci est dans sa nature-même récusé.
19 octobre 2015
Base Documentaire

Référence complète : Kossi, A.V., La protection des données à caractère personnel à l'ère de l'Internet. Impact sur l'évolution du cadre normatif et nouveaux enjeux. État des lieux en France et en Allemagne, coll; "Publications Universitaires Européennes", Peter Lang, 2011, 362 p.
L'auteur pose qu'Internet bouleverse la société et constitue un danger pour l'individu. La France et l'Allemagne ont été les premiers à réagir à travers les lois qui protègent l'individu contre la puissance informatique, puissance à laquelle Internet est lié. L'auteur observe que depuis le droit législatif a du peine à protéger l'individu et que c'est plutôt les tribunaux, notamment les Cours constitutionnelles, françaises et allemandes, qui protègent l'Internaute, dans son droit à la protection de ses données personnelles face à la puissance des entreprises de "l'ère de l'Internet".
10 octobre 2015
Blog

Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une "filiation" de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire.
La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur "céder" l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les "parents", est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains.
Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on "consent" à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la "mère" mais n'est que la "gestatrice" de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un "désir d'enfant" partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui - GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes.
Pour l'instant les Législateurs sont comme "assommés" par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que "chacun a droit à l'amour d'un enfant" et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter.
La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, "père biologique de l'enfant", qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine.
L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.
Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme "mère" la conjointe du "père biologique", laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français.
C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?
8 octobre 2015
Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comprendre la Cour de cassation (à propos des deux arrêts d'Assemblée plénière du 3 juillet 2015 sur la pratique des maternités de substitution (dite GPA)), numéro dédié des Petites Affiches, 8 octobre 2015, 24 pages.
Lire le dossier composé de 4 perspectives :
- Présentation générale de la méthode de commentaire ;
- Compréhension des arrêts du 3 juillet 2015 par leur lecture littérale ;
- Compréhension des arrêts du 3 juillet 2015 par leur lecture politique ;
- Compréhension des arrêts du 3 juillet 2015 par le souvenir du jeu de l'audience.
Le 3 juillet 2015, la Cour de cassation a admis par deux arrêts de son Assemblée plénière qu'à condition qu’il y ait un « lien biologique entre l’homme et l’enfant » s'opère la transcription sur l’état civil français de la filiation mentionnée sur l’état civil étranger, dans l’indifférence du fait que l’homme qui a déclaré l’enfant ait conclu à son propos une convention de maternité de substitution (dite GPA).
Quoi qu'on pense de la pratique des maternités de substitution, ces arrêts sont difficiles à comprendre. Alors que le sujet est très important, voire dramatique. Alors que la Cour de cassation donne des signes de vouloir devenir une "Cour suprême", ce qui suppose à tout le moins des décisions compréhensibles.
Comment essayer de comprendre ce que ces arrêts de quelques lignes veulent dire ? En s'attachant à leur lettre ; en lisant entre les lignes les jeux de pouvoir qui s'opèrent entre les sources du droit (le juge et le législateur) ; en se souvenant à l'audience sensationnelle du 19 juin 2015.
Après cela, on peut se demander si la pratique des maternités de substitution qui consiste pour des personnes qui ont un projet de parentalité à trouver une femme qui consent par avance à fabriquer un enfant pour le céder à l'instant de sa naissance pour qu'il soit l'enfant de ceux qui en ont le projet, est bien ou est mal.
Mais d'abord, il faut comprendre la Cour de cassation.
30 septembre 2015
Blog

Pendant une semaine, l'on ne parla que de cela. Une semaine après, le fait était oublié. Pourtant, Cecil fût pendant l'éclair d'une affection planétaire, d'un deuil porté par tous les internautes, celui dont on parla le plus.
Pourtant, quoi de plus banal. Un dentiste américain ordinaire s'amuse à chasser. A chacun ses plaisirs. Chasser n'est souvent plus nécessaire, mais l'activité continue à plaire. Walter Parker aime cette activité qu'il pratique régulièrement. Il rémunère un organisateur de chasse Théo Bronkhorst pour lui organiser une chasse au lion au Zimbabwe. Cela est facile à celui-ci car l'organisateur de chasse, chasseur professionnel, est de nationalité zimbabwéenne. Tout se passe au mieux et la chasse est aisée. Le lion est superbe, en pleine forme, très beau et il est abattu hors de la réserve naturelle de Hwange. Tout à côté mais pas à l'intérieur de celle-ci. Un coup d'arc tiré par le dentiste et la bête est à ses pieds : la photo est prise, c'est une chasse très réussie. Il pourra la raconter, montrer la preuve de son exploit, avant de partir vers d'autres exploits, puisque une telle chasse ne coûte qu'environ 55.000 $.
Mais le lion n'est pas un "animal" comme les autres. C'est la vedette du parc naturel. Qui ne le connaît ? Il a 13 ans. Il est le mâle dominant de la réserve. Sa photo a toujours un grand succès sur les réseaux sociaux, car lui seul a une crinière noire. Et qui ne connait son nom ? "Cecil". Dès son décès appris, les réseaux sociaux s'enflamment pour pleurer la "victime" : Cecil si beau, si magnifique, si aimé, si gentil, si utile, si inoffensif, trucidé par un stupide dentiste américain ! Les milliers d'internautes demandent la mort du Dentiste ! Le nom de celui-ci est immédiatement révélé. Son adresse est communiquée et des peluches de lions affluent, obstruant son cabinet dentaire qu'il doit fermer. Des pétitions circulent pour qu'il soit, si ce n'est mis à mort, œil pour œil, dent pour dent, à tout le moins extradé vers le Zimbabwe.
Avant que cette petite histoire ne retombe dans l'oubli, arrêtons sur "le cas Cecil".
En droit, l'on parle souvent des "cas". Pour désigner une situation ou une histoire particulière, sur laquelle l'on va s'appuyer pour en tirer une règle plus générale, qui va avoir une influence sur la solution imputée ultérieurement à une autre situation. Plus le système juridique est "casuistique", comme le sont les systèmes de Common Law, et plus les "cas" ont de l'importance. L'importance du "cas Cecil" est révélateur de plusieurs choses. Tout d'abord les protagonistes appartiennent à des cultures de Common Law (États-Unis ; Zimbabwe), ce qui se reflète dans son traitement. Mais il s'agit d'un "cas planétaire", dont le traitement dans un premier temps va dans se déployer dans l'espace numérique, dans ce que certains appellent désormais la "civilisation numérique". Dès lors, faudrait-il en conclure qu'Internet est avant tout alimenté par des "cas", des événements (et non pas par l'Histoire), propice en cela à un développement de la Common Law ?
En tout cas, le "cas Cecil" est en premier lieu révélateur de l'inadéquation du statut juridique actuel de l'animal par rapport à la psychologie sociale : soutenir que l'animal est une chose, ce qui est juridiquement exact et fondé, n'est plus compris. Lorsqu'il porte un prénom humain et qu'il est une vedette du Net, encore moins. La dimension planétaire de son décès, le sentiment de tristesse et d'injustice montre que le rapport entre les êtres et les animaux est en train de s'inverser. Mais cette inversion ne s'opère que s'il s'agit des animaux aimés par les êtres humains, comme si dans cet engouement l'être humain ne cherchait qu'à s'aimer lui-même (I). Il demeure que le Droit est en route : le "cas Cecil" va susciter des qualifications, des procédures et des raisonnements juridiques, voire des lois (II). Carbonnier dit : "à petites causes, grands effets".
25 septembre 2015
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
Ici, l'instance devant les juges du fond se développe en même temps que les décisions de justice se sont successivement développées.
Ainsi, en 2010, les époux M., français qui résident au Vietnam, ont déclaré au consulat général français d'Hô Chi Minh une enfant comme étant née d'une "mère porteuse", en demandant qu'elle soit déclarée comme étant leur fille, et font également état d'une mention sur l'état civil de Bombay d'un acte de naissance de la même enfant, les mentionnant comme "parents d'intention".
Le Tribunal de Grande Instance de Nantes annule l'acte de naissance litigieux par un jugement du 22 mai 2014 en posant qu'il est entaché de fraude en ce qu'il est l'aboutissement d'une convention de gestation pour autrui, ce qui constitue une fraude à la loi française et une violation de l'ordre public international.
Les époux forment appel en se prévalant et des arrêts de la CEDH du 26 juin 2014, imposant la transcription pour la filiation entre l'enfant et son père biologique, dans l'indifférence de la gestation pour autrui dont l'enfant est issu, et ajoutant que l'enfant a la possession d'état d'enfant à l'égard de sa "mère d'intention" ce qui justifie d'une façon autonome l'établissement d'un lien de filiation maternelle à l'égard de celle-ci.
La Cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 28 septembre 2015, rejette ces arguments et confirme l'annulation prononcée par le Tribunal de Grande instance de Nantes, tout en changeant la motivation de la décision.
Lire ci-dessous le détail de l'arrêt.
18 septembre 2015
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge est-il un pouvoir ou une autorité vis-à-vis du Politique ?, in Juge et Démocratie, Les Entretiens de Montesquieu, La Brède, 18 septembre 2015.
Dans une table-ronde modérée par Dominique Richard et qui réunissait également et notamment Maîtres Jean-Marie Burguburu et Patrice Spinosi, le thème du rapport de pouvoir entre la magistrature et le Politique, la discussion entre les intervenants et avec la salle a pris appui sur la distinction faite par la Constitution française entre "autorité" et "pouvoir".
Pour ma part, j'ai soutenu que les magistrats ont toujours été un pouvoir, mais que le Politique a rêvé qu'ils ne le soient pas et ont tant cru à leur capacité à les réduire qu'ils ont effacé le mot, choisissant celui d' "autorité" qu'ils ont pensé que la parole constituante suffira à engendrer ce résultat.
Mais, si l'on met de côté la question différente des magistrats qui composent le Parquet, les juges ne peuvent pas ne pas avoir de pouvoirs, puisqu'ils sont obligés de répondre aux questions que leur posent les justiciables, à travers les demandes qu'ils formulent. C'est l'article 4 du Code civil qui oblige le juge à y répondre, tout juge doit répondre par un jugement. Celui qui ne le ferait pas, sous prétexte d'une insuffisance de la Loi, commettrait un déni de justice. Ainsi, lorsque le juge des référé qu'est le Conseil d’État intervient pour soutenir l'interdiction du spectacle de Dieudonné, il aurait subi les mêmes reproches de "faire de la politique" s'il avait choisi d'annuler l'interdiction préfectorale du spectacle. Le juge doit trancher. Ainsi, étant obligé d'avoir du pouvoir, il ne peut que constituer un Pouvoir, qui s'applique au Politique, comme à toute chose.
Ce qui n'est pourtant jamais admissible, c'est un pouvoir qui affirme n'être pas un pouvoir. C'est alors un pouvoir sans limite.
Cela-même que Montesquieu dénonçait dans L'esprit des Lois : tout pouvoir a tendance à en abuser, c'est pourquoi il faut institutionnellement lui mettre en face des contre-pouvoirs. Lorsque les magistrats affirment qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont en France que des petits fonctionnaires, qu'ils ne font qu'appliquer la loi, c'est faux. Mais en disant cela, alors même qu'ils exercent un grand pouvoir, ils ne rendent pas de compte de celui-ci.
Alors que le Politique rend des comptes, le Judiciaire n'en rend pas. Parce qu'il n'admet pas être un pouvoir. Ce qu'il est pourtant.
Non seulement, il ne peut pas n'être pas un pouvoir, mais il est sans doute bon qu'il en soit un. Il ne convient pas de le critiquer d'être un Pouvoir. Mais il convient de le critiquer s'il feint de n'être pas un. Habilité que le Politique n'a pas.
Dès lors, la balance est inversée, puisque c'est le Politique qui devient de fait le contre-pouvoir du Pouvoir judiciaire.
9 septembre 2015
Enseignements : La personne entre le droit et l’économie

Le droit est un système posé les êtres humains, qui édictent des règles et les appliquent : il est "artificiel". Les êtres humains sont des êtres biologiques, qui naissent, e développent et meurent, dans un continuum avec les autres espèces qui peuplent la terre.
Si l'on prend la notion de "personne", la première question à se poser est de savoir si elle relève de l'ordre de la "nature", c'est-à-dire du fait, ou de l'ordre de la construction, la personne étant alors une "invention juridique". A ce titre, la "personnalité" ne serait pas vraiment différente qu'il s'agisse de la personnalité attachée aux êtres humains ou de la personnalité attachée aux organisations, comme l'État ou les sociétés commerciales. La dispute autour de la réalité ou de la fiction des personnes morales présume trop aisément la naturalité des personnes civiles ...
Mais si l'on va au fondamental, l'on observe la personne se définit dans l'ordre du droit en ce qu'elle est un "sujet de droit", c'est-à-dire un titulaire de droits et d'obligations. Cette titularité est-elle "imputée" par la puissance du droit, de sorte que ce qui a été offert par le droit peut être retiré par celui-ci ? Cela signifie que la personne est non seulement une invention, mais encore une invention proprement juridique, dont le siège est en Occident.
Si par ailleurs, l'on affirme que la personnalité est une invention, mais qu'il s'agit d'une invention politique, l'on pourrait soutenir qu'il s'agit d'une invention insécable de l'être humain. Si l'être humain n'est pas naturellement une personne, nul ne pourrait ôter à l'être humain cette seconde nature que lui confère la personnalité. En cela, la personnalité signerait que tout être humain est d'une façon égale un être de culture, que ce masque de culture, nul ne peut l'arracher à l'être humain.
Il ne s'agit pas d'une dispute vaine, même s'il s'agit d'une discussion théorique. En effet, si le masque de la personnalité devient détachable de la personne, alors celle-ci peut être "dégradée" en autre chose. C'est pourquoi les procureurs et juges du Procès de Nuremberg ont posé que l'enjeu de ce procès était de restaurer la notion juridique de personne que le nazisme avait foulée.
Intervenant extérieur : Olivier Meyer
9 septembre 2015
Blog
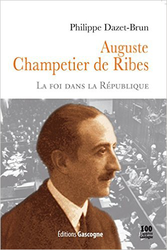
Dans son réquisitoire devant le Tribunal de Nuremberg, le procureur 'Auguste Champetier de Ribes, procureur près le Tribunal de Nuremberg s'exprime ainsi :
....La mystique à laquelle pensait Bergson, nous savons ce qu'elle est. C'est celle qu'à l'apogée de la civilisation gréco-latine, alors que Caton, l'Ancien, le sage des sages, écrivait dans son Traité d'économie politique : "il faut savoir vendre à temps ses vieux bœufs et ses vieux esclaves", a introduit dans le monde ces deux notions, qui ont suffit à le bouleverser, la notion de la personne et celle de la fraternité humaine.
La personne, c'est-à-dire l'individu spiritualisé, non plus l'homme isolé, le numéro dans l'ordre politique, le rouage dans l'ordre économique, mais l'homme tout entier corps et esprit, esprit incarné sans doute, mais avant esprit, pour l'épanouissement duquel est faite la société, l'homme social, qui ne trouve son plein développement que dans la communauté fraternelle de son prochain, l'homme, auquel sa vocation confère une dignité qui le fait échapper de droit à toute entreprise d'asservissement et d'accaparement.
Ces paroles sont essentielles, en ce qu'elles ont été prononcées à cet instant si particulier de l'Histoire qu'est le procès de Nuremberg. Elles sont prononcées par un procureur, c'est-à-dire celui qui a en charge de faire au nom du Droit reproche à ceux qui sont accusés. Il va leur reprocher non pas seulement les atrocités concrètes et le nombre inouïs de victimes. En cela, d'autres génocides pourront s'y comparer sans doute. Il va leur reprocher autre chose, différent et incommensurable. Il va reprocher à la pensée nazie, car il y a une pensée nazie
Par une démonstration fulgurante, Champetier de Ribes montre que la pensée gréco-romaine à inventer la notion de "personne. Il s'agit d'une notion "mystique", en ce qu'un être humain cesse d'être un être isolé et dépendant
Shapiro, La loi du sang, trad. franç., Gallimard, 2014.
Anders, G., Nous, fils d'Eichmann, trad. franç. ....
10 août 2015
Blog

Pour les comprendre, on peut recourir à la technique traditionnelle consistant à en rechercher le sens, la valeur et la portée.
Pour les apprécier, on peut les lire d'une façon politique, consistant à se demander si la Haute Juridiction n'a pas pris la place du Législateur, jeu de pouvoirs.
Mais si la voie pour lire sous les quelques lignes qui composent ces deux arrêts n'était pas plus simplement encore de se reporter à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2015 ?
D'une façon plus générale, même devant la Cour de cassation les audiences sont instructives.
Celle du 19 juin 2015
Il convient d'y prendre au passage une leçon de rhétorique. Rhétorique où l'habilité fût si grande dans ce qui était dit, autour de la proposition du Procureur général de vérifier la réalité biologique du lien entre l'homme et l'enfant qu'il déclenche comme son fils et sa fille. Rhétorique qui attend son apogée en ce que jamais ne fût discutée la solution européenne de donner effet aux convention de GPA, qui ne fût contestée ni par le Procureur général ni par l’État français qui choisit de se taire.
Sous couvert d'opposition, voire d'éclats, ce fût en réalité une unisson qui marqua une audience où aucune voix n'a soutenu le principe d'indisponibilité des corps, le fait que les femmes ne sont pas à vendre et les enfants ne peuvent être cédés. En sortant de l'audience, le sort des femmes et des enfants était scellé.
Pour une conférence faite au sortir de cette audience, Frison-Roche, M.-A., Le droit à l'épreuve des contrats de maternité de substitution (GPA), 19 juin 2015.
13 juillet 2015
Blog

Cet article s'insère dans une trilogie, qui vise à comprendre les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015.
Un premier article a procédé à une analyse exégétique des arrêts. Il faut sans doute procéder ainsi dans un premier temps, un peu scolairement, pour mesurer "le sens, la valeur et la portée" des deux arrêts-miroirs, qui n'ont pas touché expressément la prohibition française des conventions de mère-porteuse mais qui par leur silence ont levé le pont-levis pour laisser entrer les entreprises sur le marché fructueux du matériel humain et de l'engendrement.
Ce deuxième article prend une perspective particulière : celle du "pouvoir" que ces arrêts manifestent. Depuis longtemps, l'expression constitutionnelle d' "autorité judiciaire" est le masque d'un pouvoir, le "pouvoir judiciaire" n'étant pas critiquable en soi dès l'instant qu'il est en équilibre avec le pouvoir législatif.
Un troisième article prendra une perspective plus factuelle et de sociologie judiciaire et institutionnelle
Restons sur la deuxième perspective, choisie par ce présent article. Les arrêts expriment un étrange pouvoir : les juges s'attribuent le pouvoir de toucher l'une des questions les plus essentielles de notre système juridique, à savoir la filiation. En cela, il se substitue au pouvoir législatif.
Mais alors, tant qu'à faire la loi, la Cour devrait poser une règle générale. Elle préfère demeurer dans la casuistique. Mordiller dans le talon de la filiation. Rendre l'institution aussi faible qu'Achille sans pour autant établir un autre demi-dieu sur lequel notre Droit, toujours à la recherche de sacré peut se construire. Nous voilà dans les sables mouvants de la casuistique. C'est une seconde raison pour que le Législateur intervienne, afin que des principes servent de repères.
A la lecture de ces arrêts, il apparaît donc que les juges se sont appropriés d'une façon indue un pouvoir illégitime, déformant une institution politique établie hors de leur pouvoir et dont ils n'ont que la garde (I), pouvoir dont ils ont en outre fait un usage casuistique, ôté tout repère dans un Droit qui a besoin de repères, à travers des principes (II).