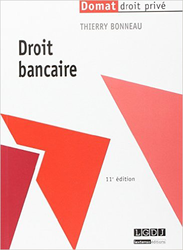Matières à Réflexions
16 décembre 2015
Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Verdier, M., Innovation, concurrence et réglementation pour la fourniture de services bancaires en ligne, in Revue d’Économie Financière, Innovation, technologie et finance. Menaces et opportunités, n°120, déc. 2015, p. 67-89.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation".
Il est remarquable que dans cet article le droit de la concurrence soit perçu et analysé que comme une "réglementation".
Dans cette perspective, il est posé que cette "réglementation" doit s'adapter car pour le développement de l'activité bancaire dans l'espace numérique les acteurs doivent coopérer, ce qui est contraire à la base de la "réglementation concurrentielle".
Pour que les opérateurs innovent, il faut donc mettre le cursus entre la concurrence et la coopération, à la fois dans les relations verticales et entre opérateurs installés et nouveaux entrants.
7 décembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Tourette, A., Responsabilité civile et neutralité de l'internet, thèse Université de Nice Sophia Antipolis, 2015.
Lire le sommaire.
Lire le résumé (bilingue).
4 décembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
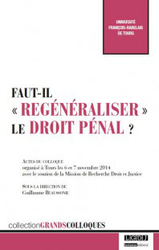
Référence complète : Catalan, N., Existe-t-il une personnalité juridique propre au droit pénal?, in Faut-il regénéraliser le droit pénal?, coll " Grands colloques", LGDJ-éditions Lextenso, 2015, p.7-31.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».
30 novembre 2015
Conférences
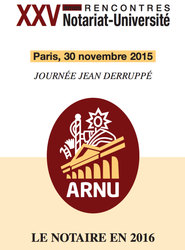
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., et Houdard, D., Le coût de l'acte, in Le notaire en 2016, Association Rencontres Notariat-Université (ARNU).
Lire le working paper ayant servi de base à la conférence et contenu les références techniques : La référence au "coût de l'acte" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié.
Lire l'article publié en février 2016 à la Semaine juridique.
Dans une journée dont le thème est "Le notaire", il peut paraître "déplacé" de traiter la question du "coût de l'acte". En effet, celui- ci dépend avant tout de l'État qui fixe les tarifications de la prestation et non pas tant de la personne qui établit l'acte, qui le conserve et conseille les parties. Mais la Loi pour la croissance, l'activité et l'économique des chances économiques (dite "Loi Macron") du 6 août 2015 a conçu le coût des actes comme on le fait dans la régulation des accès à des biens communs, en additionnant non pas tant les coûts et les marges raisonnables que peuvent attendre les gestionnaires de ces biens du soin qu'ils en prennent, mais les coûts que cela doit en engendrer pour eux. Et plus ce coût est bas, plus le système fonctionne bien, la tarification par les coûts finissant par rejoindre la tarification par le price cap. Il y a donc à la fois de la péréquation et une perspective disciplinaire dans une entéléchie dont le bien-être du consommateur est le but. Le projet de décret traduit cela et c'est donc à travers l'analyse du coût de l'acte, à travers les coûts estimés comme "pertinents" et ceux qui ne le sont pas, que le Ministère de l'Économie et des Finances entends réguler la façon dont le notaire organise son exercice professionnel.
Cette question technique de la tarification du coût par un texte ministériel commun au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Économie suscite un grand émoi, une grande incompréhension qui peut parfois dégénérer en agressivité entre la profession et le Ministère ressenti comme désormais dominant. Cela tient au fait que l'on passe d'un système à un autre, dans son esprit même.
Précédemment, le tarif étant le prolongement de l'acte de souveraineté par lequel le garde des Sceaux conférait le pouvoir d'instrumenter à l'officier public, le montant demandé par celui-ci à la personne recevant la prestation allant avoir la délégation de cette souveraineté. La question du montant, de son calcul, de son adéquation, de sa comparaison aux autres prestations, aux autres montants appelés "prix", était secondaire, accessoire, presque saugrenue.
Désormais, l’État prend la perspective à partir de celui qui demande la prestation, perspective de marché peut-être, mais aussi de service public et d'accès à un prestation essentielle. C'est pourquoi la simple loi de l'offre et de la demande sera bloquée par l’État et ce n'est pas un prix qui va ajuster la relation, cela demeure un "tarif". Comme l’État veut s'opposer à la concurrence, il choisit un système de régulation. Si l'Autorité de régulation regarde - ce n'est pas elle qui fixe -, c'est parce qu'il faut calculer hors mécanisme de marché autant que cela est nécessaire et pas plus qu'il n'est nécessaire. Plutôt que de mettre en concurrence les notaires entre eux par la concurrence, la référence aux coûts, méthode très française, permet de nombreuses latitudes.
C'est à la profession notarial d'apporter au Ministre les éléments d'information pour construire la tarification par les coûts. Les informations doivent être elles-mêmes "pertinentes", c'est-à-dire suffisamment "robustes" pour tenir face à une Commission européenne face à laquelle l’État français lui-même doit rendre des comptes en Ex post. La tarification constitue un Ex ante intégrant une logique d'Ex post.
Dans cette construction commune, les coûts ont vocation à intégrer non seulement les coûts d'établissement des actes mais encore les coûts de structure. Plus encore, à intégrer non seulement les coûts des actes d’aujourd’hui', mais encore les coûts des actes de demain, car la régulation est l'injection du temps dans le marché, jouxte avec la politique publique. Les notaires sont requis pour la construction d'un système futur performant, dont le coût est présent, notamment pour un système numérique que l’État veut l'établissement avec l'aide des notaires.
C'est pourquoi ce passage d'un système à un autre qu'exprime cette désignation par la Loi d'une tarification par les coûts est une chance pour le notaire d'être au centre d'un système économique dont la sécurité et le dynamisme tiennent dans une conception régulée.
26 novembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
25 novembre 2015
Base Documentaire : Textes
Référence complète: Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union
18 novembre 2015
Conférences

18 novembre 2015
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Barban, P., Les entreprises de marché. Contribution à l'étude d'un modèle d'infrastructure de marché, préface de France Drummond, Avant-propos de Jean-Jacques Daigre, LGDJ, nov. 2015.
13 novembre 2015
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Concevoir des normes adéquates, in Office parlementaire d’Évaluation des mesures scientifiques et technologiques, L'état de l'art en matière de mesure des émissions de particules et de polluants par les véhicules , Sénat, salle Médicis, 13 novembre 2015, 9h-13h.
2 novembre 2015
Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et Marché : évolution, in Dormont, S. et Perroud, Th. (dir.) Droit et Marché, coll. "Droit et Économie, LGDJ - lextenso éditions, 2015, p.265-278.
Cet article trouve une forme plus développée et plus personnelle dans un working paper et constitue le prolongement d'une participation à un colloque.
Droit et Marché à première ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché". Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre. Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouverne seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.
Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres. Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face, mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait. Il est en cela en passe de gagner.
29 octobre 2015
Base Documentaire : Soft Law

Voir le film réalisé par Public Sénat, reprenant les grandes lignes du Rapport, très critique à l'égard des AAI.
26 octobre 2015
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Montalivet, P. de, Le marketing du droit, in Dormont, S. et Perroud. Th. (dir.), Droit et Marché, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenson Éditions, 2015, p.127-143.
Voir une présentation de l'ouvrage collectif dans lequel l''article a été publié.
Voir une présentation générale de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
26 octobre 2015
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Il s'agit du 25ième volume de la collection "Droit et Économie".
Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
Référence complète : Dormont, S. et Perroud. Th. (dir.), Droit et Marché, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenson Éditions, 2015, 278 p.
Lire la quatrième de couverture.
Consulter la table des matières.
Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Droit et Marché : évolution
Lire l'introduction de Jacques Chevallier : Ordre juridique et logique de marché
Droit et marché entretiennent des relations complexes : leur rencontre, inévitable, ne se fait pas sans heurts. D'un côté, le marché a tendance à bousculer le droit, à le soumettre à sa toute puissance amorale, implacable. De l'autre, le droit peut venir au secours du marché, lui permettre de fonctionner, l'accompagner dans ses différents développements en mettant à sa disposition des outils appropriés.
Le droit - ou du moins son utilisation, voire son instrumentalisation - peut même aller jusqu'à faire sienne la logique de marché, en adoptant ses codes (marketing), sa logique (mise en concurrence) et sa finalité (sélection du meilleur).
La réflexion sur le thème « droit et marché » dépasse ainsi le strict cadre du « droit du marché », qui suppose déjà en lui-même une analyse critique de ses sources et des techniques qui lui sont propres. Mais il s'agit également de se demander si le droit n'est pas en passe de devenir lui-même un marché, dans certaines circonstances. C'est autour de ces deux axes, « le droit du marché » et « le droit est-il un marché ? » que s'est articulée la réflexion.

Mise à jour : 25 octobre 2015 (Rédaction initiale : 30 août 2015 )
Publications

Ce Working Paper sert de base à une contribution parue en décembre 2015 aux Archives de Philosophie du Droit.
La notion d'ordre public économique renvoie au rapport de force entre le Droit et l’Économie. L'ordre public économique a lui-même plusieurs natures suivant les rapports que le droit peut entretenir avec l'économie. Il est important de les distinguer nettement et de ne pas les confondre. En premier lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public gardien des marchés", de "l'ordre public promoteur des marchés", de "l'ordre public architecte des marchés". En passant de l'un à l'autre, la dimension politique, voire souveraine, de l'ordre public économique apparaît du fait du changement de nature. En second lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public de constitution des marchés de "l'ordre public d'octroi des marchés". En effet, c'est par des règles d'ordre public que le Droit à l'intérieur des marchés les garde, les bâtit ou les conçoive. Mais ce n'est qu'un versant de l'ordre public économique. Par un ordre public économique premier, des règles construisent des "octrois des marchés", pour empêcher que les objets de désir, objets naturels d'échanges, deviennent de ce fait objets de marché. Il s'agit d'un ordre public économique hautement politique, qui s'exprime par un rejet des élans de désir.
Cela serait une grave faute de ne pas percevoir les trois natures de l'ordre public économique (ordre public gardien de l'économie, ordre public promoteur de l'économie, ordre public d'octroi des marchés) les deux natures de l'ordre public économique.
Comme pour toute chose, la plus grande puissance de l'ordre public est dans sa version négative, ce par quoi des règles ferment l'accès du marché à des objets, des choses ou des prestations qui pourtant sont désirés, qui pourtant sont offertes. Ainsi, les personnes ne sont pas sur le marché, non pas parce qu'il n'y aurait pas de désir qu'elles y soient ni de consentement de leur part, mais parce que des règles d'ordre public économique le disent. Si on ne l'admet pas, alors parce que cette nature-là est la première forme de la prétention que constitue l'ordre public économique, alors celui-ci est dans sa nature-même récusé.
21 octobre 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Rochfeld, J., Les géant de l'internet et l'appropriation des données personnelles : plaidoyer contre la reconnaissance de leur "propriété", in Behar-Touchais, M. (dir.), L'effectivité du droit face à la puissance des géants de l'Internet, coll. "Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc", vol.1, IRJS Éditions, Université Panthéon-Sorbonne, p.73-87.
L'auteur se demande si les "géants d'Internet" peuvent s'approprier les données.
20 octobre 2015
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Behar-Touchais, M. (dir.), L'effectivité du droit face à la puissance des géants de l'Internet, vol.1, , coll. "Bibliothèque de l'IRJS - André Tunc, IRJS, t.63, Éditions IRJS, 2015, 383 p.
19 octobre 2015
Base Documentaire

Référence complète : Kossi, A.V., La protection des données à caractère personnel à l'ère de l'Internet. Impact sur l'évolution du cadre normatif et nouveaux enjeux. État des lieux en France et en Allemagne, coll; "Publications Universitaires Européennes", Peter Lang, 2011, 362 p.
L'auteur pose qu'Internet bouleverse la société et constitue un danger pour l'individu. La France et l'Allemagne ont été les premiers à réagir à travers les lois qui protègent l'individu contre la puissance informatique, puissance à laquelle Internet est lié. L'auteur observe que depuis le droit législatif a du peine à protéger l'individu et que c'est plutôt les tribunaux, notamment les Cours constitutionnelles, françaises et allemandes, qui protègent l'Internaute, dans son droit à la protection de ses données personnelles face à la puissance des entreprises de "l'ère de l'Internet".
15 octobre 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Pez, Th., L'ordre public économique, in "Le Conseil constitutionnel et l'entreprise", Dossier des Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, LGDJ - Lextenso éditions, n°49, octobre 2015, p.43-57.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
7 octobre 2015
Enseignements : La personne entre le droit et l’économie

Le mot "valeur" est amphibologique. En droit, il montre la proximité de celui-ci avec la morale : évoquant les "valeurs" du droit, on se réfère le plus souvent à ce qui en forme les principes fondamentaux, dont le caractère essentiel justifie qu'on n'ait même plus à les justifier. Ainsi, tout être humain est une personne. En tant que telle, elle a une valeur égale à celle d'une autre personne. En tant que telle, corrélativement et inversement, elle a une valeur incommensurable avec tout ce qui n'est pas une personnes, les choses et les biens, qui "valent" toujours moins d'une personne. Tout vaut moins qu'une personne.
Une fois cela dit, ces belles affirmations principielles dites, l'être humain qui constitue par sa seule existence une personne n'est pas désincarnée. Ainsi et par exemple, elle travaille. Selon la pensée anglaise, c'est même par son travail qu'elle est libre. Les prestations qu'elle assure lui seraient donc à ce titre indissociable. D'autres observent que la personne qui travaille, le "travailleur", est certes une personne, mais elle offre sa "force de travail" sur un espace : le "marché du travail" sur lequel des demandeurs - les entreprises, les employeurs, les exploiteurs - peuvent puiser dans cette force collective rendue disponible par ces offreurs.
Plus encore, alors que l'entreprise était définie classiquement comme un groupe de personnes ayant un projet pour la réalisation duquel elles se réunissent (entrepreneurs), la conception actuelle représente l'entreprise plus volontiers comme un "nœud de contrats" ou comme une réunion d' "actifs" (assets) : le capital financier et le "capital humain". Les personnes qui apportent leur talent, leur temps, leur énergie, etc. sont des actifs de l'entreprise, laquelle est elle-même un actif, côté.
Nul ne conteste que l'entreprise ait une "valeur", c'est-à-dire un chiffre, un nombre, résultant d'une "évaluation" de ce qu'elle représente pour les autres, ceux qui veulent potentiellement l'acheter, c'est-à-dire pour le marché lui-même. En effet, les mots "valeur" et "évaluation" et "valorisation" appartiennent à la même famille sémantique.
C'est ainsi que l'on est passé de la morale pure à la finance pure.
Aujourd'hui, c'est autour du désir, de la volonté et du consentement que la question de la valeur de la personne se réorganise. Par exemple en matière de pratique de maternité de substitution (GPA).
6 octobre 2015
Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE
Référence complète: CJUE, Grande chambre, Maximilian Schrems contre Data Protection Commissioner, C-362/14, 6 octobre 2015
Lire les conclusions de l'Avocat général Yves Bot.
Lire le communiqué de presse de la CJUE présentant le jugement
22 septembre 2015
Conférences
18 septembre 2015
Base Documentaire : Soft Law
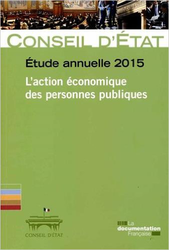
Référence complète : Conseil d’État, L'action économique des personnes publiques, Étude annuelle 2015 - coll." Les rapports du Conseil d’État", 2015, La documentation française, 259 p.
Consulter la table des matières
Lire la quatrième de couverture.
16 septembre 2015
Conférences

Le Journal of Regulation consacre un colloque au thème Internet, espace d'interrégulation.
Lire la présentation générale du colloque et son programme détaillé.
Le colloque a été suivi d'un ouvrage publié par les Éditions Dalloz, dans la Série Régulations, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche.
Lire la présentation de l'ouvrage qui a résulté de cette journée, et des articles qui ont résulté de la conférence.
Lire le working paper sur lequel s'appuie la conférence.
Consulter les slides utilisés pour la conférence.
Après avoir souligné que la notion même de "donnée" est incertaine et relève bien plutôt et paradoxalement du construit, la première perspective consiste à tirer les conséquences régulatoires du fait que ce que l'on désigne souvent comme "l'objet" de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son "sous-jacent", la donnée étant fabriquée par une entreprise, son objet étant l'usage pour lequel la donnée est destinée. La donnée est autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique.
Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve aussi la trace des personnes, soit le sous-jacent qu'on voudrait protéger, que l'on voudrait indissociable, soit la structure que l'on voudrait légitimement attaquer par le mécanisme nouveau de la compliance. Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet.
Dans une seconde perspective, il est souligné que tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers "Le Grand Interrégulateur". Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le "consentement" auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de "droit à l'oubli" se dissimule une arme très efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble bien se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire.
Le "droit à l'oubli" requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, protégeant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier.
2 septembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
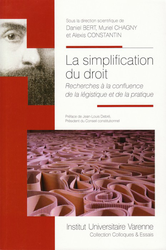
Référence complète : Petit, B., RSE et simplification du droit ; au-delà des apparences, in Chagny, M., (dir.) et al., La simplification du droit, coll. "Colloques & Essais", 2015, pp. 313-330.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR- Régulation & Compliance"
10 août 2015
Base Documentaire : Doctrine