26 mars 2024
Base Documentaire : Doctrine
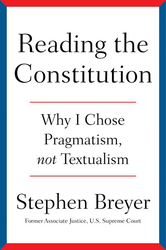
► Référence complète : S.Breyer, Reading the Constitution: Why I Chose Pragmatism, Not Textualism (Lire la constitution : Pourquoi j'ai choisi le pragmatisme et non le textualisme), Simon & Schuster, 2024, 361 p.
____
📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage
____
📗lire la table des matières de l'ouvrage
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "A provocative, brilliant analysis by recently retired Supreme Court Justice Stephen Breyer that deconstructs the textualist philosophy of the current Supreme Court’s supermajority and makes the case for a better way to interpret the Constitution.
“You will not read a more important legal work this election year.” —Bob Woodward, Washington Post reporter and author of fifteen New York Times bestselling books
“A dissent for the ages.” —The Washington Post
“Breyer’s candor about the state of the court is refreshing and much needed.” —The Boston Globe
The relatively new judicial philosophy of textualism dominates the Supreme Court. Textualists claim that the right way to interpret the Constitution and statutes is to read the text carefully and examine the language as it was understood at the time the documents were written.
This, however, is not Justice Breyer’s philosophy nor has it been the traditional way to interpret the Constitution since the time of Chief Justice John Marshall. Justice Breyer recalls Marshall’s exhortation that the Constitution must be a workable set of principles to be interpreted by subsequent generations.
Most important in interpreting law, says Breyer, is to understand the purposes of statutes as well as the consequences of deciding a case one way or another. He illustrates these principles by examining some of the most important cases in the nation’s history, among them the Dobbs and Bruen decisions from 2022 that he argues were wrongly decided and have led to harmful results."
____
Traduction libre : "Une analyse provocante et brillante de Stephen Breyer, juge de la Cour suprême récemment retraité, qui déconstruit la philosophie textualiste de la supermajorité actuelle de la Cour suprême et plaide en faveur d'une meilleure façon d'interpréter la Constitution.
« Vous ne lirez pas d'ouvrage juridique plus important en cette année électorale. Bob Woodward, journaliste au Washington Post et auteur de quinze best-sellers du New York Times.
« Une dissidence pour l'éternité ». -Le Washington Post
« La franchise de Breyer sur l'état de la Cour est rafraîchissante et nécessaire. -Le Boston Globe
La philosophie judiciaire relativement nouvelle du textualisme domine la Cour suprême. Les textualistes affirment que la bonne façon d'interpréter la Constitution et les lois est de lire attentivement le texte et d'examiner le langage tel qu'il était compris à l'époque où les documents ont été rédigés.
Ce n'est toutefois pas la philosophie du juge Breyer et ce n'est pas non plus la manière traditionnelle d'interpréter la Constitution depuis l'époque du président de la Cour suprême John Marshall. Le juge Breyer rappelle l'exhortation de Marshall selon laquelle la Constitution doit être un ensemble de principes praticables à interpréter par les générations suivantes.
Selon M. Breyer, le plus important dans l'interprétation du droit est de comprendre les objectifs des lois ainsi que les conséquences d'une décision dans un sens ou dans l'autre. Il illustre ces principes en examinant certaines des affaires les plus importantes de l'histoire du pays, notamment les arrêts Dobbs et Bruen de 2022 qui, selon lui, ont été décidés à tort et ont abouti à des résultats préjudiciables."
________
23 janvier 2020
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : W. Marx, "Vivre dans la bibliothèque du monde", Leçon inaugurale pour la Chaire de Littérature comparé au Collège de France, 23 janvier 2020.
____
📻Ecouter un entretien à propos de ce cours, centré sur la notion de "bibliothèque mentale" :
____
► Présentation de la conférence (faite par le Collège de France) : L’étude de la littérature est affaire de science, mais aussi, et sans doute d’abord, de plaisir. Or le plaisir peut faire obstacle à une approche scientifique de la littérature. Heureusement, une étude comparée de la littérature permet de dépayser notre rapport à la littérature en remettant en question nos habitudes de lecture ainsi que les canons sur lesquels se fonde notre conception de l’objet littéraire. Elle permet de renouveler notre compréhension des œuvres, dans la mesure où toute lecture est, de manière inconsciente, une lecture comparée : une œuvre fait sens sur un fond d’autres œuvres dont elle se détache, tant et si bien que changer l’arrière-plan revient également à modifier la perception du premier plan. Un tel décentrement n’est cependant pas facile à obtenir : il exige une transformation quasiment existentielle du lecteur lui-même, appelé à renoncer à l’idée beaucoup trop nivelante de littérature mondiale, pur produit de l’émergence du concept moderne de littérature à la fin du XVIIIe siècle, afin de parvenir à entrer dans un autre univers, celui de la bibliothèque du monde, infiniment plus respectueuse de la singularité des objets qui la composent, et donc plus propre à provoquer la défamiliarisation indispensable. Une approche comparatiste doit se frayer un chemin étroit entre, d’une part, cette nécessaire sensibilité à l’altérité et, d’autre part, les forces aujourd’hui toujours plus puissantes qui visent à rendre les cultures hermétiques les unes aux autres en insistant sur une prétendue incommunicabilité des objets culturels.
.....
À quelle échelle en effet envisager un problème quelconque de l’histoire littéraire ? L’échelle européenne vaut pour un grand nombre de sujets intéressant la littérature française. Mais de quelle Europe s’agira-t-il ? Une définition large s’impose, intégrant les littératures des langues européennes, de quelque continent qu’elles viennent, et notamment des Amériques. Mais pourquoi s’arrêter là ? Dès l’Antiquité classique, les échanges méditerranéens et eurasiens mirent en contact les cultures européennes avec l’Afrique et l’Asie, et ils ne cessèrent de se complexifier, en particulier avec les mouvements de colonisation, puis de décolonisation. La perméabilité des cultures et la circulation des œuvres forment une donnée fondamentale de leur histoire.
La notion même de littérature fait cependant problème, avec tout ce qu’elle implique de présupposés et d’usages historiquement datés et géographiquement localisés : en gros, l’Europe des deux derniers siècles. C’est pourquoi l’intitulé de cette chaire a été mis au pluriel, et il y est proposé l’étude non pas de la, mais des littératures, dont il convient de postuler d’abord la diversité, non seulement linguistique, mais culturelle et anthropologique. Il s’agira d’explorer une problématique, celle de la pluralité des objets dits littéraires, de leur nature, des corpus qu’ils forment, de leurs fonctions et de leur variabilité historique et culturelle.
En travaillant à une histoire et à une géographie différentielles du concept de littérature, on visera à provoquer chez le lecteur contemporain un sentiment d’étrangeté par rapport à lui-même, à déstabiliser ses systèmes de valeurs et sa vision du monde : non pas le simple dépaysement pour le dépaysement, mais un dépaysement visant à la défamiliarisation.
Une telle réflexion sur les cultures dans lesquelles s’inscrivent les textes finit forcément par déboucher sur une critique générale de la culture, selon une mission de nature humaniste et démocratique. Dans l’Europe à laquelle nous participons désormais en tant que citoyens, dans le monde globalisé qui est le nôtre, où les progrès technologiques démultiplient les échanges et circulations des personnes, des discours, des représentations et des biens tout en aggravant le risque de malentendus culturels et religieux, cette mission subversive, critique et créatrice ne peut pas ne pas rester la note fondamentale, sinon la justification, de tout enseignement et de toute recherche en littératures comparées au Collège de France.
________